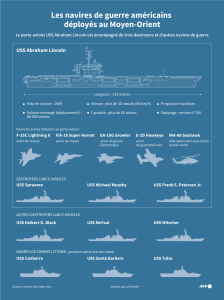L’annonce de Donald Trump de vouloir annexer le Canada a réveillé le sentiment national dans le pays. Mais le Canada est loin d’être un vassal aveugle des États-Unis. Il dispose d’une vraie vision stratégique et entend bien défendre son indépendance. Entretien avec Julien Schofield
Propos recueillis par Henrik Werenskiold.
Julien Schofield est docteur en relations internationales et professeur à l’université Concordia de Montréal.
Commençons par le commencement. Pourquoi Ottawa a-t-elle été choisie comme capitale du Canada ?
Ottawa a été choisie parce qu’elle se trouve à la frontière entre le Québec et l’Ontario, entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, entre les Français et les Britanniques, les deux principales communautés du Canada à l’époque, au XIXe siècle.
La ville est également située loin au nord du fleuve Saint-Laurent, hors de portée de l’artillerie américaine. En cas de guerre avec les États-Unis, la stratégie du Canada consistait essentiellement à combattre les Américains sur les Grands Lacs, mais elle n’a pas été très efficace. Pendant la guerre de 1812, par exemple, les Américains ont remporté la guerre navale sur les Grands Lacs.
Cela n’a toutefois pas été décisif, car les Américains ont perdu une autre guerre : la guerre du blocus. À cette époque, les États-Unis étaient divisés : la Caroline du Nord et la Caroline du Sud au sud, et la Nouvelle-Angleterre au nord. Si les premières étaient fidèles aux Américains, ce n’était pas le cas des secondes. Les habitants de la Nouvelle-Angleterre envoyaient des navires chargés de céréales vers l’Atlantique, qui étaient délibérément capturés par la Royal Navy, qui utilisait ensuite ces céréales pour nourrir sa flotte. Les Britanniques payaient les agents de la Nouvelle-Angleterre à Londres. Ironiquement, les États-Unis ont donc fini par alimenter le blocus britannique pendant la guerre.
Lors de la dernière tentative d’invasion américaine du Canada, un grand troupeau d’animaux a été conduit sur la route de York (aujourd’hui Toronto), bloquant l’avance, ce qui est assez comique.
Que s’est-il passé après que la Grande-Bretagne a commencé à se retirer du Canada ?
Les Britanniques ont essentiellement abandonné le Canada parce qu’ils n’avaient aucune perspective réaliste de le défendre. Dans ce contexte, l’achat de l’Alaska par les États-Unis a en fait profité à la Grande-Bretagne. Cela signifiait qu’ils n’avaient plus à s’inquiéter de l’empiètement russe sur le territoire canadien. En fait, Moscou craignait que les Britanniques n’utilisent le Canada pour s’emparer de l’Extrême-Orient russe, ce qui n’a jamais été réaliste. Aucune des deux parties n’allait prendre la neige à l’autre.
Il y a également eu le conflit entre les Britanniques et les Américains au sujet du Venezuela dans les années 1870, qui n’a été résolu qu’en 1890. La Grande-Bretagne a décidé de renoncer à ses intérêts dans cette région afin d’obtenir le soutien des États-Unis contre l’unification de l’Allemagne. Ainsi, pendant très longtemps, le Canada a été abandonné par les Britanniques et laissé sans protection.
Comment le Canada a-t-il contribué aux guerres mondiales ?
L’entrée des États-Unis dans le système international signifiait que ce pays n’était jamais isolationniste dans le Pacifique. Il était toujours isolationniste en ce qui concernait l’Europe, car celle-ci était dangereuse, évidemment. Mais lorsque les Américains ont vu l’effondrement de la France, qui était considérée comme la puissance militaire la plus puissante au monde, ils se sont sentis menacés et ont finalement décidé d’agir.
La situation était très similaire pour le Canada. Avant la Première Guerre mondiale, le Canada ne disposait que de deux navires de guerre. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la situation n’était guère meilleure. Mais en 1940, juste avant Pearl Harbor, le premier ministre canadien a signé de nombreux accords militaires importants avec Franklin Roosevelt, qui ont changé la position du Canada dans le monde.
Le Canada a pris de l’importance pendant les guerres en raison de son rôle industriel. Par exemple, les premiers chars Sherman, dont les États-Unis ont ensuite construit 50 000 exemplaires, ont été produits à Montréal, dans les ateliers ferroviaires de Lachine. Le Canada a fabriqué les premiers modèles, qui ont ensuite été envoyés aux Britanniques et utilisés au Moyen-Orient. Les États-Unis ont donc utilisé le Canada comme intermédiaire pour approvisionner la Grande-Bretagne.
Après la Première Guerre mondiale, comment le Canada s’est-il intégré dans la guerre froide ?
Avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis pensaient que l’Union soviétique serait totalement impuissante en dehors de ses propres frontières. Ils n’envisageaient donc pas que celle-ci puisse un jour occuper l’Europe de l’Est. À l’instar des États-Unis, le Canada ne craignait pas particulièrement les Soviétiques au départ. Mais nous avions des mouvements de gauche puissants, notamment d’importantes grèves ouvrières à Winnipeg dans les années 1930.
Le tournant a été l’affaire Gouzenko en 1945. Un cryptographe soviétique a fait défection à Ottawa, révélant l’existence de réseaux d’espionnage soviétiques. Pendant six mois, le Canada n’a pas su quoi faire de lui. Finalement, des procès ont eu lieu et plusieurs personnes ont été emprisonnées à Montréal à la fin des années 40 et au début des années 50, y compris des membres des forces de police et des immigrants d’Europe de l’Est sympathisants de l’Union soviétique.
Parallèlement au projet Venona américain, les révélations de Gouzenko ont montré que l’espionnage soviétique, en particulier dans le domaine des armes nucléaires, s’était infiltré en Amérique du Nord par le Canada. Après cela, le Canada s’est fermement ancré dans l’OTAN, suivant généralement l’exemple américain, ce qu’il fait encore aujourd’hui.
D’un point de vue européen, le Canada semble souvent complètement lié aux États-Unis, presque comme le Royaume-Uni. Quoi que Washington décide de faire, Ottawa suit sans vraiment avoir son mot à dire. Est-ce une observation juste ?
Oh non, certainement pas. C’est une idée fausse très répandue. Oui, géographiquement, le Canada est lié aux États-Unis en Amérique du Nord, mais politiquement, nous avons souvent agi de manière indépendante et continuons à le faire. Permettez-moi de vous donner un exemple concret datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre froide.
À cette époque, au début des années 1950, les États-Unis voulaient installer des armes nucléaires au Canada, afin que le pays soit le gardien de ces armes qui seraient utilisées en cas de guerre avec les Soviétiques. Le président Eisenhower a tenté de nous convaincre d’accepter, mais le gouvernement Diefenbaker a refusé, et ce refus a été si controversé qu’il a entraîné la chute du gouvernement. Ce n’est pas de la dépendance, c’est un acte délibéré d’autonomie.
Il y a ensuite les politiques de Pierre Trudeau à la fin des années 1960 et dans les années 1970, au cours desquelles il a réduit de moitié notre présence au sein de l’OTAN. Il a réduit notre brigade en Allemagne de 5 000 à 2 000 soldats et a réduit de moitié la présence de l’armée de l’air. Il a même supprimé le mot « Royal » du nom de nos forces armées afin de souligner la souveraineté canadienne.
Et au niveau national, il a imposé un protectionnisme strict vis-à-vis des États-Unis. Les entreprises américaines n’avaient plus le droit de posséder des sociétés pétrolières en Alberta. Nous avons poursuivi une politique de substitution des importations, souhaitant contrôler nos propres ressources, à l’instar de la Russie. Cette décision n’était pas motivée par la crainte d’être dominés par les États-Unis, mais par la volonté de contrôler notre propre économie.
De plus, en matière de politique étrangère et de sécurité, le Canada a clairement démontré qu’il n’était pas un simple pantin des Américains : depuis 1945, nous ne participons jamais aux opérations militaires américaines sans la présence de la France. C’est une règle sans exception :
lorsque la France a refusé de retourner au Vietnam, le Canada a également refusé, et est même allé plus loin en se joignant à l’Inde en tant qu’observateurs de l’ONU dans la zone démilitarisée, parachutés à bord de C-130. En 1990, lorsque la France a participé à la libération du Koweït, le Canada s’est également joint à elle. Au Congo, lorsque les parachutistes français et belges ont sauté à bord d’avions américains, nous les avons suivis. En Afghanistan, lorsque la France y est allée, nous y sommes allés aussi. Mais en 2003, lorsque la France est restée en dehors de l’Irak, le Canada est également resté en dehors, malgré l’énorme pression exercée par les États-Unis.
Ainsi, loin de profiter gratuitement de Washington, le Canada a consciemment résisté à la domination américaine. De plus, l’idée que l’Amérique est un « éléphant » qui plane au-dessus de nous n’est pas tout à fait exacte. En réalité, les Américains ne pensent pratiquement jamais au Canada. Même les propos de Trump sur l’annexion étaient la première fois depuis avant la Seconde Guerre mondiale qu’un président américain nous menaçait ouvertement.
Dans quelle mesure prenez-vous cela au sérieux ?
Nous prenons Trump au sérieux. Quand il mentionne quelque chose, c’est qu’il y pense vraiment. Ses collaborateurs peuvent bien inonder les ondes de déclarations scandaleuses, mais Trump lui-même pense ce qu’il dit. Cela dit, lorsqu’il a évoqué l’idée d’annexer le Canada, il a rapidement fait marche arrière. Non pas à cause de la pression canadienne, mais probablement parce que ses propres conseillers lui ont dit que c’était imprudent.
En effet, l’annexion du Canada par les États-Unis serait désastreuse pour le Parti républicain.
Pourquoi ? Cela est lié à nos convictions politiques. Si les États-Unis envahissaient et occupaient le Canada, puis nous accordaient le droit de vote, cela ferait basculer le paysage politique américain vers la gauche, car les 42 millions d’habitants du Canada feraient pencher la balance en faveur du Parti démocrate.
Paradoxalement, nous sommes donc invincibles. Le coût politique pour les États-Unis serait trop élevé. Oui, l’Alberta est pro-américaine en raison de sa richesse pétrolière, mais même l’Alberta a une médecine plus socialisée que les États américains les plus à gauche. Ils seraient choqués par la réalité américaine. Une invasion ou une annexion n’est donc pas vraiment à l’ordre du jour.
Trump a-t-il raison de tirer la sonnette d’alarme sur la faiblesse militaire du Canada dans l’Arctique ?
Oui, notre présence dans l’Arctique, tant civile que militaire, est lamentablement faible. À l’époque, nous avons déplacé de force des familles autochtones vers des colonies du nord et restreint leurs déplacements afin de revendiquer la souveraineté sur la région. Ces communautés existent toujours, mais elles sont minuscules.
Dans les îles de la Reine-Élisabeth, au nord du passage du Nord-Ouest, moins de 1 000 personnes vivent, dont beaucoup sont des scientifiques. Notre seule base militaire, dont la construction a débuté en 2007, n’est toujours pas pleinement opérationnelle en 2025, et elle fait face au Groenland, pas à la Russie. Ainsi, si les États-Unis voulaient un jour s’attaquer au Canada, il serait logique qu’ils le fassent dans l’Arctique, car nous n’y avons pratiquement aucune défense réelle.
Si l’on compare avec le Groenland, l’île compte environ 56 000 habitants répartis dans 30 localités. La présence du Danemark dans son territoire arctique est donc plus importante que celle du Canada dans ses îles arctiques. J’irais même jusqu’à dire que si les États-Unis tentaient de s’emparer du Groenland et que le Danemark opposait une résistance militaire, cela provoquerait probablement une crise et Washington serait contraint de battre rapidement en retraite.
Mais si les États-Unis débarquaient dans le Haut-Arctique canadien dans le but de le conquérir par la force, il n’y aurait pratiquement aucune résistance. Il y a un détachement de 10 personnes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et une poignée de personnel de recherche et de sauvetage, c’est tout, donc il pourrait être facilement conquis.
Au lieu d’envahir le pays, Trump pourrait-il essayer de provoquer la dissolution du Canada, en encourageant l’Alberta ou le Québec à faire sécession, puis en les annexant petit à petit ?
En théorie, oui. Le Canada est une confédération, ce qui signifie que les provinces ont le droit légal de faire sécession, contrairement aux États américains, qui se sont battus pour cette question.
Mais dans la pratique, Washington s’est toujours opposé à la dissolution du Canada. Lors des référendums au Québec en 1980 et 1995, le gouvernement américain a clairement indiqué qu’il souhaitait un Canada uni. Il est plus facile de traiter avec un grand voisin qu’avec des provinces fragmentées. Ainsi, même si un scénario de dissolution est envisageable, il n’est pas dans l’intérêt des États-Unis.
Trump a également critiqué le Canada pour son manque de sérieux en matière de dépenses de défense. Le pays se classe actuellement parmi les derniers membres de l’OTAN en termes de dépenses de défense. Est-ce exact ?
Tout à fait. Nous oscillons autour de 1,3 % du PIB, et Washington ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. C’est presque devenu un jeu politique. Les gouvernements, qu’ils soient libéraux ou conservateurs, font de grandes promesses concernant de nouveaux équipements, mais les tiennent rarement.
Les libéraux, par exemple, ont promis de moderniser les radars canadiens dans l’Arctique afin qu’ils soient efficaces contre les missiles hypersoniques. Mais tout le monde sait que la vitesse d’un missile n’a pas d’importance, la riposte est la même. Cette promesse était surtout destinée à faire bonne figure, et les mises à niveau ont été discrètement reportées.
De leur côté, les conservateurs ont toujours promis d’allouer davantage de ressources au matériel militaire lorsqu’ils sont au pouvoir, comme les chars, les navires et les avions, afin de séduire leur électorat masculin. Mais une fois élus, leurs dépenses réelles ne diffèrent guère de celles des libéraux. Les deux camps utilisent donc la défense comme un argument rhétorique, et non comme une réalité.
Le Canada est également réticent à acheter des avions de combat F-35, car cela nous lie trop étroitement aux systèmes américains que Washington peut contrôler. Au lieu de cela, nous avons bloqué l’acquisition d’avions de combat modernes, ce qui nous laisse avec environ 70 CF-18 obsolètes qui, dans la pratique, ne peuvent pas être utilisés dans la guerre moderne.
Nous achetons des avions de patrouille P-8 Poseidon, mais principalement parce que nos vieux Aurora sont complètement usés. Quant aux navires, nous avons promis 12 nouvelles frégates, mais leur construction prendra des années. Nous construisons également un nouveau brise-glace de classe DeWolf, mais il n’est pas armé : impressionnant sur le plan symbolique, mais inutile sur le plan militaire.
Nos gouvernements utilisent également l’Arctique comme diversion, parlant de protéger notre souveraineté dans cette région tout en évitant de prendre des engagements dans le Pacifique ou ailleurs. En réalité, notre revendication sur le passage du Nord-Ouest est fragile au regard du droit international, mais elle sert de sujet de discussion au niveau national.
Cette réticence à dépenser est-elle purement économique ou également politique ?
Les deux. À l’instar des pays européens, le Canada dépense beaucoup pour les programmes sociaux, et la défense passe toujours au second plan. Mais ce n’est pas tout. La politique ici au Canada est très « genrée ». Les femmes ont tendance à voter à gauche, soutenant l’internationalisme et s’opposant aux dépenses militaires, car les armes sont associées à l’insécurité personnelle. Les hommes penchent pour l’isolationnisme, souhaitant que l’argent reste au pays, et considèrent également la politique de puissance comme naturelle.
Nous oscillons donc entre des gouvernements internationalistes qui refusent d’investir dans les armes et des gouvernements conservateurs qui tiennent un discours musclé, mais qui ne dépensent pas plus pour autant. Et nous n’avons pas l’intention d’augmenter nos dépenses de défense, quelle que soit la pression exercée par l’administration Trump.
Si les États-Unis ne peuvent pas faire pression sur le Canada pour qu’il dépense plus, qui ou quoi le peut ? Vous avez mentionné que le Canada se tourne souvent vers la France avant de décider de suivre ou non les États-Unis sur le plan militaire. Est-ce vraiment le cas ? Si oui, pourquoi ?
En effet, les pressions exercées par Washington n’ont aucun effet sur le Canada. Mais comme je l’ai déjà mentionné, celles exercées par l’Europe, en particulier la France, ont un effet certain. Pour les Canadiens, la France est le symbole de l’Europe, le contrepoids sur lequel nous nous appuyons pour équilibrer l’influence américaine en Amérique du Nord.
Si Paris arrivait à Ottawa avec des délégations de petits alliés européens et disait : « Nous savons que vous comptez sur nous, mais nous ne vous soutiendrons plus si vous n’augmentez pas vos dépenses de défense », nous prendrions cela très au sérieux. En effet, le Canada paniquerait et se plierait à cette exigence.
Comme je l’ai déjà dit, le Canada a un comportement bien défini : depuis 1945, nous ne participons jamais aux opérations militaires américaines si la France n’y participe pas également. C’est une règle sans exception. Le Canada se tourne vers la France, et non vers la Grande-Bretagne, comme contrepoids européen avant de décider de suivre ou non les États-Unis.
Pourquoi la France et non le Royaume-Uni ? Le Canada est évidemment plus proche du Royaume-Uni dans la plupart des domaines…
C’est parce que le Royaume-Uni n’est pas, de facto, un pays stratégiquement indépendant. Son arsenal nucléaire est lié à celui des États-Unis. Les missiles sont stockés en Amérique et le Royaume-Uni dépend de Washington pour son réapprovisionnement. La France, en revanche, dispose d’un programme d’armement nucléaire totalement indépendant, ce qui en fait un acteur important.
Seuls cinq pays ont démontré leur capacité à produire en série des armes thermonucléaires, et la France en fait partie. Cela confère à Paris une crédibilité unique en tant que porte-parole de l’Europe, de notre point de vue. Le Canada respecte donc l’autonomie de la France d’une manière que nous ne respectons pas la dépendance de la Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne et la France ont souvent été de féroces rivales. Cet antagonisme a-t-il également influencé l’opinion des Canadiens sur les Français ?
Moins que vous ne le pensez. L’antagonisme dit « grenouilles contre roast beef » relève principalement du chauvinisme journalistique et du sensationnalisme. Il est vrai que la France et le Royaume-Uni ont eu des différends historiques, mais dans la pratique, les Français et les Britanniques entretiennent depuis longtemps des relations très étroites, et leurs arsenaux nucléaires ne se sont jamais dirigés l’un contre l’autre.
En fait, certaines des coopérations les plus profondes ont eu lieu entre des partenaires improbables. Charles de Gaulle, qui affichait publiquement son aversion pour les Américains, a discrètement collaboré avec Richard Nixon. Ce dernier a autorisé le transfert de la technologie américaine en matière de missiles et de sous-marins à la France, accélérant ainsi le développement de son arsenal nucléaire. Ainsi, malgré des discours hostiles, la coopération pratique était bien réelle.
En tant que pays façonné par les traditions britanniques, le Canada ne partage-t-il pas le scepticisme de la Grande-Bretagne à l’égard de la notion d’indépendance stratégique européenne ?
Pas vraiment. Au Canada, la population franco-canadienne remonte à avant la Révolution. Elle ne se perçoit pas à travers le prisme de la rivalité franco-britannique. Et sur le plan politique, la plupart de nos premiers ministres ont été franco-canadiens. Pour être un leader efficace au Canada, il faut généralement disposer de cette base. L’instinct canadien est donc de considérer la France comme un partenaire et non comme un rival.
Ainsi, du point de vue d’Ottawa, Paris est plus importante que Londres, car elle incarne l’Europe. Seule la France peut unir l’Europe politiquement, car seule la France dispose d’une indépendance nucléaire. C’est pourquoi les politiciens canadiens surveillent constamment Paris. Quant à savoir si Paris réalise l’influence qu’elle exerce sur les décisions canadiennes, c’est une autre question. Mais pour Ottawa, la France est le contrepoids décisif à la pression américaine et donc un partenaire essentiel pour nous, Canadiens.
Le Canada se présente souvent comme un champion du droit international et du maintien de la paix. Cette image est-elle fidèle à la réalité ? Si oui, comment la faiblesse du droit international ces dernières années a-t-elle influencé votre perception de vous-mêmes ?
Tout à fait. Les Canadiens se considèrent comme des internationalistes libéraux. Nous avons envoyé des soldats dans de nombreuses missions de maintien de la paix de l’ONU, de Chypre aux Balkans en passant par l’Afrique. Notre opinion publique attend du Canada qu’il soutienne le droit international — cela fait partie de notre identité nationale et de ce que nous sommes en tant que peuple.
Mais le droit international n’a jamais été fort en soi. Les Soviétiques ont signé les accords d’Helsinki, mais ont continué à occuper l’Europe de l’Est. La Chine a violé les accords à Hong Kong et en mer de Chine méridionale. La Russie a envahi l’Ukraine au mépris de toutes les normes juridiques. Il est donc évident qu’il a ses faiblesses, mais cela ne signifie pas que nous devrions cesser de le soutenir sans réserve.
Le droit n’a d’importance que lorsque les États puissants sont prêts à l’appliquer. C’est pourquoi les résultats dépendent souvent de ceux qui sont prêts à agir, et non de ce que dit la loi. Néanmoins, les populations de pays comme le Canada et de toute l’Europe croient au droit international, et leurs gouvernements le respectent. Cette croyance exerce une pression politique sur les autres gouvernements pour qu’ils agissent et le respectent.
Ainsi, même si le droit international est actuellement faible, il reste important sur le plan politique. Pour mobiliser les populations, les dirigeants ont besoin de valeurs auxquelles ils peuvent se référer. La Bosnie, le Rwanda, Srebrenica : ces crises ont contraint à agir parce que l’opinion publique l’exigeait. Les Canadiens, en particulier, attendent de leurs dirigeants qu’ils défendent les droits de l’homme.
Cela ne signifie pas que nous réussissons toujours. Au Rwanda, notre propre général a appelé Ottawa pendant le génocide, suppliant qu’on intervienne, mais il a été ignoré. Cependant, l’attente que le Canada se préoccupe de la situation était toujours là.
Pourtant, chez eux, les Canadiens semblent plus préoccupés par le logement et l’économie que par les affaires étrangères. Comment cela affecte-t-il la politique ?
Cela éclipse tout le reste. Les jeunes ne peuvent pas acheter de maison. Ils sont confrontés à une flambée des loyers malgré les vastes terres et les ressources du Canada. Lorsque les électeurs s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, ils ne se préoccupent pas en priorité des génocides à l’étranger. J’ai fait du porte-à-porte pendant les campagnes électorales, et même les immigrants originaires de régions déchirées par la guerre me disent : « Oui, la politique étrangère est importante, mais j’ai besoin d’une maison. » Telle est la réalité politique.
Qu’en est-il alors de l’identité canadienne ? Même si les normes mondiales sont faibles, les Canadiens restent internationalistes dans l’âme. Nous nous considérons comme des partisans de la paix, du droit et de la coopération. Mais la guerre culturelle complique les choses : les électrices prônent l’internationalisme mais s’opposent aux dépenses militaires, tandis que les hommes penchent pour l’isolationnisme, souhaitant un contrôle et une puissance locaux.
Cette oscillation rend plus difficile le maintien d’un consensus de type guerre froide. Néanmoins, l’idée centrale demeure : l’identité de la politique étrangère du Canada est liée au soutien du droit international, même si son application dépend d’autres pays.