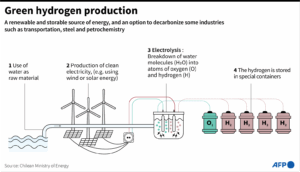Pour beaucoup d’Européens, la signature en 1998 en Irlande du Nord de l’Accord dit « du Vendredi Saint »[1](que nous désignerons sous le nom d’ « Accord ») a mis fin à la violence politique qui sévissait depuis des décades sur ce petit territoire de l’Europe, violence qui constituait par son caractère et son importance une anomalie dans un espace politique voué à la paix et au développement et malheureusement fort troublé par les agissements insensés et barbares de « terroristes » arriérés qui n’avaient pas encore saisi la portée et les bénéfices qu’ils pourraient tirer de la mondialisation heureuse.
L’Accord signifiait donc tout simplement la victoire contre le « terrorisme » que les « spécialistes » américains et leurs thuriféraires académiques (aux Etats-Unis et ailleurs) ont érigé en concept juridique, politique, voire scientifique, alors même que la plupart d’entre eux ne s’entendent toujours pas sur sa définition[2].
Or, comme l’écrivent judicieusement certains analystes américains[3], donner du terrorisme une définition n’est pas qu’un exercice théorique, car déclarer officiellement qu’un acte de violence est un acte terroriste a des conséquences importantes au regard de la loi[4]. Mais on peut ajouter que cela entraîne aussi d’autres conséquences très importantes, par exemple en matière de politique de sécurité, et en particulier en matière d’utilisation de la force. En effet, qualifier telle ou telle violence de terroriste la fait entrer dans une catégorie spécifique, susceptible d’un traitement spécifique, notamment dans le déploiement de l’arsenal dit « antiterroriste », qu’il soit juridique, idéologique (analyse de la situation), ou qu’il relève de l’organisation ou de l’emploi de la force.
Le cas de l’Irlande du Nord est un exemple tout à fait intéressant de ce problème de l’obscurcissement de la compréhension des phénomènes politiques par l’application à leur endroit de concepts sans signification. Notre idée est précisément de montrer ici que le conflit d’Irlande du Nord ne relève pas du « terrorisme » mais plutôt de la violence politique et de la guerre, et qu’il se comprend parfaitement en conséquence que les instruments de son règlement relèvent du même ordre de phénomènes. En effet, le conflit en Irlande du Nord est avant tout un conflit de souveraineté, et son traitement relève à la fois de la diplomatie et de la force armée.
Aussi à lire : La guerre en ville. Stratégies obsidionales
Un conflit de souveraineté
On qualifie donc la plupart du temps le conflit violent – qui a essentiellement opposé en Irlande du Nord de 1969 à 1999 l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) au Royaume-Uni, mais aussi les organisations paramilitaires (et les populations) catholiques et protestantes – de manifestations de « terrorisme » et de « lutte antiterroriste »[5]. On a tort. Pour comprendre la nature de ce conflit on doit en réalité remonter très loin en arrière, certains estiment à plusieurs siècles (au moins jusqu’au 17e siècle, époque de la colonisation dite « scientifique » de l’Irlande par la couronne anglaise) ; et si l’on veut chercher du sens dans une période plus récente il faut évoquer au moins la guerre anglo-irlandaise qui a vu s’affronter les nationalistes catholiques irlandais et le gouvernement et l’armée britanniques, de 1919 à 1921, guerre qui faisait elle-même suite à la terrible répression qui s’était abattue sur les catholiques irlandais après la « rébellion »[6] de 1918.
Cette rébellion, ainsi que la guerre qui s’ensuivit et qui déboucha sur la partition de l’Irlande, avait en quelque sorte pour fondement « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »[7] que le président Woodrow Wilson proclamait au même moment dans le système international. Cette revendication, ancienne, mais également ambivalente, car portée uniquement par les républicains catholiques, reposait sur le fantasme de l’existence d’une « nation » irlandaise dont le « homeland » aurait été l’Ile toute entière, injustement colonisée et occupée par les Britanniques. La réalité est plus nuancée : en effet le conflit multiséculaire qui a longtemps déchiré l’Irlande n’oppose pas seulement les Républicains nationalistes (et catholiques) irlandais à la Couronne britannique, mais aussi ces mêmes Républicains nationalistes catholiques aux protestants irlandais « Unionistes »[8], établis en Irlande depuis des siècles, et loyaux à la Couronne.
Aussi à lire : Michael Collins : l’insurrection comme moyen, la liberté comme destin
La nature du conflit contemporain en Irlande du Nord est ainsi, et depuis plusieurs décades, en quelque sorte « hybride » : il relève en effet à la fois de la question politique éternelle du partage du pouvoir entre groupes antagonistes à l’intérieur d’un Etat (les « catholiques » contre les « protestants »), mais aussi et peut-être surtout – la première dimension participant à la seconde – de la question non moins éternelle de l’existence des Etats et de leur souveraineté : les « nationalistes-républicains » revendiquent en effet un Etat « irlandais » – essentiellement sous la forme d’une réunification de l’Ile par un rattachement à la République d’Irlande, qui est elle-même un Etat créé à la suite de la guerre anglo-irlandaise. Les « unionistes » réaffirment quant à eux régulièrement leur appartenance constitutionnelle à l’Etat du Royaume – « Uni » et leur allégeance à la Couronne britannique. Finalement, la question est : « l’Irlande peut-elle (doit-elle) constituer un Etat-nation ? »… Au Nord, la réponse catholique à cette question est majoritairement OUI, alors que la réponse protestante est majoritairement NON. Ce conflit est en réalité un choc permanent et multiséculaire de deux conceptions de l’ordre politique, qui ont fini par déboucher sur la création de deux Etats-nations (au sens des relations internationales).
Mais ces deux Etats-nations ont en commun des peuples différents, une histoire violemment conflictuelle et un territoire différemment « investi », c’est-à-dire que le rapport au même territoire est différent. La problématique du territoire et des perceptions très complexes et souvent contradictoires du homeland par les catholiques et les protestants nous ramène à la guerre, car le territoire touche au plus profond de l’identité politique. Anthony Smith[9] rappelle que le territoire est pour la communauté politique un lieu mystique, qui renferme des lieux saints ou sacrés. C’est pour cela qu’il est célébré dans le folklore par lequel la communauté s’y associe. La problématique du Brexit[10] a ravivé la conscience de l’importance de la possession du territoire à l’occasion de la tension à propos de la frontière, mais la perspective européenne, essentiellement juridique et économique, est loin d’en rendre compte.
Les signataires de l’Accord de 1998 (et notamment les deux Etats protagonistes, le Royaume-Uni et la République d’Irlande) tentèrent de dépasser cette problématique insoluble en abolissant de facto leur frontière en Irlande, et en renvoyant la question du statut constitutionnel de l’Irlande du Nord aux calendes : la constitution de la République fut révisée en 1998 pour modifier les articles 2 et 3 qui mentionnaient expressément leur revendication de la souveraineté de la République sur toute l’Irlande, ce qui constituait une reconnaissance de la légitimité de l’Irlande du Nord en tant qu’entité politique ; quant au Royaume-Uni, il entérina la proposition selon laquelle tout changement dans le statut de la province devait recueillir l’assentiment de tous les citoyens d’Irlande du Nord. Il est clair que cet Accord, dont la teneur et la trame furent essentiellement le fruit de la réflexion des deux gouvernements, rend quasiment impossible toute solution autre que celle du statu quo, à savoir la considération de l’Irlande du Nord comme une sorte d’ovni constitutionnel, à la fois province autonome du Royaume et « territoire de la République », porteuse d’allégeances ambiguës et contradictoires, et historiquement enracinée dans des souvenirs et des références violemment antagonistes mais étroitement entrelacées. La possibilité de l’Etat-nation (Irlande ou Irlande du Nord) est donc largement exclue, de même que le retour à un fonctionnement « à la britannique » de la province, à savoir celui d’une démocratie majoritaire qui assurerait la domination du groupe le plus nombreux, à savoir les protestants unionistes.
Aussi à lire : Distinguer le terrorisme de la guérilla
Mais les Républicains se sont installés dans la durée : leur idée du futur, celle de l’Etat-nation, est ancienne, et on peut considérer que dans une certaine mesure le « deal » passé avec les autres acteurs du conflit en 1998 les a rapprochés de leur objectif : de combat inacceptable l’Etat-Nation est devenu une hypothèse envisageable. Récemment encore, l’une des dirigeantes du Sinn Fein expliquait qu’ « un referendum sur la réunification (était) aujourd’hui inévitable »[11]. Quant aux Unionistes protestants qui se trouvaient en position de faiblesse depuis l’Accord précédent de 1985 signé entre le premier ministre britannique Margaret Thatcher et le Taoiseach irlandais Garret Fitzgerald confirmée par l’Accord de 1998, ils se sont retrouvés en phase avec la conscience conservatrice anglaise du caractère premier de la souveraineté de l’Etat. Et la décision finalement prise par le peuple britannique de quitter l’Union Européenne a dans une certaine mesure permis de rééquilibrer (au moins dans leur esprit) la politique de coopération avec la République engagée dès 1984 par Margaret Thatcher que les Unionistes avaient considéré comme un véritable abandon.
Cette dimension cruciale de l’Etat et de la souveraineté permet de comprendre que le règlement de ce conflit n’ait débuté qu’en 1985 au moment de l’Accord anglo-irlandais, et ait culminé avec la signature de l’Accord de 1998 au terme d’un long processus de coopération entre les deux Etats. Cela permet aussi de comprendre pourquoi même cet accord solennel signé par toutes les parties en présence, avec la haute médiation américaine et sous le regard « bienveillant » de l’Europe, n’ait toujours pas débouché sur un véritable arrêt des hostilités et sur une résolution, c’est-à-dire une fin, du conflit. L’Accord tient parce que les deux Etats s’y retrouvent, et qu’il est finalement une manifestation ultime de la configuration politique complexe qui lie et oppose à la fois les deux îles … et les deux peuples ?
La nature de la violence et ses conséquences en matière d’utilisation de la force
Le rappel de ces racines et de cette configuration de la conflictualité a son importance, car elle nous permet de comprendre pourquoi la très grande violence[12] qui a sévi de 1969 à 1999 en Irlande a toutes les caractéristiques de la guerre et quasiment aucune de ce que l’on appelle généralement le « terrorisme », englobant ainsi dans un flou trompeur des situations qui n’ont pas grand-chose en commun. L’Armée Républicaine Irlandaise était bien, comme son nom l’indique, une organisation de type guerrier, et ceci au moins depuis la guerre anglo-irlandaise, à la fois dans ses objectifs (la création d’une République en Irlande) et ses actions. La violence qu’elle a produite, essentiellement dirigée contre l’Etat britannique, a toujours eu un caractère stratégique et politique. C’est pourquoi la seule organisation de force susceptible de lui faire face était l’Armée britannique, car l’organisation militaire est la seule capable d’agir dans – et de résister à – la montée de la violence aux extrêmes.
De plus, dans le cas particulier de l’Irlande du Nord, qui est une partie du Royaume-Uni, le « modèle » de maintien de l’ordre et de lutte contre la violence n’envisage que deux types de forces : la première correspond à ce que nous appelons la « police » – au sens organique – qui est une organisation de type civil et non professionnel dédiée à la lutte contre la criminalité et au maintien de l’ordre non-insurrectionnel ; la seconde est que nous appelons « l’Armée », c’est-à-dire l’instrument militaire, qui peut soit aider le pouvoir civil soit le remplacer en cas de nécessité de lutter contre une violence insurrectionnelle, ou de faire la guerre. Le Royaume-Uni ne possède pas de forces de « deuxième catégorie » comme la Gendarmerie mobile ou les Compagnies Républicaines de Sécurité françaises, dont la caractéristique est d’exercer la « profession de maintien de l’ordre »[13].
Aussi à lire : Comment finir une guerre civile ?
L’apaisement (relatif) des tensions et de la violence en Irlande du Nord à partir de la signature de l’Accord de 1998 ne relève pas de la « victoire contre le terrorisme », comme cela est souvent analysé. Il est donc impossible d’en tirer de quelconques recettes dans « la lutte contre le terrorisme », que ce soit pour le futur de l’Irlande du Nord ou pour ailleurs. On doit ainsi plutôt selon nous rattacher cet apaisement, ce règlement, à une évolution de la considération de la nature de la conflictualité par les autorités politiques britanniques d’une part ; c’est-à-dire notamment de l’identification de ses causes, de ses enjeux, de ses acteurs, de son caractère acceptable ou non, en d’autres termes de son caractère « politique » (et non pas de ses caractéristiques techniques) ; c’est pourquoi il est impossible d’envisager de façon abstraite et générale « la lutte antiterroriste ».
Considérons la guerre dans le sens politique que lui donne Clausewitz : il s’agit tout d’abord d’« un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à sa volonté »[14]. Mais il précise immédiatement que cette violence est avant tout un moyen en vue d’une fin (« imposer notre volonté à l’ennemi »). Et que « pour atteindre cette fin en toute sûreté il faut désarmer l’ennemi ». Ainsi « la guerre n’est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une poursuite des relations politiques, une réalisation de celles-ci par d’autres moyens »[15].
Le séparatisme violent et la contestation violente de l’ordre politique de l’Etat sont des déclinaisons internes de la guerre : ils ont en commun avec elle le caractère stratégique : la violence y constitue un moyen de négociation. Ils ont aussi en commun avec elle la propension à la montée aux extrêmes dans l’affrontement : la violence y constitue à la fois l’établissement et la manifestation de la capacité de puissance. Enfin, ils ont en commun avec la guerre le caractère politique : par ces deux dernières dimensions de la puissance et de la stratégie, la guerre est « la continuation de la politique par d’autres moyens ». Face à la contestation ultra violente de son principe même d’existence par un adversaire motivé et organisé, l’Etat est légitime à rendre coup pour coup, voire à réduire et éliminer son ennemi, fut-il « interne », fut-il « citoyen ». Le problème est ensuite de savoir jusqu’où la guerre peut mener en termes de stratégie politique.
Ces observations débouchent d’autre part sur une réflexion à propos des instruments de force les mieux adaptés à la gestion de ce conflit, voire de ce type de conflit : Pour l’Irlande du Nord, la plupart des analyses sur ce sujet mettent en avant le caractère problématique de l’usage de la force militaire comme outil principal de gestion de la conflictualité de 1969 à 1998. Ces analyses, qui font l’impasse sur la réalité de l’Irlande du Nord en tant qu’espace ethniquement structuré et divisé[16] (y compris le système de maintien de l’ordre), relèvent de la doctrine classique qui oppose l’impasse de la « solution militaire » à la nécessité de la « solution politique ». En réalité, nous pensons que la question n’est pas de parler de « solutions » ni d’opposer le militaire et le politique mais de reconnaître que les forces armées constituent, dans le cas de violence insurrectionnelle et/ou guerrière, en particulier dans une société ethniquement divisée, l’un des instruments fondamentaux de la réponse politique à l’agression de l’ordre étatique. Ceci ne s’entend pas uniquement en termes de capacité de violence : en effet, les institutions, en tant que bras de l’Etat, ont un caractère national et laïque, dans le sens à la fois de réceptacle et de véhicule de ses valeurs fondamentales. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le système militaire, qui est entendu de façon instrumentaliste comme acteur d’une fonction centrale et globale visant à garantir la défense d’intérêts et de valeurs qui sont constitutifs de la prééminence de l’Etat et de la démocratie.
Aussi à lire : À propos de la guerre civile. La stasis de Corcyre (Thucydide, III, 82)
Ainsi entendu, le système militaire, souvent perçu comme outil d’exception exclusivement dédié à l’ascension aux extrêmes, peut-il être un outil de stabilisation et d’intégration. C’est par exemple l’un des sens de la création de l’Ulster Defence Regiment en Irlande du Nord en 1971[17]. Il n’est pas possible de faire état ici des théories dites du Nation-building (correspondant en France au lien Armée/Nation) développées notamment à propos de l’usage de l’instrument militaire comme intégrateur. Il faut noter cependant que dans le contexte de radicalisation des menaces ethniques ces conceptions ont été rediscutées, par exemple au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, notamment par les sociologues militaires (surtout américains) à propos des interventions dans les zones conflictuelles ou effondrées.
Cette vision est complètement en contradiction avec les politiques menées ici ou là (et notamment en Europe) sous la houlette de diverses institutions internationales, et consistant à établir ou laisser s’établir des structures politiques à fondement confessionnel ou ethnique (y compris les forces de sécurité). Elle est en effet parfaitement étrangère aux dirigeants et aux commentateurs politiques pétris de la conception post-guerre froide de « la paix par le droit », dont les principes ont dominé et dominent encore en Europe. Dans ces cercles, le dénigrement de l’instrument militaire – en tant que force de maintien de l’ordre, de transmission des valeurs, et de reconstruction des structures politiques – est la règle. C’est probablement une tendance lourde de la pensée européenne qui ne va pas dans le sens du règlement des conflits par l’Europe sur son propre territoire. Or, la culture militaire a montré maintes fois sa pertinence en situation de crise[18], pour plusieurs raisons. Cette culture permet tout d’abord de donner un sens à l’action, car il s’agit d’un système de valeurs appuyé avant tout sur la primauté du collectif – d’où découle le sens du service et du sacrifice – sur le principe de neutralité et sur le professionnalisme de l’usage de la force. L’emploi de la force militaire participe d’une délégation de la nation et non pas de telle ou telle communauté, de telle ou telle organisation ou de tel ou tel intérêt, distinguables de ceux de l’État-nation ; c’est là la marque de l’identité militaire, qui sous-tend le principe d’impartialité et qui conduit notamment les forces armées à recruter des citoyens et non des individus situés communautairement. Au-delà, les caractéristiques de l’organisation militaire (hiérarchie, discipline, disponibilité, adaptabilité, formation et entraînement permanents) sont considérées comme cruciales pour l’efficacité de l’usage maîtrisé de la force, objectif aujourd’hui fondamental dans nos sociétés européennes fortement divisées, volatiles et médiatisées.
C’est pourquoi, contrairement à une croyance assez fermement ancrée dans les psychés idéalistes dominantes dans le champ de l’analyse politique – en particulier depuis la fin de la guerre froide – dans les pays libéraux-démocratiques, l’instrument le plus adapté à la lutte contre la contestation violente et séparatiste de l’ordre politique a souvent été – et restera probablement – l’instrument militaire, le plus souvent dans son format professionnel[19]. L’ « Accord du Vendredi Saint » n’aurait jamais pu être envisagé sans la participation majeure des forces armées britanniques à la longue reconquête de la paix civile en Irlande du Nord.
À lire aussi : David Galula, le théoricien de la contre-insurrection
[1] Good Friday Agreement, 1998
[2] Voir par exemple Daniel Pipes et Teri Blumenfeld, « Le terrorisme : un concept indéfinissable », The Washington Times, 24 octobre 2014, mais aussi Daniela Pisoiu et Sandra Hain (dir), Theories of terrorism, 2017, Routledge, London, 2017.
[3] Daniel Pipes et Teri Blumenfeld, op.cit.
[4] Ils précisent bien sûr « au regard de la loi américaine », mais on pourrait dire la même chose ailleurs qu’aux Etats-Unis.
[5] Terrorism and Counterterrorism ou Counterinsurgency.
[6] Remarquablement évoquée dans la récente série télévisée de Colin Teevan, « Rebellion » (2016-2019).
[7] Suite à l’échec du Home Rule qu’avaient promis les Whigs.
[8] C’est-à-dire en référence à l’Union avec la Couronne britannique.
[9] Anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell, Oxford, 1986
[10] Voir Anne Mandeville, « Le Brexit en Irlande du Nord : le changement dans la continuité ? », in L’Action Nationale (Québec), Décembre 2019
[11] Voir le discours de la Deputy Leader de Sinn Féin Michelle O’Neill à la conférence du Parti en 2019 le 16 novembre 2019 à Derry
[12] Toutes choses étant égales par ailleurs. Comme l’écrit très justement James B. Steinberg, si nous raisonnons seulement en chiffres absolus (ceux des morts et des blessés « dus au conflit ») et que nous les comparons à ceux des tragédies du 20e siècle, « l’ampleur du conflit peut sembler faible (…). Cependant, sa durée, 30 ans, et son impact – non seulement en Irlande du Nord, mais aussi sur la République d’Irlande, le Royaume-Uni et même les Etats-Unis – justifie largement la valeur que l’on attache à la signature de la paix ». James B. Steinberg, « The Good Friday Agreement: Ending War and Ending Conflict in Northern Ireland », The Strategist, Texas National Security Review, Volume 2, Issue 3 (May 2019), p. 79.
[13] Et qui en ce sens se rapprochent des militaires, qui sont qualifiés de professionnels de la violence.
[14] Carl von Clausewitz, De la guerre, Les éditions de minuit, 1959, p. 51.
[15] Ibidem, p. 67. Il ajoute que « ce qui reste toujours particulier à la guerre relève purement du caractère particulier des moyens qu’elle met en œuvre. L’art de la guerre en général, et du commandant dans chaque cas d’espèce, peut exiger que les tendances et les intentions de la politique ne soient pas incompatibles avec ces moyens, exigence non négligeable, assurément. Mais aussi puissamment qu’elle réagisse en certains cas sur les intentions politiques, cela doit toujours être considéré seulement comme une modification de celles-ci ; car l’intention politique est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin ».
[16] Voir Anne Mandeville, Le système de maintien de l’ordre du Royaume-Uni : modèle européen ou exception culturelle ?, Publibook, Paris, 2015 et 2016.
[17] Voir Anne Mandeville, « Format organisationnel et violence d’Etat : le cas de l’Ulster Defence Regiment en Irlande du Nord » in Philippe Braud (dir), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, L’Harmattan, 1993, pp. 205-227.
[18] Voir Anne Mandeville, « The role of Armed Forces in Human Security. Elements for a systemic analysis of a ‘military model’ in global policing », rapport présenté à la première conférence de l’HUMSEC, Human Security, Terrorism and Organized crime in the Western Balkan Region, Ljublana, 25 novembre 2006. Voir aussi du même auteur « Sécurité, citoyenneté et système de maintien de l’ordre européen », Revue de la Gendarmerie Nationale, juin 2008, n° 227, pp. 69-78.
[19] Encore que le cas d’Israël par exemple, où le format demeure la conscription générale, puisse apparaître comme une exception à cette règle.