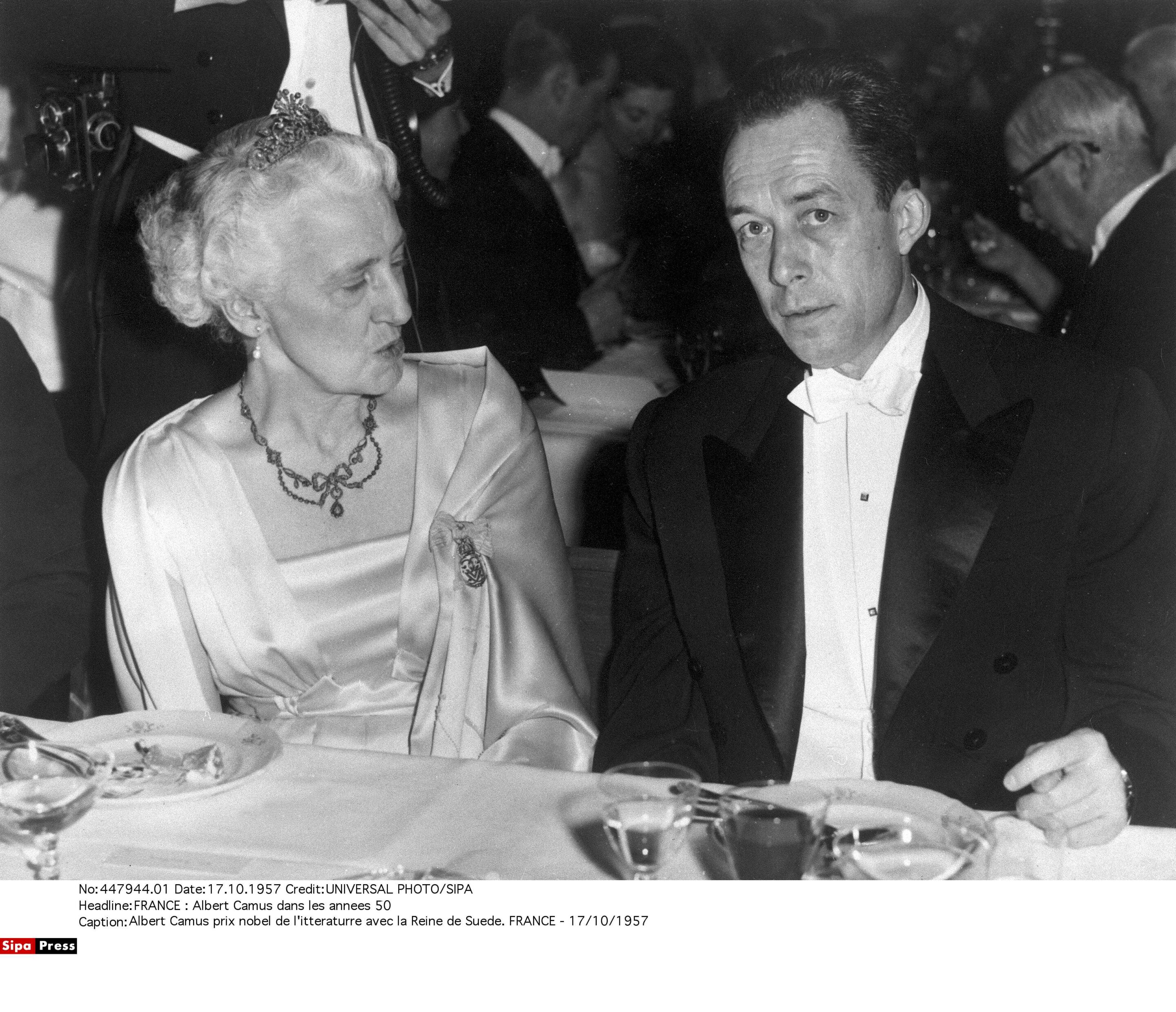Dans le domaine de l’art, les Etats-Unis ont-ils encore l’avantage de l’hégémonie ? Deux ouvrages viennent remettre en cause cette idée.
Les meilleurs soft powers du monde sont anglo-saxons, les pires sont ceux de la Chine et de la Russie. C’est ce que l’on apprend en consultant le Top 30 des soft powers du monde, publié tous les ans par l’USC, Center on Public Diplomacy et le cabinet de conseil Portland. Les critères qui y président semblent plus appartenir à l’ordre du classement entre vertueux et peccamineux que puissants où faibles, ce qui donne à penser que ces palmarès sont plus un travail d’influence que de connaissance. Pour examiner la situation d’un peu plus près, viennent de paraître en 2019 deux livres qui évoquent le sujet.
Le premier est celui de Nathalie Obadia, galeriste parisienne réputée, admise dans le premier cercle du marché international de l’Art contemporain, adoubée par la Foire de Bale, enseignante à Sciences Po : Géopolitique de l’Art contemporain : une remise en cause de l’hégémonie américaine ? [simple_tooltip content=’Géopolitique de l’Art contemporain – Une remise en cause de l’hégémonie américaine ? Nathalie Obadia, Ed. Le cavalier Bleu, Paris 2019′] 1[/simple_tooltip] Le livre est paru le 15 mars, date où sont publiés les bilans du marché de l’art de l’année précédente et moment convenu pour les médias d’évoquer les performances internationales. Elle y pose la question et y répond : pourquoi et comment l’Amérique exerce encore un pouvoir hégémonique sans faille ni concurrence en 2019.
Le pouvoir de l’Amérique
Chaque année, Nathalie Obadia participe aux foires les plus prestigieuses du monde, cet essai est donc instructif parce qu’il informe sur le point de vue et le discours sur lui-même du très haut marché. Il donne quelques clefs sur l’art global, visible du monde entier, intensément relayé par les médias. L’auteur qualifie clairement cet « Art contemporain » international de « soft power », de « marqueur de puissance » politique de l’Amérique. Cet art étant devenu hégémonique après la chute du mur de Berlin. Au cours des trente années qui ont suivi la disparition d’un monde bipolaire, l’ACI [simple_tooltip content=’ACI, acronyme de Art contemporain international, permettant de faire la différence entre tout l’art d’aujourd’hui et un produit financier international, obéissant à des critères spécifiques, non esthétiques.’] 2[/simple_tooltip] a inclus tous les continents dans sa boucle de consécration d’artistes incarnant une identité « globale ».
L’interconnexion et organisation de ce cercle international de l’art sont décrites. Tout particulièrement la chaîne de fabrication de la valeur des produits artistiques : collectionneurs, salles des ventes, foires, galeries internationales, institutions publiques et privées : « Une fois que l’objet d’art est identifié comme portant les attributs symboliques, il lui reste à être reconnu comme une valeur d’échange au sein d’un marché de l’art organisé autour de l’acheteur-collectionneur placé au centre du système économique » [simple_tooltip content=’P.135′] 3[/simple_tooltip]. Elle définit l’Art contemporain, raconte son histoire, les fondements de sa légitimité, son éthique. Sont aussi évoquées des menaces que connaît aujourd’hui ce système, devenu presque parfait, mais commençant à connaître les inconvénients de son triomphe : concurrence entre foires, difficulté de renouvellement des œuvres, des collectionneurs, etc.
Elle note que tout ce qui n’est pas labellisé « Art contemporain international » n’est pas vraiment de l’art d’aujourd’hui, mais un anachronisme, un manque de créativité, une expression locale, ne pouvant pas de ce fait acquérir une valeur monétaire significative.
Certes « l’hétérogénéité des marchés existe, mais son impact est encore marginal ». Seul le marché international de l’Art contemporain propose des produits qui ont « plus qu’une valeur de luxe classique, une valeur d’échange » [simple_tooltip content=’P.184′] 4[/simple_tooltip]… un pouvoir libératoire en quelque sorte. Il n’existe donc aujourd’hui aucune concurrence au système de l’Art contemporain.
L’arrivée des Chinois
Elle évoque cependant le problème posé par la Chine. Il est vrai que depuis dix ans celle-ci est en tête du marché de l’Art ou à égalité avec les États-Unis, les Chinois sont par ailleurs des acheteurs importants d’Art contemporain américain, ce qui a son poids. Si l’hégémonie américaine est aujourd’hui remise en cause, c’est principalement à cause de la politique chinoise qui a été de créer ex nihilo les infrastructures et institutions nécessaires à l’existence d’un marché de l’art [simple_tooltip content=’La Chine joue sur tous les tableaux l’art et l’Art contemporain, ce qui est un réel danger pour le système.’] 5[/simple_tooltip]. Mais, contrairement à l’Europe pendant la guerre froide culturelle, la Chine ne semble pas se plier totalement aux règles américaines et joue méthodiquement double jeu [simple_tooltip content=’Sauf en 2018 ou elle se trouve au 3e rang’] 6[/simple_tooltip].
A lire aussi: La pomme. Le territoire et la table
Ainsi Nathalie Obadia souligne l’observance partielle par les Chinois des labels internationaux, ce qui expliquerait son isolement : « L’Empire n’est pas devenu un modèle culturel pour ses pays voisins et élites chinoises. Par ailleurs, « c’est une dictature » non conforme aux règles de moralité politique. Il en résulterait un manque de « créativité » artistique, excepté pour les artistes venus s’installer à New York ou en Europe. Certes, ils créent de très nombreux musées, mais pas dans l’esprit de ce que doit être aujourd’hui un musée : un lieu de diffusion des idées globales : « un réceptacle des préoccupations sociétales », où sont défendues les « valeurs », liées au genre, climat, racisme, immigration.
Les Chinois se permettent de consacrer au-dessus du million de dollars [simple_tooltip content=’En 2018, l’Amérique est en tête et la Chine au 3e rang du marché de l’art, après dix ans de supériorité ou égalité de la Chine avec l’Amérique.’] 7[/simple_tooltip], non seulement de « l’Art contemporain », mais aussi la suite de leur art civilisationnel, lui faisant acquérir ainsi une visibilité indue… les collectionneurs chinois ne suivent pas l’exemple de nos très grands collectionneurs français, ils ne soutiennent pas seulement les produits internationaux, mais aussi leurs artistes chinois non conformes au label ACI.
Nathalie Obadia conclut : « il n’y a pas d’alter ego au soft power américain ». La raison principale est éthique. « L’Art contemporain » international est fondé sur des valeurs universelles. Grâce à ce vecteur, l’Amérique [simple_tooltip content=’N. Obadia parle tout au long de son livre de « soft power Américain » ce qui n’est plus tout à fait juste aujourd’hui en ce qui concerne le domaine particulier de « l’Art contemporain », il faudrait dire soft power New Yorkais ou plus exactement « soft power financier global ».’] 8[/simple_tooltip] prend en charge les grandes causes humanitaires, elle se donne pour mission de protéger le climat et les « diversités » : minorités sexuelles, sociales et ethniques, en écartant pour cela les diversités civilisationnelles de l’art qui sont un danger identitaire, facteur de guerre. D’autres raisons factuelles sont évoquées : la domination sans rival des médias internationaux anglo-saxons, monopole qui permet de rendre invisibles les arts non conformes aux labels ACI.
Dans cet essai qui confirme la non-concurrence de la Chine et l’hégémonie vertueuse de l’Amérique, Nathalie Obadia n’évoque pas les effets de la révolution numérique qui, depuis plus de dix ans, ont changé silencieusement les rapports de force établis, en créant d’autres marchés, fondés sur d’autres principes et motivations. L’auteur ne semble pas attacher d’importance aux nouveaux rapports qui se tissent aujourd’hui entre local et global.
La Chine va-t-elle dominer l’art contemporain ?
Un deuxième livre est paru en juin 2019 et pose la même question, mais d’un point de vue différent :« Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Soft power et Sharp Power » [simple_tooltip content=’Chine une Nouvelle puissance culturelle-Soft power et Sharp Power. Emmanuel Lincot, MkF éditions, Paris, 2019′] 9[/simple_tooltip]. L’auteur est un universitaire, géopolitologue de la Chine, dont une des spécialités est l’art et la culture qu’il perçoit avec nuance, car il parle le chinois et a séjourné longuement en Chine.
A lire aussi: La guerre des arts au début du XXIe siècle
Observateur au long cours, il a assisté aux métamorphoses de la Chine passée progressivement du totalitarisme sanglant, du chaos, de la famine, à un système autoritaire, avec des zones circonscrites de liberté, une prospérité et des frontières ouvertes. Il a vu les Chinois retrouver l’estime d’eux-mêmes, il constate que la réappropriation de leur art et culture n’y est pas pour rien. Il relève le lien stratégique fait par les dirigeants chinois entre culture et économie. Ils ont mis au centre de leur politique le retour aux valeurs civilisationnelles et spirituelles. Ils ne se veulent pas soumis à l’Occident, mais concurrents, ce qu’ils trouvent légitime parce qu’héritiers d’une grande civilisation. De là découle une fabrication urgente d’une histoire positive, d’une célébration légendaire tendant à effacer les moments tragiques et récents de l’histoire, à produire d’urgence tout ce qui avait disparu, esthétique, culture, divertissement, art, afin que le vide ne provoque pas l’envahissement total de l’industrie du divertissement américain. À mesure que les décennies passent, la Chine s’affirme et ne veut pas seulement se protéger, mais aussi rayonner.
Ainsi est née en 2013 la « Route de la soie », économique et culturelle. La Chine n’entend pas dominer le monde par un soft power à l’américaine, avec la martingale langue-way of life-consommation-divertissement-connexion numérique internationale, elle veut exister comme civilisation différente, tenir son rang, échanger à égalité.
C’est la raison pour laquelle elle choisit de peser dans les domaines de l’art, du patrimoine, des savoir-faire d’excellence… ce qui ne va pas sans risques pour la Chine, comme le note Emmanuel Lincot, car cette démarche soulève de multiples contradictions.
Le jeu est subtil et relève d’une forme de pensée familière aux Chinois, peu logique au gout des Occidentaux : pensée analogique et vision du monde où se produit un éternel mouvement de mariage entre les opposés, le ying et le yang. Autorité et libertés n’y sont pas incompatibles, art et « Art contemporain » non plus.
Pour répondre à la question posée sur l’hégémonie américaine, ces deux essais donnent au curieux plus d’éléments que le Top 30-2019 des soft powers du Center of Public Diplomacy qui a au moins le mérite de nous prouver que nous sommes les témoins d’une nouvelle guerre culturelle. La « Pax americana », l’hégémonie culturelle, n’aurait-elle duré que vingt ans ?