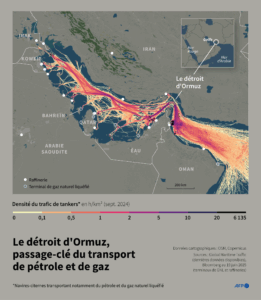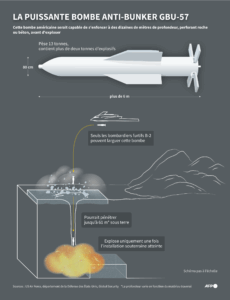Tout allait bien pour les républicains et moins bien pour les Américains : une inflation galopante, un président impopulaire, un pays qui doute… Les élections de mi-mandat promettaient une raclée aux démocrates, elles pourraient finalement accoucher d’un réajustement moins pénible que prévu pour la gauche au pouvoir au Congrès et surtout mettre un coup d’arrêt à la potentialité d’une candidature de Donald Trump à la présidentielle de 2024. Encore une fois, les électeurs indépendants dessineront l’avenir d’une Amérique toujours en proie à la division.
Non, les midterm ne sont pas les législatives des Américains. Elles sont un peu cela, puisqu’il s’agit d’élire des membres du Parlement, mais très peu cela, car il n’y a pas à proprement parler de cohabitation à la française, et elles sont bien plus que cela. Mêlant scrutins nationaux (l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu ainsi qu’un gros tiers du Sénat, soit 35 élus à la Chambre haute) et locaux (36 postes de gouverneurs sur 50 doivent être désignés au suffrage universel et c’est sans compter les multiples autres scrutins, allant du shérif du coin au référendum le plus improbable), les midterm sont un thermomètre de la satisfaction des Américains quant à la conduite de l’administration en place depuis deux ans.
A lire également :
États-Unis, forces et faiblesses d’une puissance
Thermomètre de mi-mandat
Autant le dire, le suspense est historiquement rare aux élections de mi-mandat : le parti du président en place fait occasionnellement un score correct et quand le locataire de la Maison-Blanche limite la casse, ce seul résultat ressemble à une performance, voire à une victoire. Car, depuis plus d’un siècle, seules quatre élections de mi-mandat ont renforcé en nombre de sièges au Congrès le parti du chef de l’État (1934, 1962, 1998, 2002) et encore se sont-elles déroulées dans des contextes de crise : la Grande Dépression, celle des missiles cubains, la deuxième guerre du Golfe ; 1998 restant une exception, le Parti républicain ayant été sans doute sanctionné pour son acharnement judiciaire contre Bill Clinton dans l’affaire Lewisnky. L’Amérique de 2022 est certes en crise : l’inflation est bien réelle et même la baisse récente et forte du prix du pétrole ne semble pas l’avoir encore enrayée à temps pour que le sujet soit de second ordre au cours des élections (le coût de l’énergie a progressé de plus de 24 % en un an et les prix des denrées alimentaires, des loyers et des primes d’assurances santé privées ont augmenté en moyenne d’une dizaine de points) ; l’implication de l’Amérique dans le conflit ukrainien est une réalité qu’on peut mesurer essentiellement à la profusion de reportages télé sur le sujet, mais cette guerre reste lointaine dans l’imaginaire des électeurs qui vivent, au plus près, à 8 000 km d’un pays dont la plupart ignoraient encore l’existence il y a quelques mois.
La vraie différence cette année est la présence – ou plutôt l’omniprésence – de l’ancien président des États-Unis. Donald Trump, tout à la fois figure d’un Parti républicain qu’il a métamorphosé en formation populiste championne des thématiques identitaires depuis ses premiers pas en politique en juin 2015, leader autoproclamé d’une opposition nationale à des démocrates acquis pour la plupart à l’idéologie wokiste, et candidat putatif à une revanche en 2024 pour laver une défaite qu’il n’a, à ce jour, encore pas reconnue (sauf en quittant la Maison-Blanche sans la moindre passation de pouvoir). Une situation insolite dans un pays où les perdants ne refont presque jamais surface : il avait fallu quatre ans après le triomphe de Ronald Reagan pour que Jimmy Carter sorte du silence et George Bush père, battu lui aussi après un seul mandat en 1992 dans une étrange triangulaire aussi meurtrière qu’humiliante, s’était effacé des carnets mondains du Parti républicain dont on devinait déjà à l’époque – chute du communisme aidant – qu’il allait devenir le bébé de ceux qu’on appellerait les néoconservateurs.
Le cas Trump
Éjecté des réseaux sociaux après l’assaut contre le Capitole mené par une poignée de ses partisans les plus radicaux et les plus folkloriques, le 6 janvier 2021, Donald Trump est pourtant partout sur le terrain. Ubiquiste, le 45e président des États-Unis est d’abord de tous les meetings de précampagne pour soutenir ses favoris dans les primaires les plus disputées faisant tout pour faire perdre, parfois avec succès, ses propres ennemis républicains comme Liz Cheney, la fille de l’ex-vice-président de George W. Bush, défaite dans le Wyoming après avoir été accusée de traîtrise par les fans du milliardaire américain (et avoir participé à la commission d’enquête au Congrès sur la responsabilité de Trump dans l’attaque du Capitole). Il est ensuite le fantôme bien commode des médias américains qui n’aiment rien tant que le détester : son nom continue de générer plus de clics sur Google que celui de Biden, la moindre interview de lui se transforme en chasse à la punchline dans l’espoir de faire un peu d’audience, et les développements judiciaires de sa vie de retraité floridien ressemble à une série Netflix avec ses épisodes à suspense, le dernier en date étant celui de la perquisition de son domicile de Mar-a-Lago et la saisie, par des agents du FBI, de milliers de documents secrets, dont la teneur et l’importance n’ont pas encore été dévoilées, mais dont on devine qu’ils passionneraient autant la presse américaine de gauche que l’électeur moyen curieux de savoir ce que recelait le coffre-fort de Trump. Pas sûr pourtant que la trumpisation du Parti républicain et, par là même, de la campagne des midterm, soit forcément une bonne chose pour la droite américaine et pour son champion lui-même. Car rien, pour l’instant, ne se passe comme prévu dans cette campagne comme si Trump, lui-même, faisait buguer ce scrutin à la mécanique d’ordinaire bien huilée. La vague rouge pourrait devenir une petite flaque et le reflux ne pas être assez important pour faire tomber le Sénat (de loin la Chambre la plus importante du Congrès).
Et pourtant ! Biden a beau multiplier la signature de « chèques » pour soigner sa gauche (le plus polémique est celui portant sur l’annulation d’une vingtaine de millions de prêts étudiants concernant des sommes allant jusqu’à 12 000 $ par bénéficiaire !) ou pour aider Kiev à chasser l’armée russe (des dizaines de milliards de dollars sont partis du portefeuille du contribuable américain pour payer du matériel militaire, mais également pour financer les pensions et les soins de santé de certains Ukrainiens dont le gouvernement agite ponctuellement l’état de quasi-faillite), ou encore s’agiter avec force, en se posant en défenseur des droits des femmes, après l’annulation fracassante de l’arrêt de la Cour suprême Rade v. Woe, son action est jugée encore très négativement par les Américains. Ces derniers n’attendaient en 2020 peut-être pas grand-chose de lui… si ce n’était de ne pas être Trump.
Sur les marches du Capitole, deux semaines seulement après l’assaut, le président démocrate, alors tout juste investi, avait pourtant promis de réconcilier les Américains, divisés par la gestion catastrophique du Covid (qui a tué à ce jour plus d’un million d’entre eux !), par une élection sans campagne que beaucoup à droite de la droite estiment, aujourd’hui encore, frauduleuse, sur la question raciale (le mouvement Black Lives Matter était encore dans les rues des grandes villes démocrates à brûler mobilier urbain, voitures, et à demander, violemment le plus souvent, des réparations aux Blancs). Cet engagement à l’unité, venant d’une personnalité politique jugée depuis toujours centriste au sein du Parti démocrate, a fait long feu. Les wokistes des grandes agglomérations du pays, poussés par une aile gauche américaine toujours plus caricaturale sur les débats de société, ont eu raison de sa légendaire modération. Tous les ingrédients d’une vague rouge submergeant le Congrès étaient réunis pour faire de ce chapelet d’élections une promenade de santé pour les républicains. Il suffisait, pensait-on naïvement au début de l’été, de répéter les éditos télé de Tucker Carlson (une sorte de Zemmour américain officiant sur Fox News, pressenti également pour être candidat à la primaire républicaine de 2024), c’est-à-dire de parler du prix de l’essence à la pompe, des programmes scolaires remis au goût historiographique de l’extrême gauche, de la fragilité de la Pax Americana mise à mal par l’interventionnisme démocrate en Europe et, logiquement, le Grand Old Party pouvait triompher sans coup férir, tout en privant Joe Biden, promis à une retraite anticipée, d’une fin de mandat honorable, voire d’une potentielle candidature à la réélection. Bref, on allait préparer sereinement le retour annoncé, depuis son exil politique et fiscal sous le soleil de Palm Beach, de Trump.
A lire également :
L’hypocrisie, arme de destruction massive des États-Unis
Usure du trumpisme
Or, rien n’est logique dans ces midterm. Trump intéresse encore les médias, rassemble des foules considérables à chacun de ses meetings : oui, c’est vrai. Mais il fatigue l’électeur moyen (the common man), notamment l’électeur indépendant (un peu plus de 40 % du corps électoral américain) dont le suffrage lui avait tant fait défaut en 2020 (souvenons-nous de ses déclarations d’amour tardives aux femmes des banlieues américaines, qui lui préféraient Biden : « Please, suburban women… Please, love me ! »). Car, voilà, un certain nombre d’indices indiquent une forme de lassitude chez les indépendants dont l’ensemble des sondages montre que, s’ils désapprouvent l’action du président américain, ils penchent plutôt pour les démocrates au Congrès. Quatre élections intermédiaires – la première en Alaska, la deuxième dans le Minnesota et les deux autres dans l’État de New York – ont, à la fin de l’été dernier, donné la victoire à des candidats démocrates. Avec des cas emblématiques. En dépit (ou à cause) du soutien apporté par Donald Trump, en Alaska, Sarah Palin, ex-figure droitière du ticket républicain à la présidentielle de 2008, a été sèchement battue par Mary Peltola pour l’unique siège de cet État très conservateur à la Chambre des représentants (siège qu’elle occupera jusqu’au 8 novembre puisque, quelles que soient les circonstances de ces élections intermédiaires, tous les élus doivent remettre en jeu leur mandat, même ceux investis depuis quelques semaines). Autre coup dur : dans le 19e district de l’État de New York, au sud de la capitale Albany, sur un territoire remporté par Trump en 2016 (mais acquis par Biden en 2020), c’est encore un démocrate qui a remporté le siège de représentant au Congrès à la surprise générale, dans une circonscription de la classe moyenne et blanche à 85 %. Ce district congressionnel a la réputation d’être toujours raccord avec la couleur politique nationale du moment. Autant de marqueurs qui donnent des sueurs froides aux républicains : et si le trumpisme empêchait de faire une campagne digne de ce nom ? Quel programme économique, dans une Amérique aux frontières de la récession, porte aujourd’hui la droite américaine dont la plate-forme ressemble de plus en plus à un applaudimètre géant pour l’ancien président ? L’idée qu’il suffirait que les républicains scandent dans leurs réunions « on n’est pas Biden » ne séduit plus. Pas davantage que la figure, déjà démodée et usée, de Donald Trump dont les frasques et ennuis ne mobilisent plus guère que ses partisans les plus fanatiques en termes de culte de la personnalité. Et puis, par le jeu des primaires locales, et du système de l’endorsement (approbations publiques, particulièrement appréciées par Trump qui adore les mettre en scène), l’ancien président américain peut avoir compromis les perspectives du Parti républicain dans des États pivots… Contre le candidat choisi par l’ex-vice-président Mike Pence, Trump a ainsi soutenu à la primaire de Pennsylvanie Mehmet Oz, candidat désigné pour l’élection sénatoriale de ce Commonwealth, médecin star animateur de sa propre émission de télé (« Dr Oz »), sorte de gloubi-boulga américain mêlant la science de Michel Cymes et la décontraction de Cyril Hanouna, le tout sur fond de thérapie de choc pour soigner les homosexuels… Sa campagne se montrant à la hauteur de sa réputation : catastrophique. Comme s’il suffisait dans l’esprit de Trump d’avoir été une star à la télé pour se révéler être un candidat sérieux en politique. Idem dans l’Arizona, autre État clé qui avait basculé dans le camp démocrate à la faveur de la présidentielle de 2020, et où Donald Trump a apporté son soutien à Blake Masters, un jeune entrepreneur millionnaire, ancien collectionneur repenti de gaffes antisémites et ayant cité plusieurs fois Goering dans ses discours, conspirationniste et, surtout, totalement inexpérimenté en politique (une règle désormais pour être désigné candidat sous la domination de Trump). Voilà pour le tableau politique d’un parti qui, resté sur l’improbable succès de 2016 d’un homme ayant eu, c’est vrai, un flair incroyable à la présidentielle, a du mal à renouveler ses figures et à faire émerger des personnalités porteuses des thématiques conservatrices (comme la réduction du rôle de l’administration étatique ou du nombre de mandats électoraux) sans le trumpisme dont l’essentiel de la stratégie semble être de vouloir jouer une redite du duel de 2020.
Annoncé comme candidat en 2024 par tous les médias, et tous les experts, Trump est en fait déjà candidat depuis qu’il a quitté dans Marine One le South Lawn de la Maison-Blanche. Mais il pourrait bien ne jamais l’être vraiment. Le processus des primaires qui désignera le champion de la droite américaine en 2024 est long et la multiplicité des primaires aux midterm n’a été, pour lui, qu’une façon d’organiser une répétition générale avec, à la clé, comté par comté, quartier par quartier, là où des candidats trumpistes sont présents, des chiffres qui seront autant de statistiques en faveur ou non de la potentialité, non d’une candidature, mais d’une victoire à la présidentielle. Une vague rouge, et Trump aura assis définitivement son avance dans les intentions de vote aux primaires… Une flaque rose et ce sera plus compliqué pour lui. Déjà, ses plus fidèles soutiens commencent à s’affranchir du rôle de seconds de cordée. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un temps pressenti pour figurer sur le ticket républicain de 2024 en compagnie de Trump, prend ainsi seul son envol, sans attendre les résultats des midterm, fort d’une popularité croissante et misant lui aussi, parfois de manière provocante, sur les thèmes de l’immigration et de la sécurité (il a ainsi envoyé en septembre par avion des dizaines d’immigrants illégaux sur l’île chic de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, lieu de villégiature huppé des démocrates fortunés, dont le couple Obama). D’autres misent au contraire sur le recentrage, au risque de démobiliser les électeurs de l’aile dure du Parti républicain, mais dans le but de faire revenir les indépendants échaudés par la décision de la Cour suprême de remettre en cause la légalité de l’avortement au niveau fédéral et anticipant le peu d’enthousiasme que susciteront les nouvelles gesticulations trumpiennes des mois à venir. Trump lui-même pourrait se présenter aux primaires sans concourir à la première d’entre elles, dans l’Iowa, en février 2024, polluant l’élection jusqu’au bout, et s’assurant d’avoir encore assez d’influence pour peser sur le choix d’un candidat qui lui sera favorable, tout en ne risquant pas ce qu’il craint aujourd’hui le plus : perdre une nouvelle fois et surtout perdre une deuxième fois contre Joe Biden qui, pour l’heure, reste sibyllin sur ses intentions. Pour un homme qui a passé sa vie à vomir tout ce que l’Amérique compte de losers, c’est un pari qu’à 78 ans (l’âge qu’il aura) il pourrait dans une sagesse inédite chez lui ne pas prendre.
A lire également :
Quel avenir pour le trumpisme ?