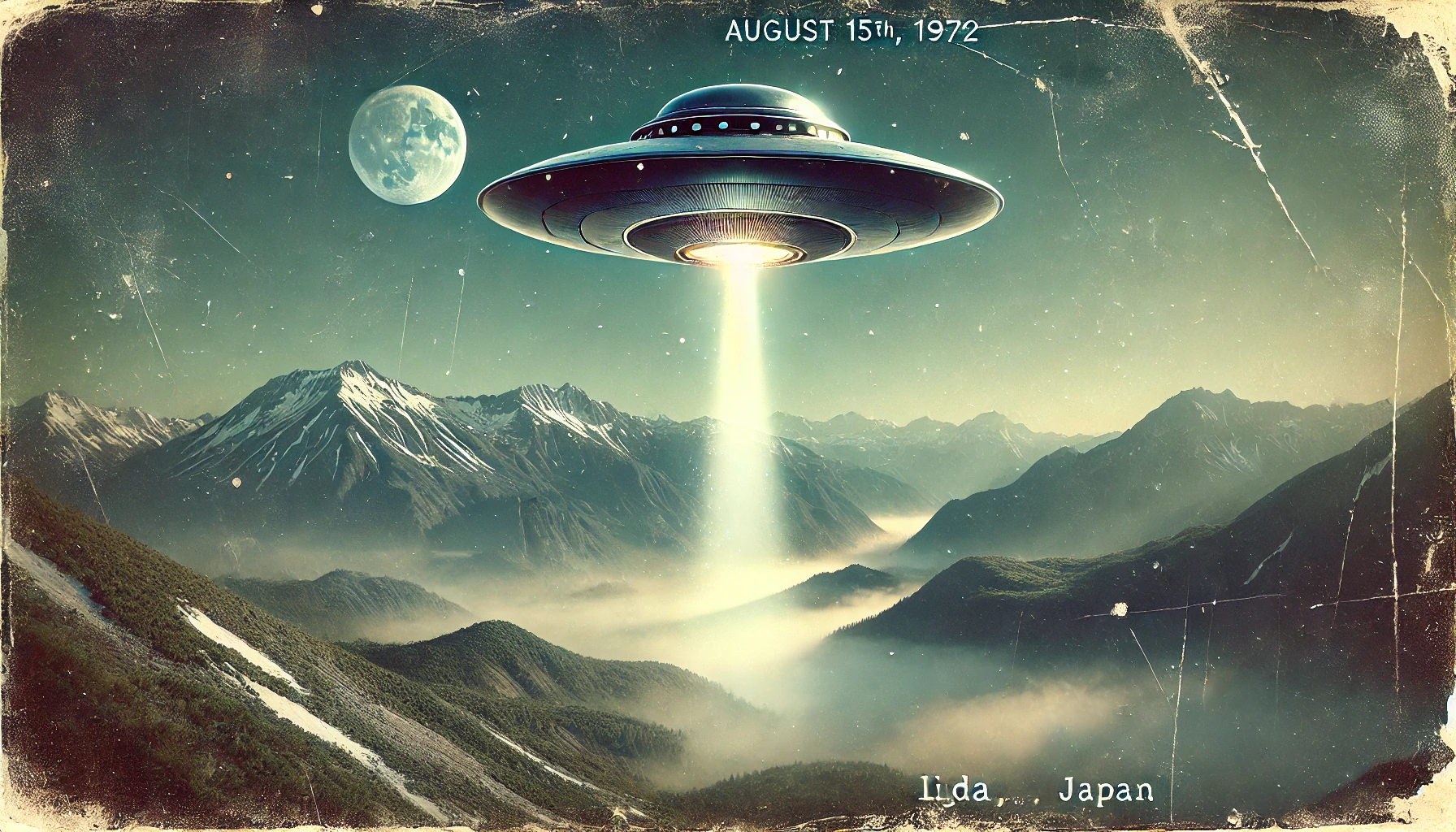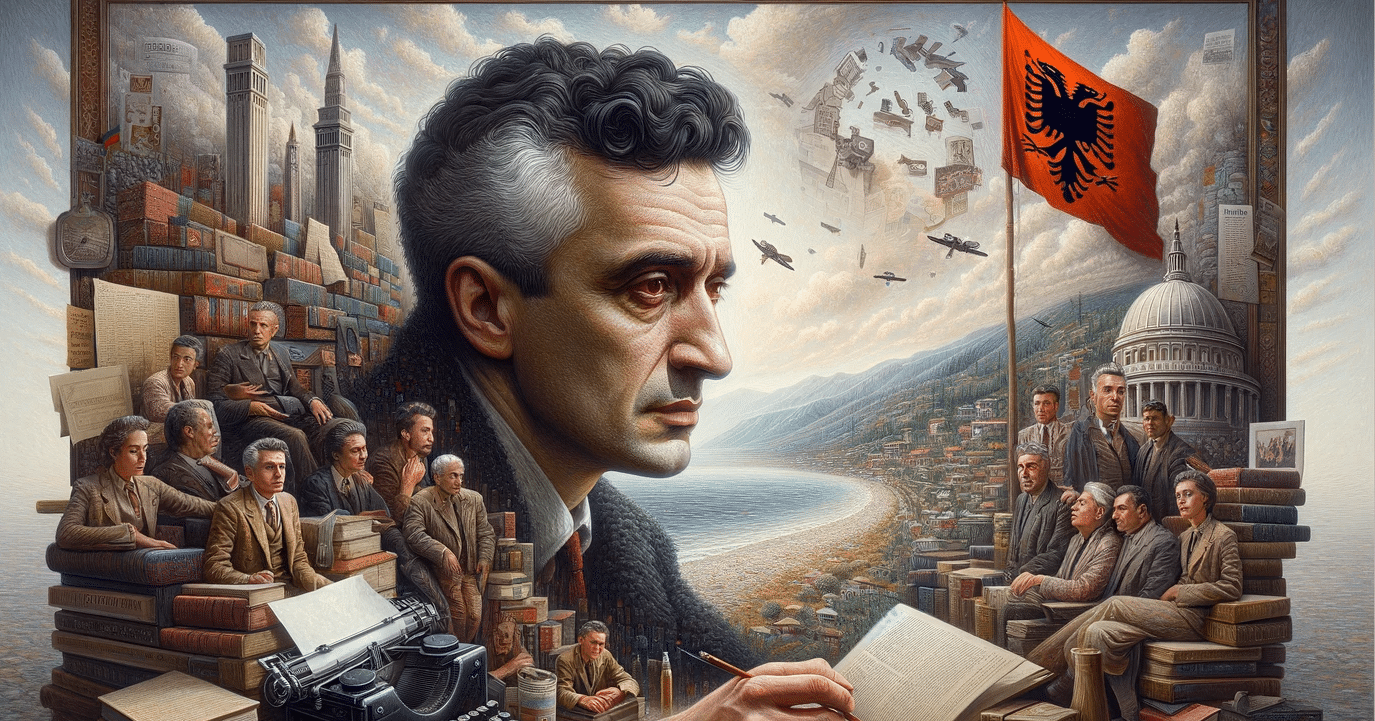Depuis la fin de la guerre froide, la Turquie s’est ouverte sur de nouveaux espaces. Jusqu’alors arc-boutée sur la défense du pré carré anatolien, la politique d’Ankara s’est diversifiée. C’est alors que se développe l’eurasisme turc.
L’eurasisme (Avrasyacilik en turc) présuppose l’existence d’un troisième continent entre Orient et Occident, à la jonction des cultures turque, russe et chinoise. Courant original, l’eurasisme turc transcende le traditionnel clivage laïc-islamiste, occidentaliste-ottomaniste. Il est le fil caché d’une politique étrangère qui souhaite de nouveau peser sur le monde. Plus globalement, l’eurasisme se veut une solution alternative à une mondialisation uniformisatrice.
L’Eurasie : de l’Anatolie à la muraille de Chine…
Pour la Turquie républicaine, les grands espaces d’Asie centrale jouent le rôle de foyer originel. L’étendue infinie de la steppe est l’endroit choisi par le destin où, pour la première fois, s’est manifesté le génie turc. Du sol historique de l’Orkhon, lieu des premières inscriptions turques (VIe siècle, voir carte), émane une force magique. Elle inspire au XXe siècle l’œuvre de Mustapha Kemal (1881-1938), fondateur de la Turquie moderne. Le culte de la turcité rejoint la promotion d’un homme régénéré, de la nation en arme, de la laïcité conçue comme religion civique.
Trois courants proches mais distincts se réclament de ce passé idéalisé : pantouranisme, panturquisme, eurasisme.
À l’origine, Touran est un terme persan qui désigne le Türkestan, « le pays des Turcs ». Dans un sens large, le pantouranisme renvoie à la volonté de réunir les peuples d’idiomes turcs et finno-ougriens (elles ont en commun d’être des langues agglutinantes) [simple_tooltip content=’Une langue dans laquelle les traits grammaticaux sont marqués par l’ajout d’un morphème ou d’un suffixe.’](1)[/simple_tooltip]. Finnois, Estoniens et Hongrois y sont inclus en raison de leurs origines ouralo-altaïques.
A contrario, le panturquisme se focalise exclusivement sur l’union des peuples turcs. Proche des milieux Jeunes-Turcs, il influence au cours de la Première Guerre mondiale les rêves de conquêtes d’Enver Pacha (1881-1922). À partir de 1923, la République kémaliste répudie le panturquisme pour se concentrer sur le réduit national anatolien. Cependant, la chute de l’URSS (1991) provoque de nouveau un regain d’intérêt pour l’Asie centrale.
À la différence du panturquisme, l’eurasisme permet à Ankara d’apparaître comme un partenaire et non comme une puissance expansionniste. Pour les eurasistes, l’histoire est avant tout un arsenal où l’on puise des mythes fondateurs et mobilisateurs. En ce sens, le passé steppique annonce un futur eschatologique.
A lire aussi: Turquie: le pays à cheval
L’infini comme communauté de destin
L’Eurasie renvoie à la conscience d’appartenir à une aire géographie de taille continentale. À la fois espace autarcique et couloir d’invasion, elle unit les civilisations de son pourtour. La steppe, en son centre, permet la rencontre entres peuples nomades. Elle correspond à un type humain spécifique, celui du guerrier à cheval. Le touranien oppose au désir de confort et de bien-être du sédentaire la frugalité et l’audace du conquérant.
Terre d’empires, la steppe a une fonction incubatrice de grands ensembles politiques. Les empires turco-mongols de Gengis Khan (1155-1227) à Tamerlan (1336-1405) constituent autant de points fixes dans la pensée eurasiste. Ces empires relient deux pôles de civilisations, le monde indo-chinois et le monde méditerranéen. « Tamerlan et son Empire sont un produit du Touran. Samarkande est le cœur de la civilisation eurasienne, acné de l’influence turcique [simple_tooltip content= »Ahmet Davutoglu, Stragejik Derinlik, [La profondeur stratégique], Küre, Istanbul, 2008, p. 459.](2)[/simple_tooltip] » écrit Ahmet Davutoglu (1959-), ministre des Affaires étrangères turques.
À la mort de Tamerlan, la dissolution de l’ensemble en principautés n’enlève rien à ce fait. En effet, éparpillées entre l’Anatolie et l’Inde en passant par l’Iran ou l’Asie Centrale, elles sont toutes placées sous la férule de dynasties turciques converties à l’islam. Ainsi poursuit Davutoglu, « malgré des rivalités internes, le XVIe siècle illustre, des murs de Vienne à la Chine, une unité civilisationnelle et stratégique qui font de l’Eurasie une aire géoculturelle soudée [simple_tooltip content=’Ibid, p. 460.’](3)[/simple_tooltip] ». Cette unité, regrette Ahmet Davutoglu, vole en éclat à partir du XVIIIe siècle sous l’action combinée des impérialismes britannique et russe.
Désapprendre l’Occident
Le terme d’Eurasie est popularisé en Turquie au début des années 1990. Dans l’euphorie de la chute du rideau de fer, Ankara s’emploie à renforcer son influence en Asie centrale. Un organisme de coopération est créé dès 1992, la TIKA (Agence de développement et de coopération turcophone). Le tropisme eurasien s’accentue à la fin de la décennie, conséquence des difficultés à engager le processus d’adhésion à l’Union européenne, du moins à l’époque. En réalité, le discours d’Ankara est à double détente. D’une part, il vise à se présenter aux yeux des Européens comme une tête de pont en Asie et au Moyen-Orient. De l’autre, il signifie à Bruxelles que l’Europe n’est pas un horizon indépassable [simple_tooltip content=’Marlène Laruelle, La Quête d’une identité impériale, Petra, Paris, 2007, p. 243.’](4)[/simple_tooltip].
Néanmoins, les ambitions turques connaissent quelques déboires. À cela trois raisons :
– La Russie demeure le premier partenaire commercial de la région.
– Par ailleurs Moscou a su parfaitement jouer des peurs des révolutions de couleurs sur les élites dirigeantes locales issues du moule soviétique.
– Enfin, l’activisme turc a pu être parfois considéré comme un frein à la légitimité des nouveaux états d’Asie centrale.
On comprend que, longtemps, les Turcs aient porté un regard empreint de méfiance sur l’eurasisme russe (Evrazîa). Phénomène concurrent à l’eurasisme turc, quoique parallèle à lui, il est vilipendé comme le masque habile d’une Russie avide de retrouver son emprise perdue. Pourtant, les lignes bougent.
Ce virage prend sa source à l’orée des années 2000 avec le début du processus d’adhésion à l’Union européenne et l’arrivée des islamo-conservateurs aux affaires. Rapidement, l’establishment kémaliste comprend que les directives européennes sapent ses assises : les islamistes mettent en avant l’idéologie des droits de l’homme véhiculée par l’Union pour affaiblir le pouvoir de l’armée, gardienne du kémalisme. En outre, le soutien sans faille des États-Unis au projet « d’islam modéré » de l’AKP (Parti de la Justice et du Développement) inquiète les cercles militaro-laïcs qui y voient une remise en cause de l’héritage d’Atatürk. En clair, résume Ali Külebi (1945-), ancien directeur du Centre de recherche stratégique pour la sécurité nationale (TUSAM) : « L’Union européenne, pour laquelle nous avons grandement compromis notre identité et notre honneur national, cherche à jouer un rôle influent au-delà des frontières nord-est de la Turquie. Alors que nous tournons nos visages à l’Ouest, l’Occident ne cesse d’étendre son influence sur l’Asie centrale, la patrie des Turcs [simple_tooltip content=’Hürriyet daily news, 23 août 2006, Ali Külebi, « The forgotten option : Turkish Eurasianism ».’](5)[/simple_tooltip] ».
A lire aussi: Eurasie : vers une nouvelle route de la soie ?
Dès lors, face aux menées occidentales, la Russie fait figure de partenaire, si ce n’est d’allié, aux yeux des kémalistes et des eurasistes. Au nom d’un avenir commun, Russes et Turcs réécrivent l’histoire et listent leurs convergences. Les douze guerres qui ont opposé pendant quatre siècles (1568-1917) les deux pays découleraient des manipulations périphériques des thalassocraties, trop heureuses de dresser entre elles leurs rivales terrestres. Cependant, la fin de la Première Guerre mondiale a scellé le rapprochement turco-russe. Humilié par l’Entente et le traité de Sèvres (1920), la Turquie n’a eu d’autre choix que de se tourner vers l’est en liant son sort à l’URSS. C’est, souligne Attila Ilhan (1925-2005), auteur phare de ce mouvement, « le constat de Mustapha Kemal et de Lénine et c’est ce qui amène les deux jeunes États à s’unir dans la lutte contre l’impérialisme [simple_tooltip content=’Sener Aktürk, Counter-hegemonic visions and reconciliation through the past : the case of turkish eurasianism, p. 217, in home.ku.edu.tr/~sakturk/Akturk_2004_Ab_Imperio_CounterHegemonic_Visions.pdf’](6)[/simple_tooltip] ». Deux idées majeures favorisent cette alliance : d’une part la certitude qu’il existe nombres d’analogies entre bolchevisme et kémalisme (État fort et hiérarchisé, volonté de créer un homme nouveau, sens du devoir et ascétisme) ; d’autre part la conviction qu’entre la Russie et l’URSS, quel que soit l’habillage idéologique, les intérêts géopolitiques convergent.
Si l’on suit Suat Ilhan (1925-), le courant eurasiste turc est scindé en deux branches. Le premier, dans l’orbite d’Alexandre Douguine (1962-), défend un partenariat fort avec Moscou. Le second estime que, sans exclure un rapprochement avec la Russie ou la Chine, le centre de gravité de la future Eurasie reste le Turkestan [simple_tooltip content=’Suat Ilhan, Tüklerin jeopolitigi ve avrasyacilik, [Géopolitique des Turcs et Eurasisme], Bilgi, Ankara, 2006, p. 212.’](7)[/simple_tooltip]. Très influent dans les cercles militaires qui craignent l’adhésion à l’Union européenne, l’eurasisme se situe à la croisée de la droite radicale et de la gauche kémaliste. Pour cette raison, assimilés à tort ou à raison aux projets de putsch militaire des années 2000, les eurasistes ont beaucoup souffert de la répression du gouvernement islamiste.
Le paradoxe veut qu’aujourd’hui l’AKP, en pleine crise de confiance avec Bruxelles, ait repris quelques-uns de leurs mots d’ordre.
Régresser vers l’Orient
Ahmet Davutoglu est le grand théoricien du néo-ottomanisme. Loin de toute mélancolie stérile, cette politique entend renouer avec un héritage impérial qui a été calomnié au risque d’une occidentalisation sans âme. L’appel aux six siècles de grandeur ottomane et l’évocation de la fraternité islamique annoncent une modernité respectueuse du passé, où les peuples musulmans seraient acteurs de leur destinée. Or, dénonce Davutoglu, la civilisation occidentale, dans sa prétention à vouloir régenter la planète, condamne à brève échéance la diversité humaine. « Cette fin de l’histoire recouvre une proposition secrète selon laquelle l’humanité a atteint l’organisation politique la plus parfaitement rationnelle. D’un côté, un ordre parvenu au degré du “bien” absolu, de l’autre, les bouddhistes, les musulmans, les chinois, les arabes qui s’opposent à la mondialisation ; leur résistance à ce processus prend une forme “irrationnelle”, puisqu’ils sont promis à disparaître de l’histoire [simple_tooltip content=’Ahmet Davutoglu, Küresel bunalim, [La crise globale], Küre, Istanbul, 2008, p. 70.’](8)[/simple_tooltip] ».
Le rôle historique de la Turquie apparaît dès lors clairement : au Nord, elle jouit des apports techniques de l’Europe ; en Orient, elle déploie ses choix culturels et religieux ; au Sud, elle est l’alliée du tiers monde anti-impérialiste. Ce refus de s’aligner sur un axe occidentalo-centré explique l’attrait d’Ahmet Davutoglu pour l’Eurasie.
Néanmoins, en réaliste, il pointe du doigt les obstacles qui ont longtemps handicapé l’action de son pays dans cette direction. Tout d’abord, le fait que la diplomatie turque ait depuis le XVIIIe siècle conditionné toute son action à l’aune du seul regard des chancelleries européennes, sacrifiant ainsi toute politique alternative. À cela s’ajoute le processus d’occidentalisation à marche forcée, et à partir de la guerre froide, l’alignement sur les États-Unis à travers l’adhésion à l’Alliance atlantique [simple_tooltip content=’Op. cit. (1). p. 488.’](9)[/simple_tooltip]. Cet héritage demeure un boulet qui grève les efforts d’Ankara dans sa volonté de diversification.
A lire aussi: Pour quelles raisons la Turquie s’implante-t-elle en Afrique ?
Ainsi, début 2013, la Turquie présente sa candidature au Groupe de Shanghai qui regroupe les pays d’Asie centrale sous la houlette de la Chine et de la Russie. L’idée est de prouver que la Turquie n’est pas uniquement tributaire de l’Union européenne. Or, Ankara s’est heurtée à une fin de non recevoir. La Turquie s’est vue reprochée sa trop grande servilité envers l’Occident à l’occasion de la crise syrienne, et in fine, d’être le cheval de Troie de la politique de Washington dans la région.
En dépit de ses limites et de ses multiples contradictions, l’eurasisme demeure la stratégie d’opposition au modèle unipolaire américain le plus viable. Du fait de sa plasticité, ce courant politique rallie un large spectre de sympathisants en Turquie. Il rassemble pêle-mêle des hommes d’affaires séduits par les perspectives des marchés émergents, des militaires désireux de trouver une échappatoire à l’UE, une gauche anti-impéraliste hostile à l’hégémonie américaine. L’eurasisme ne se pose pas en civilisation globale. Il est un alter-universalisme respectueux du génie propre à chaque peuple. C’est ce que le philosophe russe Constantin Léontiev appelle « la multiplicité florissante ».