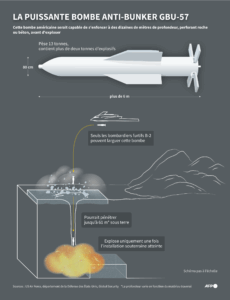La proximité historique et culturelle a longtemps joué en faveur des liens entre l’Europe et l’Amérique latine. Mais cela semble désormais appartenir au passé. Entre les deux rives de l’Atlantique, le fossé est de plus en plus profond.
On appelait jadis l’Amérique latine l’extrême Occident et il existait entre elle et l’Europe un cousinage, une proximité sentimentale sous le couvert de la latinité. Les raisons sont multiples de bien nous aimer. Ces pays lointains sont peuplés de nombreux émigrés de notre Vieux Continent. On y rencontre des Espagnols, bien sûr, souvent basques ou galiciens, et certains descendants des conquistadores de la fin du xve siècle natifs d’Estrémadure. Les Portugais sont au Brésil, mais également des Allemands, des Croates, des Serbes et des Italiens, très nombreux aussi en Argentine. Dans ce dernier pays, des Gallois ont fondé une colonie dans la province de Chubut, en Patagonie argentine, en 1865. Ils y ont croisé des Anglais éleveurs de moutons et des indigènes géants traités de Patagons, terme qui rassemblait différents peuples installés bien avant les Espagnols sur ces terres antarctiques qu’ils considéraient être les leurs.
A écouter également :
L’heure du désamour
Aujourd’hui, le désamour entre la vieille Europe et son extrême Occident est réciproque et total. Les membres de l’Union européenne se polarisent sur l’agression russe de l’Ukraine, craignent avec elle la naissance d’un nouveau désordre mondial, s’inquiètent aussi de l’impérialisme chinois et des querelles récurrentes du Proche et du Moyen-Orient. Ils s’angoissent, enfin, des migrations venues d’Afrique. Mais l’Amérique latine, elle, est sortie du radar européen. Celle-ci, de son côté, a pris ses distances avec l’Occident. Certains pays de la région n’ont pas condamné à l’ONU la Russie pour son agression de l’Ukraine. Les mêmes ont souvent remis en cause la démocratie libérale tandis que d’autres, notamment au Chili, en Colombie et au Pérou, votent pour des dirigeants d’une gauche très radicale.
Comment expliquer ce dédain européen envers l’Amérique latine, et l’indifférence de cette dernière à l’égard de l’Europe ? Je crois qu’il existe deux types de raisons : celles du passé qui ne s’effacent pas facilement, et celles d’un présent difficile que nous devrions vite amender pour une réconciliation nécessaire avec les quelque 700 millions de personnes vivant en Amérique latine.
Les raisons du passé
L’histoire, comme souvent, n’est pas glorieuse. L’invasion espagnole d’Hernan Cortés en 1519 au Mexique se solde par de gigantesques massacres et la chute de l’empire aztèque. En 1532, Francisco Pizarro entre au Pérou et part à la conquête – sanglante et réussie – de l’Empire inca. Deux éminentes civilisations sont ainsi brutalement effacées. À la fin du xixesiècle, la plupart des peuples indigènes ont disparu en raison des guerres, de l’esclavage, des maladies importées par les Européens. Avec « la Conquête du désert » entre 1879 et 1881, l’Argentine s’est lancée dans une opération génocidaire en éliminant tous les peuples indigènes de Patagonie. À Cuba, lors de la guerre d’indépendance, arrive en 1896 un militaire espagnol, le général Weyler, qui met en place l’une des premières versions du camp de concentration. Un tiers de la population rurale y perdra la vie. On pourrait citer aussi la désastreuse expédition française au Mexique en 1861, décidée par Napoléon III soucieux d’installer dans ce pays une force catholique capable de contenir les États-Unis protestants. Elle provoque des batailles permanentes et se termine par l’exécution de l’empereur Maximilien en 1867. N’oublions pas non plus les infructueuses tentatives des premiers colons portugais au Brésil de réduire en esclavage les indigènes du pays, lesquels s’enfuient dans la forêt ou se laissent mourir. Ils importent alors des esclaves africains, et leurs enfants d’aujourd’hui n’oublient pas le sort réservé à leurs ancêtres. Ces souvenirs sont lointains, mais douloureux, et les Européens d’aujourd’hui, notamment les Espagnols, ne sont pas aussi bien-aimés qu’ils le pensent en Amérique latine.
Les raisons du présent
L’émergence des indépendances des États latino-américains s’ouvre par la déception de n’avoir pas su réaliser le rêve d’une grande fédération espérée un siècle plus tôt par le Vénézuélien Simón Bolívar et l’Argentin José de San Martín. En renonçant à la puissance d’une vaste fédération, l’Amérique latine entame la modernité de façon étriquée. Elle se découpe en nations souveraines, la plupart inefficientes et toutes inégalitaires, à l’exception notable du Mexique qui, après la « révolution » – une série de soulèvements et de coups d’État entre 1910 et 1917 –, a structuré ses institutions démocratiques et honoré le métissage comme la synthèse finale des « trois cultures » du pays – l’européenne, l’indigène et les métis nés des amours des deux premières et qui représentent la quintessence du peuple mexicain. Les autres nations continuent à subir de nombreux coups d’État dirigés par des caudillos dont le général Tapioca de Tintin est une aimable caricature. Elles se disputent aussi sur les lignes de leurs frontières. Liés aux chefs de guerre au pouvoir, les grands propriétaires terriens exportent en Europe les produits de leurs agricultures et de leurs mines, accumulant d’énormes richesses alors que les travailleurs pauvres restent dans un état proche de la servitude. Dans les années 1930 et 1940, deux expériences néofascistes, avec Juan Perón en Argentine et Getúlio Vargas au Brésil, donnent un peu plus de droits aux travailleurs et aux syndicats, mais épargnent les riches et les élites locales.
La fin de la Seconde Guerre mondiale balaie ces velléités autoritaires et semble annoncer une période plus apaisée. Mais la guerre froide fait de l’Amérique latine l’un de ses terrains de jeux. Et c’est un désastre.
Tout commence de façon spectaculaire, le 1er janvier 1959 à La Havane, quand surgit sur un char un personnage barbu et bavard, en uniforme vert olive. Il s’appelle Fidel Castro et va installer pour longtemps une fracture profonde entre la droite conservatrice et la gauche socialiste de l’Amérique latine. Fou de lui-même, mais, hélas, charismatique, Fidel va, avec la crise des missiles russes à Cuba en 1962, mettre le monde au bord de l’apocalypse, puis ses opposants en prison et enfin ses citoyens dans la misère. Jacobo Machover, exilé cubain en France, désigne le régime cubain comme un « totalitarisme tropical[1] ». Malgré ces tristes vérités, l’influence de Castro reste incontestable. Sans lui et sans son meilleur ennemi, Ernesto Che Guevara, qui prône « plusieurs Vietnam » dans la région, sans aussi la CIA et le KGB, très actifs pour pousser les feux de la discorde, les Brésiliens n’auraient pas applaudi le coup d’État militaire de 1964 qui prétendait sauver leurs compatriotes du communisme. Les armées ont géré le pays jusqu’en 1989 de façon calamiteuse, laissant en héritage à la démocratie renaissante un bilan humain catastrophique[2], des routes inachevées en Amazonie et une inflation galopante. Sans Castro, les révolutionnaires du Nicaragua ou du Salvador ne se seraient pas entretués, Daniel Ortega ne serait pas le tyran cruel qu’il est aujourd’hui, les officiers argentins et uruguayens seraient restés dans leurs casernes, le général chilien Augusto Pinochet aurait peaufiné son livre sur la géopolitique[3], et jamais sans doute nous n’aurions parlé de guérillas colombiennes. Sans Castro, enfin, Hugo Chavez, président du Venezuela en 1999, n’aurait pas réinventé la « révolution bolivarienne » qui cache une dictature socialiste elle aussi tropicale.
A lire également :
Le terrorisme en Amérique latine : variantes et résultats
Cette peur – légitime – du communisme a ravagé la région, provoqué des violences insensées et la mort de centaines de milliers de personnes dans l’ensemble de l’Amérique latine.
Le retour à l’État de droit et à la démocratie s’organise un peu partout vers la fin des années 1980. On découvre alors le Mexique, qui n’a jamais aimé les Yankees, devenir un grand sous-traitant de l’industrie américaine en signant en 1994 l’ALENA, le traité de libre-échange de l’Amérique du Nord qui réunit le Canada, le Mexique et les États-Unis. Au Brésil, le social-démocrate Fernando Henrique Cardoso, nommé ministre de l’Économie en 1993, annonce son programme : « Le Brésil a trois problèmes, dit-il, l’inflation, l’inflation et l’inflation. » Il gagnera cette bataille monétaire sous le regard admiratif des Européens. L’Argentine redevient fréquentable sous la présidence du radical Raúl Alfonsín, bientôt chassé du pouvoir par les péronistes. Quant au Chili, au retour de la démocratie, il devient le meilleur élève du Fonds monétaire international et un modèle à suivre. Après la fin de la dictature, personne ne touche au programme libéral des « Chicago Boys » de Pinochet, et le pays s’en porte très bien pendant une bonne décennie.
L’Europe se souvient alors que l’Amérique latine existe. Elle est de nouveau attractive et civilisée, démocratique et dynamique. En 1991, quatre pays – l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil – jadis dictatoriaux – fondent le Mercosur, un marché commun inspiré de l’Union européenne. C’est plus honorable que l’opération Condor.
J’ai fait partie du groupe de journalistes qui a suivi le voyage officiel du président Jacques Chirac au Brésil en mars 1997. Dans un discours au Congrès, il chante les louanges de ce pays, « cette grande nation, ce grand peuple, sa démocratie pleinement retrouvée, l’une des premières puissances économiques du monde, une très grande puissance d’Amérique, l’un des pôles du monde de demain[4] ». Ces nombreux éloges sont appréciés, de même que l’appétit du président français pour la feijoada, un ragout traditionnel de haricots noirs et de viande de porc. Mais l’enthousiasme chiraquien, toujours très sympathique, n’émeut guère le reste de l’Europe comme vont le démontrer les longues négociations d’un accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne.
Les négociations commencent en 1999 et seront suspendues de nombreuses fois. L’Union européenne ne sait pas comment intégrer ses subventions à l’agriculture dans l’accord, le Mercosur n’arrive pas à baisser assez ses droits de douane pour satisfaire les Européens. D’autres points sont autant d’obstacles, comme le phytosanitaire, les droits d’auteurs ou les droits de douane très élevés sur l’importation des voitures européennes. Les importations de viande, d’Éthanol, les normes sur l’environnement sont des chapitres compliqués.
Finalement, le 28 juin 2019, l’Union européenne et le Mercosur annoncent avoir finalisé leurs négociations et être parvenus à un accord de principe. Mais personne n’en veut en Europe, surtout pas le président Emmanuel Macron qui sait que les agriculteurs français sont vent debout contre ce traité. Très opportunément, des feux dans la forêt amazonienne permettent à Macron, lors du G7 de Biarritz en août 2019, d’accuser le président brésilien Jair Bolsonaro de ne pas respecter les normes environnementales du traité et il annonce que la France ne signera pas celui-ci. Angela Merkel lui emboîte le pas, tandis que le Parlement européen juge que l’accord ne peut être accepté en l’état. Il s’agit d’un abandon, et ses conséquences sont considérables. Négocié pendant deux décennies, ce traité concernait 33 pays, dont trois membres du G20 et quatre de l’OCDE, comptant 700 millions d’habitants. Une fois ratifié, il aurait constitué le cinquième plus grand espace de libre-échange du monde.
L’Amérique latine ne peut que constater que l’Europe reste une forteresse fermée à ses produits. « C’était un traité inutile », dira plus tard, avec dépit, Lula.
Ce désamour intervient alors que l’heure exige de rassembler ses alliés. Notre extrême Occident n’est pas perdu pour tout le monde. Nous avons laissé vide un vaste espace dans lequel s’est engouffrée la Chine qui, selon El País[5], aurait multiplié par 26 ses investissements en Amérique latine depuis le début du siècle. Le seul espoir – ténu – pour renouer nos liens avec ce continent sera la présidence espagnole de l’Europe, à partir de juillet 2023.
A lire également :
« Sortez les sortants ! » Un an d’élections présidentielles en Amérique latine
[1] Jacobo Machover, Cuba, Totalitarisme tropical, Buchet-Chastel, 2004.
[2] On estime les victimes de la dictature brésilienne à 426 morts ou disparus, 50 000 personnes arrêtées arbitrairement, 20 000 torturées et enfin 10 000 Brésiliens en exil, choisi ou imposé.
[3] Geopolítica, Diferentes etapas para el estudio geopolitico de los estados, Augusto Pinochet Urgarte, Santiago du Chili, Estado Mayor General del ejercito, revistas y publicaciones militares, 1968.
[4] Lire : http://www.jacqueschirac-asso.fr/archives-elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/1997/mars/fi003504.html
[5] El País, 21 août 2022.