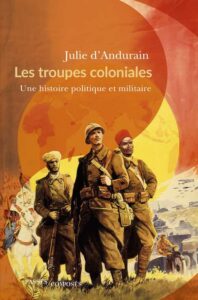Une étude salutaire et bienvenue pour éclairer l’histoire des troupes coloniales et leurs évolutions.
C’est avec le plus grand intérêt que l’on peut découvrir cet ouvrage dont le sous-titre, « une histoire politique et militaire », se révèle parfaitement explicite. Les nombreuses publications consacrées aux troupes coloniales, que l’on assimile très souvent aux troupes de marine, font davantage état des campagnes dans lesquelles ont été engagées que du contexte politique et organisationnel qui a présidé à leur naissance et à leur développement, avec leur place très particulière au sein de l’armée de terre française.
Face à la colonisation
Aborder les troupes coloniales c’est évidemment traiter de l’histoire de la colonisation, de la conquête et de la constitution de l’empire, avec des unités qui ne doivent pas être confondues avec les soldats de l’armée d’Afrique, ou avec ce que l’on appelle « les troupes de couleur ». La dénomination de troupes coloniales a été elle-même très variable, puisqu’après s’être appelées troupes de marine, puis troupes d’outre-mer, elles sont redevenues finalement troupes de marine. On utilise évidemment les termes de l’argot militaire pour désigner les marsouins ou les bigors selon qu’ils dépendent de l’infanterie ou de l’artillerie. Toutes les unités dispersées sont désignées comme faisant partie de « la coloniale » qui a vu officiellement le jour avec le siècle, en 1900. Plus d’un siècle après leur naissance officielle et leur rattachement au ministère de la guerre, aujourd’hui ministère des armées, on parle évidemment toujours des colos, avec une sorte de rivalité amicale, notamment dans les troupes aéroportées, entre les « colos » et les « métros ».
Leur particularité, au-delà de la lointaine origine qui les fait remonter à 1622, et à la création des compagnies de la mer, c’est d’avoir été essentiellement composées de volontaires, tentés par l’aventure et les primes d’engagement, ce qui explique jusqu’à une période très récente le fort engouement pour ces régiments parmi les engagés avant que les reculs successifs des positions françaises en Afrique ne viennent réduire les possibilités d’opérations extérieures.
La première vague de colonisation française conduite avant la révolution a été à l’origine, sous le ministère Choiseul, de la création d’une infanterie de marine, c’est-à-dire la mise à disposition de fantassins pour occuper les garnisons coloniales.
Un outil de conquête
Sous le Second Empire, le programme de Napoléon III vise à redonner à la France un statut de grande puissance, à la fois européenne, mais aussi outre-mer, ce qui lui permet d’entreprendre des opérations de conquête avec Faidherbe en Afrique de l’Ouest en 1857, et au Mékong en 1866. Les troupes sont rattachées explicitement au ministère de la Marine, mais elles ne sont pas directement impliquées dans la consolidation de la conquête de l’Algérie. La guerre de Crimée qui se déroule à partir d’opérations de débarquement marque la reconnaissance de ces différentes unités, implantées dans les zones portuaires de métropole et dans les colonies des Antilles, mais également en Océanie, à Cayenne, à la réunion et au Sénégal.
Les troupes de marine auraient pu jouer un rôle plus important en Algérie, notamment si le système des « bureaux arabes », très largement encouragés par les militaires saint-simoniens n’avait pas été fortement combattu par les colons. Le régime du sabre est considéré comme inefficace et peut-être pour partie davantage enclin à favoriser les intérêts des populations indigènes, notamment en matière d’appropriation des terres. C’est également en 1857 que sont constitués les corps de troupe « indigènes », noirs en 1857, Annamites en 1858 et cipayes de l’Inde en 1867. Ces derniers sont à l’origine du terme de spahis, une unité de cavalerie légère.
À la fin du Second Empire, la Légion étrangère apparaît comme une unité rivale des troupes de marine, car elle présente des caractéristiques proches, comme unité constituée en corps expéditionnaire. La bataille de Camerone le 30 avril 1863 a fait rentrer cette unité dans la légende de l’armée française, mais le combat de Bazeilles entre le 31 août 1870 le 1er septembre 1870 permet à la division bleue de donner aux troupes de marine leurs lettres de noblesse dans la défense du territoire national.
Pendant la période dite du recueillement qui suit la défaite de 1870, la France, comme le Royaume-Uni du reste, s’engage dans une nouvelle période d’expansion coloniale qui fait tout de même un peu oublier celle qui avait eu lieu sous le Second Empire. La filiation se situe plutôt du côté des conquêtes coloniales de la monarchie au XVIIIe siècle, très largement amputées par les conséquences de la guerre de Sept Ans.
Dans ce chapitre consacré à la conquête, Faidherbe forge l’outil colonial avec les recrutements de tirailleurs et de spahis qui se heurtent à des troupes plutôt aguerries de maures et de Toucouleurs. Les tactiques employées associent l’affrontement à la signature de traités avec les chefs locaux.
Joseph Gallieni s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, avec la conquête du « Soudan français » avant de se retrouver au Tonkin en 1892. Devant les difficultés rencontrées, malgré un fonctionnement en colonnes qui détruisent tout sur leur passage, sous l’impulsion de Théophile Pennequin, camarade de promotion de Gallieni, les marsouins s’initient aux techniques de la guérilla en ciblant spécifiquement leurs adversaires, notamment les bandits, pirates et brigands, qu’il convient d’éliminer pour gagner la confiance des populations. Quelque part on peut retrouver cela dans les travaux de David Galula avec la doctrine de la contre insurrection un peu moins d’un siècle plus tard.
Cette démarche, que l’on appelle également celle de la « tache d’huile » permet d’éviter l’affrontement militaire toujours incertain et favorisant la volonté de vengeance, au profit d’une démarche présentée comme un acte de pacification.
Parmi les éléments qui méritent d’être pris en compte dans ce chapitre, on trouve la question du solde et de l’avancement. De façon globale, avec quelques nuances entre les marsouins et les Bigors, les soldes sont substantiellement plus élevées pour les sous-officiers et les officiers, les possibilités de promotion plus importantes. De façon globale les troupes de marine sont essentiellement composées de volontaires, qui s’engagent directement ou qui font un passage dans la troupe métropolitaine. Pendant un temps des appelés qui « tiraient un mauvais numéro » ont pu se retrouver incorporés dans ces régiments.
Un outil politique
Les troupes de marine sont évidemment au premier chef un outil politique dans un contexte de rivalités coloniales et de consolidation des conquêtes antérieures à la défaite de 1870. Pendant la période du recueillement, les troupes de marine n’ont pas été véritablement l’objet d’une attention particulière du ministère de la guerre, et l’intérêt pour la colonisation était d’abord économique. C’est la grande révolte kanak entre 1878 et 1879 qui favorise la première prise de conscience à propos de l’intérêt de disposer de troupes rapidement projetables, donc déjà présentes outre-mer. La spécificité des troupes de marine comme corps expéditionnaire à part entière s’exprime lors de la campagne de Tunisie en 1881, même si du point de vue sanitaire c’est plutôt une catastrophe.
Les Britanniques en profitent d’ailleurs pour consolider leur position et finalement chasser les Français d’Égypte, et la conquête de la Tunisie n’apparaît que comme une petite compensation.
La question du statut d’armée composée de professionnels a été largement débattue au Parlement, et notamment combattue par les républicains qui pouvaient craindre une armée de prétoriens capables de renverser la République. De la même façon, la droite, hostile à l’aventure coloniale, a pu s’exprimer en ce sens, mais avec d’autres motivations.
Deux ans plus tard, la conquête du Tonkin permet d’affiner le concept de troupes de marine, appelé pendant un temps infanterie de marine, et disposant désormais d’un outil spécifique, pendant près de 10 ans, d’Indochine à l’Afrique, jusqu’à Madagascar en 1893, la France s’engage clairement dans le scramble colonial, que l’on appelle souvent la course aux clochers. C’est dans ce contexte que se déroulent les débats sur le rattachement des troupes de marine à la Royale ou à l’armée de terre, et il faut attendre 1900, pour que la question soit finalement réglée. Pendant ce temps et dans l’incertitude, la marine ne s’est pas véritablement préoccupée des infrastructures pour ces personnels qui ne sont pas vraiment des marins, ce qui explique l’état de délabrement des positions à la veille du XXe siècle.
Un outil de défense.
Cette année 1900 marque la fin du processus de conquête, à quelques nuances près, et le terme de défense des colonies apparaît de façon beaucoup plus fréquente. L’alerte de Fachoda, face aux Britanniques en 1898, a montré qu’il faut disposer à la fois d’un outil de conquête, mais également de défense face à des concurrents ambitieux qui ont fini par avoir gain de cause d’ailleurs.
De ce fait, et avec l’expansion de l’empire colonial, les rivalités entre services se manifestent avec force. Les militaires comme Lyautey restent partisans d’une administration militaire, le ministère des colonies se fait l’écho du plaidoyer des administrateurs civils, qui agissent en corps constitué, sans parler de l’opposition entre la marine et l’armée de terre, qui veulent conserver leurs prérogatives sur les troupes coloniales.
De cette époque date également la prise de conscience du tribut humain que les troupes de marine payent face aux maladies endémiques. L’attrition, pour utiliser le terme moderne, représente près de 10 % des effectifs chez les Européens. C’est de là que vient l’intérêt pour le recrutement indigène, et notamment les tirailleurs qui peuvent constituer une alternative à la marsouille. Progressivement les tirailleurs recrutés au départ comme mercenaires peuvent ainsi être incorporés à une véritable armée à laquelle les officiers coloniaux attachent une importance particulière avec un standard de recrutement différencié selon les ethnies. Le bambara représente à cet égard un idéal de soldat, contrairement aux toucouleurs suspectés de fanatisme religieux.
De façon générale la question de l’armement des indigènes suscite tout de même quelques questions. La culture locale reste pour longtemps encore celle de la razzia, avec butin et esclaves, ce qui va évidemment à l’encontre des règlements administratifs. L’envoi des revenus de la conquête au trésor public ne suscite pas forcément l’enthousiasme des tirailleurs indigènes. De ce fait les officiers sont extrêmement attentifs au paiement des arriérés de solde, et pendant un temps le paiement a pu se faire en monnaie locale et même avec des thalers de Marie-Thérèse, une monnaie que les tirailleurs semblaient apprécier. On notera que cette monnaie sans valeur faciale, mais définie par son poids en argent, a été démonétisée de l’empire austro-hongrois en 1858, mais a été très largement utilisée dans les empires coloniaux que les Européens ont constitués en Afrique.
À partir de 1900 l’état-major prend conscience de l’intérêt des troupes coloniales, et même s’il faut tenir compte des contraintes économiques, des efforts sont faits en matière d’habillement, beaucoup plus rarement en termes de promotion, et les passages à l’épaulette sont exceptionnels. Toutefois l’institution militaire offre quand même des avantages aux troupes indigènes, notamment lorsque les femmes peuvent accompagner leurs époux tirailleurs, ce qui permet de réduire les problèmes, peut favoriser la cohésion, et même éviter la propagation des maladies vénériennes.
La deuxième partie de cet ouvrage aborde, à propos des troupes coloniales, l’âge de la maturité.
Une arme à part entière.
La communication sur les spécificités de l’arme a été envisagée très tôt, avec la naissance de la revue des troupes coloniales en 1902. On retrouve aujourd’hui les mêmes types d’information que celles qui ont pu être données dans ce qui est bel et bien une sorte de « revue professionnelle », et l’armée de terre d’hier comme d’aujourd’hui en compte de multiples.
Cette période antérieure à la Seconde Guerre mondiale est particulièrement prolixe en matière de parutions de toute nature. La circulaire de 1887 autorise les officiers à écrire, après avoir obtenu l’autorisation du ministre. Et bien entendu, pour se faire connaître, il est indispensable de signer des articles. Et peut-être servir de galop d’essai pour la publication à venir d’un livre de référence sur des opérations coloniales que les officiers ont pu être amenés à conduire. De façon générale cette politique de publication s’inscrit dans une démarche qui veut faire une sorte de front commun face à des critiques de plus en plus affirmées lors de certaines « affaires », comme celle de Voulet et Chanoine qui défraie la chronique en 1899. Les deux officiers ont mené une politique de colonne infernale, en imposant des recrutements forcés, des intimidations et des exécutions sommaires. Cela se termine par la rébellion armée et par l’ouverture du feu par le capitaine Voulet sur son supérieur venu l’arrêter, le lieutenant-colonel Klobb. L’arme de troupes coloniales, lors de certains dérapages du même type, notamment une affaire de désertion avec passage au Nigéria, sous autorité britannique, évoque ce sujet une sorte de maladie appelée « la soudanite » que l’ancien médecin de la marine, Paul Vigné d’Octon qualifiera de fièvre noire, une sorte de démence liée au climat tropical.
Différentes affaires sont ainsi évoquées, et la presse nationale s’en fait largement écho. Des mutineries ou des rébellions contre les petits administrateurs coloniaux éclatent dans le sud de Madagascar en 1904, et c’est bien souvent la pression fiscale, assortie de détournements, qui suscite certaines révoltes.
La conquête coloniale étant quasiment terminée, le gouvernement radical-socialiste au pouvoir commence à s’interroger sur les effectifs et le coût de cette troupe qui apparaît comme plutôt « inquiétante » au vu de certains de ses comportements. La loi dite « des deux ans » du 21 mars 1905 réduit le format de l’armée, ce qui crée un phénomène de pénurie. De ce fait, parce que les problèmes de recrutement se posent avec une certaine acuité, on en vient à penser un service colonial reposant sur d’autres individus que les blancs.
Dans le même temps, la guerre russo-japonaise de 1904 – 1905, durant laquelle la France prend « naturellement » parti pour l’empire russe, et la défaite des armées du tsar qui en découle, réveille une sorte de crainte, « le péril jaune ».
Présentes en Indochine, les troupes françaises se verraient alors comme submergées par des masses chinoises, équipées par les Japonais, ce qui, évidemment à s’interroger sur les effectifs que l’on pourrait opposer, l’effet de masse dirait-on aujourd’hui, à ces troupes asiatiques menaçantes. Dès cette époque la question démographique se pose, et la France, particulièrement précoce matière de baisse de la natalité, s’interroge sur ses capacités à peupler ses colonies, et à recruter des effectifs suffisants pour défendre la nation, mais aussi l’empire colonial. Cela s’inscrit dans le contexte de la crise marocaine, une question coloniale pendante du partage colonial. Pour contrôler ce vaste territoire, la question du recrutement par la conscription des Algériens se pose. Toutefois, il faut également tenir compte des réticences du personnel politique national dans le contexte de l’affaire Dreyfus, face à une armée qui, après avoir été « la grande pipelette » lors de la conquête coloniale, devient plutôt « la grande suspecte ».
Toute la question posée se situe au niveau des rapports de force entre des politiques comme Victor Duruy allié à des militaires favorables à l’émancipation des indigènes par l’éducation et la formation militaire, et les représentants de la commission de l’armée qui agissent au nom des Français d’Algérie et qui redoutent que l’on arme les indigènes.
Cette question se retrouve dans le débat sur la Trinité coloniale, force jaune, force noire et conscription indigène.
Dans les cercles militaires, les débats sont multiples sur les qualités intrinsèques des soldats annamites, tandis que les administrateurs coloniaux sont évidemment particulièrement réticents. Les arguments économiques ne sont pas négligés non plus, puisque l’entretien des soldats annamites coûte 400 Fr. alors qu’un Européen pour le même service revient à 1500 Fr. En 1911 le capitaine Ibos franchit une étape symbolique en proposant la création d’une « armée jaune », capable de défendre les territoires de l’Indochine. Le général Pennequin, major de queue de compagnie » à Saint-Cyr, mal noté est souvent puni, apparaît avec le recul comme un précurseur de la volonté de gagner les cœurs et les esprits que l’on retrouvera bien plus tard. Il propose ainsi de créer une armée nationale cambodgienne, une armée complète de 170 000 hommes, du soldat de deuxième classe au général de brigade. Les administrateurs coloniaux, au contraire, voient dans ce projet la constitution d’une armée nationale capable de chasser les Français, ce qui explique pourquoi le projet est finalement enterré.
Pourtant, en Afrique, avec son projet de force noire, le général Mangin n’est pas si éloigné que cela des thèses de son camarade. La menace largement fantasmée du péril jaune, la prise de conscience que la faiblesse démographique de la France ne lui permet pas de coloniser l’Asie de façon massive, conduite à se « reporter » sur le continent africain.
On retrouve toujours le contexte global qui est celui de l’inquiétude de la France face à la vitalité démographique de ses deux rivaux que sont l’Allemagne et l’Angleterre, malgré l’entente cordiale. De la même façon, le développement au début du XXe siècle d’une religiosité islamique basée sur les confréries, comme les Senoussis dans les régions sahariennes inquiète les administrateurs coloniaux, et notamment le gouverneur général de l’Afrique-Occidentale française, William Merlaud-Ponty.
Le nouveau chef d’état-major des troupes de l’Afrique occidentale Française, Charles Mangin organise partir de 1910 une opération de recensement des populations africaines qui annonce le projet de « force noire ». L’objectif vise à recruter des tirailleurs sénégalais « fétichistes », qui ne seraient pas susceptibles d’être touchés par « le cléricalisme musulman » susceptible de provoquer des révoltes.
Il ne faut pas oublier que tous ces personnels ont été largement baignés par la révolte des cipayes, les supplétifs musulmans de l’armée des Indes britanniques.
Le mythe de la force noire s’inscrit ainsi dans une volonté « pluri directionnelle » permettant de résoudre différents problèmes, celui du nombre et de la rusticité des troupes, mais en même temps le contrôle de territoires particulièrement étendus. La thèse de la force noire est très largement développée par la presse française, même si d’un point de vue plus pragmatique, il s’agit aussi de disposer de troupes suffisantes pour envisager la conquête du Maroc, surtout lorsque l’on connaît la rivalité allemande. Encore une fois, les réticences des colons algériens à voir armer les indigènes, favorise l’utilisation des troupes coloniales, dès lors qu’elles ne sont pas composées d’Algériens. C’est en tout cas à partir de ces unités que commence en 1907 la pénétration française au Maroc.
L’engagement en masse
Le chiffre des personnels enrôlés pendant la Grande Guerre se situe entre 800 et 900 000 hommes qui se répartissent entre 600 000 combattants et 200 000 travailleurs. Les Français de métropole ont fourni près de 8 millions d’hommes. Les troupes coloniales sont intervenues sur tous les fronts, mais également dans les colonies elles-mêmes pour faire face à des révoltes. L’institution politique a souhaité un rapprochement entre troupes coloniales et armées d’Afrique, cette dernière ayant des bases territoriales spécifiques en Algérie et en Tunisie. Pour aller vite, ces différences sont peu visibles, du moins en apparence, un tirailleur algérien fait partie de l’armée d’Afrique, tandis qu’un tirailleur sénégalais relève des troupes coloniales. L’effort de guerre du corps d’armée coloniale a mobilisé les régiments situés en métropole, mais également et surtout des troupes qui ont été amenées sur le front. L’effort de guerre des colonies se manifeste par le retour des militaires de carrière en service outre-mer, la mobilisation des Français des colonies, et enfin un le recrutement croissant des populations indigènes en associant combattants et travailleurs coloniaux.
L’examen attentif proposé de la répartition de ces troupes montre que toutes les unités mobilisées ne sont pas directement engagées sur le front. Si les tirailleurs sénégalais, considérés comme issus « de races guerrières » sont envoyés sur le front, la plupart des bataillons malgaches sont installés dans le soutien. Les grandes batailles font appel aux troupes coloniales, comme sur la Meuse en 1914 ou les combats des marais de Saint Gond. La division marocaine y est engagée, avec les premiers contingents des troupes noires.
De façon générale les grands secteurs coloniaux ont été les champs de bataille de Champagne et de la Somme, même si Verdun a pu être le lieu de fait d’armes du régiment d’infanterie coloniale du Maroc, en 1916, lors de la prise de Douaumont. Les coloniaux ont largement servi aux Dardanelles et dans l’armée d’Orient, au Monténégro jusqu’au cercle polaire lors du soutien des armées occidentales aux généraux blancs pendant la guerre civile russe.
Certaines batailles, comme celle de Rossignol, un village à proximité des frontières belges et luxembourgeoises ont pu montrer la capacité d’engagement des marsouins. Après plusieurs assauts le premier régiment colonial a perdu 2800 hommes sur 3200. Sur ces deux journées du 22 au 24 août, sur l’ensemble des unités engagées 20 000 soldats ont perdu la vie.
Les coloniaux participent également aux offensives du chemin des Dames qui mobilise deux corps coloniaux et 21 bataillons de tirailleurs sénégalais. L’opération du printemps 1917, qui engage 30 000 hommes se révèle catastrophique, et, dans certains cas tourne à la débandade, malgré les qualités présumées des tirailleurs sénégalais qui ont été engagés.
La question de la définition de ces troupes est d’ailleurs assez intéressante, car il existe une certaine opacité quant à leur qualité. Sont-ce des troupes de choc ou une force d’appoint ? Les troupes coloniales ont été très largement engagées dans les combats des Dardanelles, au point de constituer l’essentiel des troupes à la fin. Par ailleurs les troupes coloniales combattent aux colonies, ce qui est somme toute assez logique, et notamment en s’emparant du Togo dès août 1914 et d’une partie du Cameroun, colonie allemande, avec des combats violents jusqu’en 1916.
Au-delà des troupes engagées, l’auteur s’interroge également sur le recrutement, estimé au final à 150 à 200 000 tirailleurs. La pression du recrutement a pu susciter des révoltes, mais paradoxalement pas obligatoirement dans les régions où cette pression était la plus forte. Au début, envoyées sans précaution particulière dans un milieu où le climat peut être rude l’hiver, les troupes coloniales subissent des pertes sanitaires importantes. L’état-major se rend compte assez rapidement de la nécessité d’un hivernage, ce qui explique le ralentissement du recrutement en 1915, avec des oppositions locales et même des révoltes du côté de Bamako et en 1915 dans la Haute-Volta. De façon générale les révoltes ont été relativement nombreuses, peu coordonnées, mais on pu entretenir un climat d’insécurité générale qui a dû susciter des opérations de police qui se sont prolongées, notamment dans la région saharienne, jusque dans l’entre-deux-guerres.
Le sarrautisme, une nouvelle vision coloniale.
La sortie de la Grande Guerre et la disparition d’Eugène Étienne, représentant du « parti colonial » en 1921, ouvrent une nouvelle période qui a évidemment un impact sur les troupes spécialisées en charge de la France de l’Empire. La Première Guerre mondiale, et son caractère spécifique ne sont pas indifférents, ont contribué à élargir les horizons des personnels politiques et militaires. Le tropisme africain semble s’être élargi, et même le terme de « colonies » apparaît comme désuet, et se retrouve largement remplacé par celui « d’Empire ».
Albert Sarraut apparaît comme novateur en préconisant une association plus complète entre colonisateurs et colonisés. Cela se traduit entre autres par une volonté de remettre en cause la spécialité « coloniale » des troupes du même nom, et une volonté d’écarter les militaires de la gestion des colonies. Comme souvent, les annonces sur le budget prévu pour le développement des territoires de l’empire ne sont que partiellement suivies d’effets, et les déclarations sur la question relèvent bien souvent de la propagande. Il est vrai que la population métropolitaine, épuisée par quatre années de guerre, ne manifeste pas un intérêt particulier.
Il faut inscrire cela dans un contexte très particulier qui est celui de la « redécouverte » de la France hexagonale et de la nécessité d’en défendre les « frontières naturelles » et tout particulièrement celle du Rhin. Cela a pour conséquence une accélération du processus de démobilisation des troupes qui privilégie d’emblée les forces blanches au détriment des troupes de couleur. Au moment de l’armistice, l’armée coloniale dispose en France de 7 divisions et de 96 bataillons indigènes combattants, soit une armée de 110 000 soldats. Le comportement au feu de certaines unités a largement été mis en valeur au point que les troupes coloniales apparaissent comme une armée d’élite, quasiment professionnelle. Ce sont quand même ces troupes coloniales que l’on retrouve dans les forces d’occupation en Allemagne, avec des unités issues également de l’armée d’Afrique. La mémoire de cette occupation évoque très largement cette présence « noire », largement instrumentalisée par les nazis, même si les troupes sénégalaises et malgaches quittent le Rhin entre juin 1920 et novembre 1921.
La France fait face à une propagande allemande parfaitement organisée, davantage téléguidée par Berlin qu’originaire des régions occupées. À partir de quelques cas avérés de viols, une campagne très clairement raciste se met en place, et elle s’inscrit dans la continuité d’une opération de même type que les services allemands avaient pu conduire en 1910, au Maroc, contre les soldats de la Légion étrangère. Cette tension, que l’on a qualifiée en Allemagne de « honte noire », se retrouvera en 1940 dans le traitement criminel que subiront les prisonniers noirs, lors de la campagne de France.
Au-delà de l’épisode rhénan, les troupes coloniales sont davantage employées au Maroc, mais également en Syrie et au Liban. Sur proposition de Clémenceau, le général Henri Gouraud est nommé commandant-en-chef des troupes du levant et en même temps haut-commissaire de la République française. L’armée du Levant mène des opérations militaires contre les Turcs, avec un effectif de plus de 60 000 hommes en juillet 1920. Très rapidement les questions budgétaires imposent une diminution de format, malgré les prémices de la révolte du djebel druze. Les officiers cherchent à pallier le sous-effectif en faisant plus largement appel à des tirailleurs sénégalais qui coûtent beaucoup moins cher, moins de 30 %, que les troupes issues de la métropole. Peu à peu les tirailleurs sénégalais sont remplacés par des tirailleurs algériens et tunisiens qui semblent mieux adaptés aux rigueurs de l’hiver en Syrie.
Le général Gouraud cherche à innover, en tenant compte de la diminution de ses effectifs, et comme les États-Unis ont pu le faire pendant un temps avec les tribus sunnites irakiennes après la chute de Saddam Hussein, il reprend la politique de Lyautey, celle des « grands caïds ». Il s’agit très clairement d’acheter la loyauté de ces chefs de tribus en leur confiant des opérations de contrôle de zone et de surveillance des grands axes. Le financement de cette opération repose sur des « fonds politiques », extraits du ministère des colonies.
La situation au Maroc est également particulièrement significative du fait de la personnalité de Lyautey. La question est de savoir si le royaume chérifien doit relever des troupes coloniales ou de l’armée d’Afrique, avec les conflits de compétence qui peuvent en découler. Une sorte de partition a pu être envisagée avec le sud pour les coloniaux et le nord pour les « africains », issus de l’armée de l’Algérie et de Tunisie.
Beaucoup plus pragmatique, Lyautey cherche à fusionner cela, même si des conflits de compétence se manifestent entre les « sahariens », les « colos », et les « Algériens », avec la Légion étrangère en prime.
Au final le général Gouraud doit gérer une situation complexe, issu des décisions de la Société des Nations de doter la Syrie et le Liban du statut de mandat, tandis que Hubert Lyautey dispose de moyens d’une conquête en bonne et due forme qui conduit tout de même avec une incontestable maîtrise, même si la France doit faire face à la guerre du Rif dans laquelle la France se retrouve impliquée à partir de 1924, jusqu’en 1927.
Les soldats du soleil
En 1922 l’armée coloniale compte 132 250 hommes avec un tiers européen et deux tiers des populations indigènes, dont la moitié sont des Sénégalais et des Malgaches. Conséquence d’une certaine méfiance à l’égard des Annamites, d’une méconnaissance surtout de leur culture, la force jaune est surtout largement employée dans le soutien ou dans l’aménagement et la surveillance des installations militaires.
C’est essentiellement le tirailleur sénégalais, qui pour de bonnes ou de mauvaises raisons, apparaît comme le « gagnant » de cette bataille de la communication autour des troupes coloniales. La guerre a permis aux Français de métropole de découvrir ce soldat indigène, rustique, courageux, et loyal. L’armée française, dans son ensemble, cherche à valoriser, en publiant notamment le « manuel à l’usage des troupes coloniales » qui multiplie les conseils pratiques sur leur emploi, en tenant compte de considérations dans lesquelles la place de l’islam peut jouer un rôle discriminant.
De nombreux officiers sont très attachés, à l’exemple du général Mangin, à leurs troupes. L’armée peut être ainsi utilisée comme ascenseur social, même si, encore une fois, les expériences et la mise en œuvre sont plutôt rares. Dans la pratique, en dehors de quelques rares exemples, la vertu du dressage est mise en avant, même si globalement un effort, notamment dans l’acquisition de la langue française, est entrepris.
L’opinion publique peut-être largement influencée par des chroniqueurs comme Alphonse Séché qui développe une analyse plutôt paternaliste, et parfois même clairement raciste à propos de ces tirailleurs sénégalais qui auraient tendance à se croire supérieurs à leurs frères de couleur. Il est vrai que, pendant la guerre, les soldats américains ont pu être surpris par la tolérance de leurs camarades français, à l’égard des noirs.
La publicité pour la boisson chocolatée Banania a très largement popularisé les personnages vigoureux et hilares que sont dans l’imaginaire collectif les tirailleurs sénégalais. Le produit a été inventé avant la guerre par un journaliste, Pierre – François Lardet, associé à un pharmacien qui mélange une poudre de cacao, de la farine, du sucre et de la banane. Au cours de la guerre, le tirailleur sénégalais incarne la force et la vitalité, et la boisson chocolatée devient un succès commercial.
De la même façon, la France découvre le jazz, avec des orchestres militaires de Harlem ce qui montre une certaine appétence pour une culture afro-américaine incarnée plus tard par Joséphine Baker.
Toutefois la figure du sympathique sénégalais reste celle du « grand enfant », ce qui n’est pas forcément dénué d’un certain sentiment de supériorité.
De la fusion avec l’armée métropolitaine.
Avec une identité forte, forgée dans des combats qui ont été très largement mis en valeur, la fusion des troupes coloniales et leur intégration dans la troupe métropolitaine n’ont pas dû être faciles. Le problème a d’ailleurs été, au sortir de la Grande Guerre, celui de la démobilisation de plusieurs millions d’hommes dont le retour à la vie civile n’a pas dû être facile. L’armée française a quand même dû dissoudre 80 % de ses régiments, pour reconstituer des forces de temps de paix. Le problème s’est posé de la même façon pour l’armée coloniale, et en métropole seuls quelques régiments « blancs » sont maintenus, comme les 3, 21e et 23e régiments d’infanterie coloniale. Le recrutement de soldats indigènes se poursuit au Sénégal et à Madagascar, de même que pour les Algériens –Tunisiens. Pour les paysans du bled, subissant la dureté des conditions naturelles, l’engagement n’est pas une perspective particulièrement repoussante, bien au contraire.
En même temps, on apprend à la lecture de ce chapitre, que quelques officiers craignant le déclassement développent tout un argumentaire sur le faible intérêt des troupes indigènes, leur inintelligence, leur fragilité sur les champs de bataille européens, leur unique intérêt étant celui pour les travaux de force. La question est bien celle du recrutement, mais surtout celle du reclassement des officiers métropolitains, parfois sortis du rang, qui se verraient bien poursuivre leur carrière aux colonies.
Au niveau du gouvernement, toujours avec le ministère d’Albert Sarraut, l’armée doit tenir peu de place dans la mise en valeur des colonies, qui doit rester une affaire d’administrateur civil.
La question du service militaire est également au centre des débats, dans cette période des années 20 pendant lesquelles des combats se poursuivent en Syrie comme au Maroc, et dans un contexte où certains esprits éclairés ne sont pas dupes du désarmement de l’Allemagne qui, dès le début de la période, cherche à contourner les dispositions du traité de Versailles. Pour autant la population civile, largement éprouvée par la guerre, est extrêmement hostile au maintien d’un service national de longue durée. André Maginot, alors ministre de la guerre, obtient une sorte de consensus sur une durée de 18 mois. Toutefois, avec cette méthode, et en raison de la baisse de la natalité qui avait commencé avec le siècle, le chiffre attendu de 660 000 hommes est très loin d’être atteint. Le déficit est de 300 000, ce qui évidemment renforce les partisans du recrutement massif de troupes indigènes. Pour dire clairement les choses, les indigènes viennent renforcer, y compris sur place en métropole, les régiments qui peinent à pourvoir tous les postes disponibles. On fait d’ailleurs la différence entre les troupes « indigènes », composé d’Algériens et de Tunisiens, et les troupes « noires » considérées comme moins aptes à servir en métropole.
La proposition de fusion/absorption prend peu à peu corps au début de l’année 1923. L’armée coloniale devient, sur fond de baisse à 18 mois de la durée du service national, l’un des éléments de l’armée métropolitaine. Le projet de loi inverse la proportion d’hommes servant aux colonies qui passent à un tiers pour deux tiers à la métropole. Sur le plan tactique, cela a des conséquences dans l’utilisation de l’armement, particulièrement dans la guerre du Rif, avec des insurgés lourdement armés, ce qui suppose l’emploi de moyens lourds. Progressivement la logique de Lyautey, celle de colonnes mobiles faisant face à une insurrection, laisse la place à celle de Philippe Pétain, qui emploie les grands moyens, avec des bataillons coloniaux indigènes appuyés par des chars d’assaut, de l’aviation. Cela suscite d’ailleurs la position du général Mangin, partisan des raids de cavalerie légère, et une organisation s’appuyant sur les chefs indigènes. Cette guerre du Maroc, qui n’avait rien d’une « petite guerre », mais bel et bien d’un engagement de haute intensité, consacre dans une certaine mesure la primauté des métropolitains sur la coloniale.
Le processus n’est pas sans analogie avec ce qui se passe en Syrie entre 1923 et 1925. Les grandes familles du djebel druze s’opposent à la présence française, et la répression qui en découle, la brutalité du général Weygand, qui remplace Gouraud, et le refus de négocier du haut-commissaire mettent le feu aux poudres. Les insurgés constituent une armée nationale syrienne, dirigée par Soltan Al Atrache. Les cavaliers Druzes mènent des opérations de harcèlement contre les forces françaises, et le général Sarrail rejette les erreurs sur ses prédécesseurs, Gouraud et Weygand. Le général Gamelin à la tête de 7000 hommes avec soutien aérien et unités blindées, cherche à pénétrer au cœur du djebel druze, ce qui ne met pas un terme à la guérilla. Le 19 octobre 1925, sur ordre du haut-commissaire Sarrail, le général Gamelin ordonne le bombardement de Damas, ce qui suscite une forte réprobation internationale et conduit le président du conseil Paul Painlevé à rechercher un règlement politique à cette crise.
Dans les multiples interrogations que pose la question coloniale, mais également mandataire, avec Levant, sans parler de l’Indochine, la prise en compte de la menace communiste devient assez marquée à partir des années 30. La tendance, pour faire face aussi à la baisse des effectifs, est de demander de plus en plus de matériel, ce qui permet évidemment d’économiser les hommes. Par ailleurs, la majorité des officiers qui exercent des commandements aux colonies ont l’expérience de la guerre industrielle en Europe, ce qui les pousse à demander du matériel, des aménagements en travaux publics, pour assurer la défense des colonies.
Plusieurs réflexions aboutissent à la loi du 13 juillet 1927 qui porte sur l’organisation générale de l’armée. La France envisage de disposer de forces de réserve stationnées en métropole ou en Afrique du Nord, ce qui redonne à la coloniale sa spécificité, sans aller jusqu’à l’autonomie perdue. Le format de l’armée est porté à 524 000 hommes, avec 106 000 militaires de carrière. Un tiers de l’armée provient des colonies. La coloniale regroupe 170 000 hommes.
Pendant cette période de l’entre-deux-guerres, aux colonies, la figure tutélaire du tirailleur demeure extrêmement présente. Les unités de la coloniale sont essentiellement installées sur Marseille, Toulon et Fréjus. Le pouvoir politique parisien veut à tout prix vivre dans l’illusion que les colonies vivent dans la paix, ce qui est loin d’être évident. Pour autant les tensions qui existent se traduisent par des difficultés en matière de recrutement de troupes indigènes, ce que la baisse des soldes et avantages ne facilite pas.
Le tonneau des Danaïdes. La mise en valeur d’outils de guerre.
Contrairement à ce que l’on peut voir dans la propagande anticoloniale du parti communiste de l’entre-deux-guerres, les colonies ne semblent pas être « un investissement qui rapporte ». L’économie indochinoise tournée vers l’exportation vers la métropole comme un marché unique souffre d’une absence d’investissement, notamment pour la mise en valeur agricole. Dans le contexte de l’époque, industrialiser les colonies aurait pour conséquence l’émergence d’un prolétariat dangereux, car susceptible d’être influencé par la propagande communiste. Pour autant, les appels à développer une forme de proto-industrie de transformation primaire des matières brutes restent peu entendus par les investisseurs. À cet égard on aurait pu aborder le cas particulier du vignoble algérien, dont la production sert de complément plus fortement alcoolisé au vignoble de masse du bas Languedoc.
C’est la raison pour laquelle l’industrialisation prend souvent la forme, selon l’auteur, de la « mise en valeur de l’outil de guerre », qui transforme les colonies en terrain d’expérimentation.
À cet égard ce sont les colonies qui ont servi de cobaye, en raison de grandes distances à relier, à la télégraphie sans fil. Cela développe également les supports mobiles pour la TSF, avec des stations légères et même des voitures amphibies.
Curieusement il n’existe pas de service du génie aux colonies, car il avait été estimé que l’artillerie de marine pourrait s’en charger. De ce fait, et en raison de l’absence d’investissements sur place, l’essentiel du matériel vient de métropole, mais la coloniale doit surtout se contenter de matériel déclassé que l’on peut acheminer vers de lointains horizons. Pour autant, en ce qui concerne les armes légères et de petit calibre, tout comme les grenades sont très largement diffusées, d’autant que cela permet de vider les stocks accumulés pendant la Grande Guerre. Cela n’empêche pas la formation d’un centre de motorisation des troupes coloniales à Fréjus, des études sur les autos mitrailleuses, des camions 6X6, mais, bien souvent, cela se heurte à des questions d’entretien, et de stockage des carburants. Le Sahara est également un théâtre d’expérimentation, et même d’association de la modernité avec l’aviation avec le dromadaire comme animal de bât, mais également de guerre. Les unités méharistes ont été sans doute des lieux d’innovation, notamment en matière d’orientation.
Militarisation ou industrialisation ?
Dans le budget des années 1930, les crédits consacrés aux colonies apparaissent comme dérisoires comparés aux besoins. Sur 55 milliards de francs de dépenses publiques, les colonies ne représentent que 10 %, l’essentiel de ces montants est consacré aux dépenses militaires. L’entretien d’une armée importante numériquement en Afrique est une façon de pallier le déficit démographique de la métropole. Mais en réalité les moyens consacrés sont très largement insuffisants, les recrutements indigènes sont davantage des emplois dans le soutien. Dans le contexte de la crise économique, les colonies ont d’abord été perçues comme un marché protégé pour des industries peu compétitives, tandis que les forces présentes dans les colonies restent tout de même largement sous-équipées.
Progressivement pourtant, une prise de conscience sur l’importance de l’unité de commandement entre la métropole et outre-mer se fait jour, notamment dans les propos du général Billotte, issu de la coloniale, et qui proposent de coordonner la défense de l’empire avec celle de la métropole. Avec la prise de conscience de réarmement massif de l’Allemagne à partir de 1935, mais également du renforcement de l’armée italienne, les parlementaires votent une augmentation du budget militaire et un renforcement de la part de la coloniale au sein du conseil supérieur de la guerre. Sous l’impulsion du général Antoine Bührer et sous l’autorité du ministre Georges Mandel, alors ministre des colonies, un projet global d’association des colonies et de la métropole est mis en œuvre, ce qui se traduit d’ailleurs par une augmentation des taxes sur les produits coloniaux d’ailleurs. Au niveau militaire un vaste programme de recrutement est également développé, ce qui évidemment reste embryonnaire au moment de la déclaration de guerre.
La France libre, incarnation de la Coloniale.
Sur les 300000 combattants et 200000 travailleurs coloniaux prévus dans le plan de réarmement prévu en 1937, les troupes coloniales en métropole et outremer ne comptent que 65000 hommes. Ces 4 divisions stationnées dans le grand sud sont renforcées par des réservistes. La montée en puissance se fait assez rapidement jusqu’à un total de 275000 en mai 1940. L’essentiel des effectifs vient d’Afrique, même si on est en mesure d’envoyer 15000 tirailleurs indochinois en métropole.
Les coloniaux sont très largement engagés dans la campagne de France et les pertes sont lourdes, d’autant plus que des massacres dans l’Oise et dans la région de Lyon sont clairement systématisés par les troupes allemandes. Une forme de vengeance contre la « honte noire » liée au traité de Versailles et à l’occupation de la Sarre et de la Ruhr.
Les 80 à 100000 prisonniers de couleur subissent un sort particulièrement sévère au début de la période avant que la volonté de jouer la carte de l’anticolonialisme par les nazis ne se traduise par une infinitésimale amélioration de leur sort.
La Coloniale : France libre ou France des marges.
L’appel du 18 juin a pu susciter des ralliements précoces, notamment au Caire avec le premier bataillon d’infanterie de marine, mais également dans les établissements français de l’Inde, en Océanie comme dans le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie. Toutefois c’est au Tchad, ainsi qu’en Afrique équatoriale française et au Cameroun que s’opère la bascule. Des colonels, futurs généraux, comme de Larminat et Leclerc, au Congo comme au Cameroun, se rallient au général de Gaulle. Les effectifs sont assez limités, plus ou – 5000 hommes au Cameroun, mais cela forme la base de ce que le général de Gaulle constitue comme nouvel organe de commandement, le conseil de défense de l’empire.
Les chefs directement issus de la coloniale sont rares dans ce conseil, à l’exception de Larminat, mais à l’exemple de Leclerc, ils en récupèrent les traditions. À cet égard le colonel de Hauteclocque a su tirer profit de son passé de jeune officier au huitième spahi pendant la guerre du rif et très rapidement il devient, sous le pseudonyme de Leclerc, la pièce maîtresse de la conquête gaulliste de l’Afrique centrale jusqu’à Koufra. À partir du Tchad et du régiment de tirailleurs sénégalais de ce territoire, il forme plusieurs compagnies « de découverte et de combat », et le cavalier porte sur son uniforme l’ancre de marine, insigne des coloniaux. Les forces françaises libres redonnent leurs lettres de noblesse à une formation coloniale qui semblait marginalisée, au centre de l’Afrique, en menant des raids audacieux qui les conduisent jusqu’aux rives de la Méditerranée. Le volet politique de cette conquête trouve sa traduction trois ans plus tard lors de la conférence de Brazzaville, qui constitue une forme de réponse, peut-être insuffisante, au manifeste du peuple algérien ou aux demandes d’indépendance du Maroc.
La France libre suscite beaucoup moins d’adhésion au Levant, avec une bonne partie des coloniaux qui restent favorables à Vichy. D’après l’auteur il reste des recherches à conduire sur le recrutement par Vichy de troupes coloniales à la fin de l’année 1941. Il semblerait qu’une politique d’intéressement et de primes ait été conduite. De la même façon en Indochine, comme au Levant, le gouvernement de Vichy mène une politique active de recrutement dans la coloniale avec une priorité donnée aux troupes « françaises ».
En Indochine le régime organise dès 1940 une traque aux officiers gaullistes. Dans le même temps une résistance clandestine se développe et après-guerre huit réseaux ont été « homologués ».
En Afrique du Nord, après le débarquement de novembre 1942, les troupes coloniales se retrouvent amalgamées à l’armée d’Afrique dirigée par le général Giraud. Les négociations entre le général Giraud, soutenu par les Américains et le général de Gaulle aboutissent le 2 juin 1943 avec la constitution du comité français de libération nationale. Cela permet d’aboutir à une sorte de panachage qui se traduit en août 1943 par la naissance de l’armée française de la libération. Le général Giraud commandant-en-chef se trouve placé sous l’autorité de Charles de Gaulle à la tête du comité de Défense nationale. Cet assemblage hétéroclite est envoyé en Europe sous le commandement du général Juin, un ensemble constitué de 112 000 hommes, dont 60 % des Maghrébins commandés par des officiers français.
Il reste une sorte de tabou sur les actes qui ont été commis à l’issue du combat ayant permis la libération de romans juin 1944, qui relève tout simplement de crimes de guerre sous forme de viol à l’encontre des populations civiles. Curieusement cette armée forgée dans le combat pour la libération se retrouve très largement imprégnée par une forme de racisme reprenant à son compte les préjugés à l’encontre des populations nord-africaines. L’engagement de troupes coloniales se retrouve également dans la remontée de la vallée du Rhône lors de la bataille des Vosges, même si progressivement ce que l’on appelle « le blanchiment » se traduit par une diminution relative des troupes « de couleur » dans les effectifs.
La démobilisation de ces troupes, pour ne pas dire clairement leur licenciement, ainsi que le retour de tirailleurs sénégalais, ancien prisonnier de guerre de l’Allemagne, a pour conséquences des tensions, aussi bien dans les casernes en métropole, mais également sur place. L’épisode de Thiaroye le 1er décembre 1944 suscite encore des polémiques, notamment sur le nombre de victimes. [1] On appréciera le récit précis et sans a priori de cet épisode dramatique dans les pages 282 à 286 de cet ouvrage. Le contexte de la sortie de guerre, mais incontestablement aussi l’état d’esprit de certains cadres, qui n’est pas dénué de préjugés, peuvent expliquer, sans justifier en aucune manière, ce qui a pu apparaître bel et bien comme un crime.
Reconfigurations et abandons.
De l’autonomie de troupes coloniales.
C’est dans le cadre de l’union française, créée en même temps que la IVe République en octobre 1946, que les troupes coloniales vont désormais évoluer. Depuis la conférence de Brazzaville et n’a pas été véritablement tranché sur les hésitations entre assimilation et association. Par ailleurs le personnel politique a parfaitement conscience que le rang de la France après-guerre doit beaucoup au maintien de sa présence sur tous les continents dans le cadre de l’empire, même si on cherche à ne plus utiliser ce terme.
Les militaires de la coloniale comme le général Bührer s’inquiètent très tôt du désintérêt de l’opinion publique française à l’égard des territoires lointains. Partisan du maintien de l’ordre, et bien entendu de la pérennité de la présence française, il propose une réorganisation et surtout une rationalisation de l’organisation de l’empire, sous forme d’une confédération générale de la France d’outre-mer. En réalité, le propos principal général se situe dans la volonté de maintenir la spécificité de la coloniale tandis que le général de Gaulle en 1945, mais une étude sur la fusion des troupes coloniales avec les troupes métropolitaines.
Comme souvent en France, on constitue un comité avec un aréopage d’académiciens qui a vocation à renforcer les échanges culturels entre la métropole et les territoires d’outre-mer, tandis que ce qui relève de la mise en valeur et de l’équipement des territoires reste toujours dispersé entre différents services. De façon paradoxale, alors que la guerre d’Indochine commence, sans parler des épisodes sanglants de Madagascar, les images de carte postale sur les territoires et paysages de l’union française fleurissent dans toutes les revues. Dans un contexte budgétaire contraint, notamment à partir de 1956, la vieille querelle sur l’autonomie ou la fusion de troupes coloniales se ranime. Sur fond d’atlantisme il est même envisagé de constituer un corps amphibie à l’américaine, celui de Marines associant les parachutistes, et considérés comme une arme à part entière. Évidemment ce projet se heurte à un manque de moyens évidents.
De nombreux projets fleurissent, comme celui de donner, dans le cadre de la communauté européenne de défense, une profondeur stratégique à la défense européenne en englobant l’Afrique. On retrouve le même type d’argument, sur fond de guerre d’Algérie, à propos de la responsabilité de l’OTAN, et du soutien qu’elle pourrait apporter à la France, même si les gouvernements successifs de la IVe République, sans parler du général de Gaulle s’y oppose fortement. Il convient de citer la personne du général Jean Étienne Valluy, proche de Raymond Aron, officier de la coloniale, mais également représentant de la France à l’OTAN.
Les paras colos, le saut dans la guerre.
Une partie des officiers de la coloniale estime que la guerre n’est pas achevée en 1945. D’autres théâtres d’opérations s’ouvrent en Indochine, à Madagascar, en Algérie. Les troupes envoyées sur les théâtres extérieurs doive faire face à deux problèmes simultanément, celui de la baisse des effectifs métropolitains, et celui du manque de moyens. Pour la métropole on privilégie l’armée de la nation, tandis qu’en Indochine, à partir de 1948, on assiste à une sorte de « jaunissement ». Les officiers qui commandent le corps expéditionnaire français en Indochine sont clairement issus de la coloniale, et ils mettent en œuvre le principe de la tache d’huile, avec une action civile en direction des populations.
Cela se retrouve très largement expliqué dans l’ouvrage de Dominique de la Motte, De l’autre côté de l’eau. Dans le même temps sont maintenus les usages coloniaux qui veulent que la marine conserve l’autorité sur l’armée de terre. Le général Leclerc est donc aux ordres de l’amiral D’Argenlieu. C’est dans ce contexte que prend corps la théorie de la guerre révolutionnaire et bien entendu des actions contre-révolutionnaires qu’il convie de mener. Il convient ici de citer le général Hogard qui propose de multiplier les postes détachées dans lesquels on trouverait des compagnies et de section coloniale.
D’un point de vue doctrinal, et même si l’on tient compte des évolutions de l’armement, les enseignements sont très largement inspirés de ceux de la conquête, avec une publication des écrits et des discours de Bugeaud. Ces officiers d’Indochine sont très clairement les formateurs de ceux qui sont servir en Algérie, surtout partir de 1956. La question de la mobilité et de l’action de la profondeur permet de mettre en valeur l’arme des parachutistes avec les commandos qui sont formés dans différents centres comme celui de Meucon ainsi que le centre national d’entraînement commando installé à Montlouis et à Collioure, et formé à partir de la 11 demi-brigade parachutiste de choc.
L’insurrection malgache déclenchée en 1947 a pour conséquence l’envoi de troupes, avec 18 000 tirailleurs. Face à des insurgés mobiles, la technique de la pacification développée par Gallieni repose sur des détachements motorisés autonomes, une façon de mettre en valeur la haute technicité et la modernité des troupes coloniales. Le problème est celui évidemment des moyens, avec un recyclage des stocks de matériel de l’armée américaine.
À propos de la guerre d’Algérie, sans forcément raconter son déroulement, il faut noter que les troupes coloniales sont dans une situation très particulière, l’Algérie relevant de l’armée d’Afrique. Les troupes coloniales présentes en Algérie sont essentiellement les troupes aéroportées avec les régiments de parachutistes coloniaux qui conduisent des actions de contre-guérilla. C’est à partir de 1956 que s’opère le lien avec la réflexion menée en Indochine sur la guerre révolutionnaire, comme celui entre le FLN et le communisme. L’élément principal en est la crainte d’un complot communiste, ce qui rappelle la thèse de la cinquième colonne, l’ennemi intérieur, héritage de 1940. À cet égard on peut constater que les évolutions précocement islamistes de certaines fractions du FLN ont été largement occultées.
C’est à partir de ses expériences multiples, de la constitution de différents centres d’études que son père la mutation de la coloniale vers ce que l’on appelle aujourd’hui les troupes de marine. L’appellation a été officiellement adoptée en mai 1961 avec une place spécifique au sein de l’armée de terre qui en fait une arme unique et à part entière. Ce sont d’ailleurs les troupes de marine qui entretiennent la mission éducative qui se poursuit aujourd’hui dans les régions d’outre-mer avec le service militaire adapté.
Au terme de cette longue fiche de lecture, il convient surtout de comprendre que le militaire a été très largement subordonné pendant toute la période de la conquête coloniale, mais également de la décolonisation au pouvoir politique. En même temps, des officiers généraux aux capitaines, une réflexion particulièrement riche a été développée, aussi bien sur le plan tactique, strictement militaire, qu’en termes d’action civilo-militaire favorisant le développement, et jusqu’à une période assez récente, la coopération.
On me permettra cette réflexion strictement personnelle à propos du retrait de la présence française outre-mer, spécifiquement en Afrique, dans un contexte très particulier qui celui de l’affirmation de ce que l’on appelle « le Sud global ». Au-delà des considérations purement militaires qui traduisent surtout la réussite des opérations extérieures, et face à des adversaires qui ne s’embarrassent pas de scrupules, peut-être que le personnel politique, en tout cas depuis 2017, aurait gagné à prendre en compte certaines réalités qui ne peuvent s’inscrire que dans la longue durée. Cela suppose que l’influence française puisse s’appuyer à la fois sur des structures et des moyens appropriés, mais surtout sur une volonté politique. Cet ouvrage d’histoire fait bien le lien entre le politique et le militaire qui sont en symbiose, et c’est sans doute cet enseignement qu’il faudrait en retirer si l’on veut envisager autre chose qu’un avenir dilué dans une sorte de confédération européenne, ce qui serait surtout la manifestation d’un rétrécissement.
[1] Le président français Emmanuel Macron a reconnu jeudi 28 novembre 2024 que les forces coloniales françaises avaient commis un « massacre » contre des tirailleurs africains en 1944 près de Dakar, a indiqué le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a salué un « pas important » vers la vérité dans un entretien avec l’AFP.
À lire aussi :