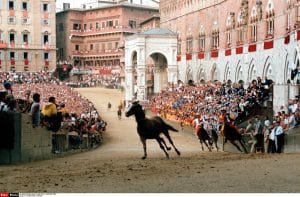La relation France-AMLAT est contrastée. Pire, il y a comme le sentiment d’un potentiel inexploité tant les pays latinos sont volontaires sur la scène internationale, en constante quête d’autonomie géopolitique. Pour la France, il y a donc toute une relation à développer.
Pour faire suite à cette réflexion, nous nous proposons dans ce papier d’en finir avec la « non-stratégie » de la France sur le sous-continent ; en d’autres termes, de proposer des leviers concrets de coopération économique, politique et sécuritaire.
À lire également : Quelle diplomatie pour la France en Amérique latine ?
La France confrontée à un « déni de reconnaissance »¹
Lorsque nous observons la plupart des cartes des organisations régionales (OR) d’Amérique latine, les DROM-COM français donnent l’impression d’archipels isolés. La France ne fait pas partie des grandes OR telles que l’UNASUR, la CARICOM ou la CELAC, laquelle est privilégiée par la Chine pour annoncer ses grands investissements dans la région. De fait, les États latinos rejettent la présence française dans la région, perçue comme une puissance coloniale.
Parfois, par un jeu de dissociation, les DROM-COM sont membres associés en leur nom propre comme la Martinique au sein de la CARICOM. Dans les faits, cette représentativité est caduque puisque l’État est seul compétent pour les « affaires extérieures » de la France.² Flattant d’un même coup les velléités autonomistes des DROM-COM et la position de rejet des États latinos, la France se compromet dans l’exercice de sa souveraineté sur des pans de son territoire national. Œuvrer à son intégration dans ces OR constitue donc une première étape.
Pour une stratégie française axée sur les relations bilatérales
En dépit de la douzaine d’OR d’AMLAT, l’intégration régionale du sous-continent est peu aboutie et laisse place à un ensemble géopolitique fragmenté. Ainsi, si intégrer ces OR demeure un facteur légitimant pour la France, celle-ci devra privilégier ses relations bilatérales pour une stratégie efficace. De fait, le bilatéralisme (i.e. ce qui est fondé sur une opposition symétrique) est au cœur de la pensée réaliste.
La confrontation Brésil–Argentine stimulait jadis le jeu géopolitique régional car le Mexique a toujours été un cas à part tourné vers l’Amérique du Nord. Si le Brésil s’est érigé comme la puissance principale du sous-continent tandis que l’Argentine était empêtrée dans des crises sans fin, l’ambition retrouvée de Buenos Aires ainsi que l’essor du Salvador et du Guyana ouvrent aujourd’hui d’autres perspectives. Il y a un enjeu pour la France à développer ses échanges avec l’AMLAT qui ne dépassaient pas les 22 Mds€ en 2024 (2 % de son commerce extérieur).
Le Brésil, première puissance d’AMLAT, pilier de la stratégie française dans la région ?
En 2024, le Brésil accueillait 40 Mds€ d’IDE français, 1 100 entreprises françaises générant 520 000 emplois et 61 Mds€ de C.A.³ pour des échanges bilatéraux dépassant à peine 8 Mds€ (1er partenaire commercial de la France). La France est un partenaire historique du Brésil dans le domaine de la Défense (1er ou 2e fournisseur d’armes entre 2000 et 2021⁴, programme de sous-marins conventionnels PROSUB, Partenariat stratégique de 2006, etc.).
Paris cherche des leviers de coopération supplémentaires avec Brasilia, tel qu’un éventuel transfert de technologies pour développer un sous-marin nucléaire brésilien. L’armée brésilienne a des besoins capacitaires dans les domaines spatial, des obusiers automoteurs à roues, des hélicoptères moyens polyvalents, de la Marine, etc., domaines dans lesquels la France excelle. Cependant, l’influence chinoise au Brésil pose des questions de sécurité pour les industriels français (espionnage industriel). Cette influence chinoise est telle qu’elle lui confère un poids dans la fixation des prix de l’électricité au Brésil, un pouvoir d’ingérence dans la justice brésilienne, dans la fixation des normes, la collecte de données, etc.⁵
Si le secteur de l’agriculture suscite des tensions entre les deux pays, comme l’illustre l’accord UE–Mercosur dont la France sortirait affaiblie, les deux pays pourraient miser sur l’énergie (hydrocarbures, hydraulique, nucléaire), le numérique, la santé, le tourisme, etc.
L’ambition retrouvée de l’Argentine
L’Argentine cherche à dynamiser sa croissance et est en quête de partenaires. C’est dans un contexte de hausse des IDE français en Argentine (+43 % en un an, soit 7,6 Mds€ en 2024) qu’un mémorandum d’entente sur le secteur minier a été signé en 2025. Des perspectives de coopération existent également dans les domaines sécuritaire, énergétique, numérique, pharmaceutique, de la pêche, etc. D’autant plus que son président envisagerait de quitter le Mercosur afin d’engager l’Argentine dans d’autres accords commerciaux.
L’alignement ouvertement pro-occidental de J. Milei constitue également une opportunité pour la France en quête de partenaires, même si le profil du président est incompris en France. Son discours au sommet du G20 a pourtant été clair sur sa volonté de changement sur la scène internationale : moins de « gouvernance mondiale » et plus de « souveraineté des nations ».⁶ À bon entendeur…

Javier Milei et Emmanuel Macron avant la troisième conférence des Nations-Unies sur l’Océan. 9 juin 2025, Nice, France. (AP Photo/Laurent Cipriani, Pool)
À lire également : l’Argentine de Javier Milei, antichambre du libéralisme européen ?
El Salvador, nouveau partenaire en Amérique centrale ?
Depuis que les gangs ont été mis au pas, le Salvador cherche à attirer des IDE notamment dans les secteurs informatiques, financier (cryptomonnaie), des infrastructures, énergétique (géothermie), etc. Le jeune président réélu N. Bukele cherche également à exporter son modèle sécuritaire dans la région en favorisant des échanges d’information, des coopérations, des formations, etc. Le Salvador coopère avec les États-Unis dans la lutte contre le narcotrafic et devrait à terme représenter un partenaire fiable pour les armées françaises sur la façade Pacifique. Derrière l’attitude bravache du jeune président salvadorien, il existe un réel projet de développement économique et de soft power digne des *« petites puissances »*⁷ pour le Salvador dans la région.
Le Guyana, nouvel acteur du plateau des Guyanes
Le petit pays du Guyana constitue également un levier plausible pour toute stratégie française ambitieuse sur le sous-continent. Misant sur les retombées de l’exploitation pétrolière, le Guyana cherche des partenaires dans tous les domaines (économie, finance, sécurité, etc.) pour accompagner sa croissance vertigineuse (+43 % de croissance en 2024). Les secteurs agricole, minier, forestier et touristique constituent des opportunités de croissance dans ce pays.
La Chine y construit à tour de bras des infrastructures pour connecter le petit pays aux flux commerciaux régionaux, dans les réseaux électriques et d’assainissement, et investit dans l’extraction minière (or, bauxite, aluminium), etc. Les entreprises françaises devraient également se positionner (Vinci, Veolia, etc.). Le pays sort de terre, mêlant initiatives privées et publiques, parfois de manière un peu anarchique. Pays au carrefour des influences chinoises, indiennes et émiraties, le Guyana cherche des partenaires sur la scène internationale pour exister en dépit des menaces vénézuéliennes.
Orienter les IDE français vers les minerais, les hydrocarbures et l’énergie
L’Amérique du Sud fournit à elle seule 15 % de la production mondiale de pétrole, 5 % pour le gaz, détient les principales réserves de minerais industriels (aluminium, cuivre, fer, etc.), dont 60 à 80 % du lithium mondial, et des métaux rares (tungstène, cobalt, etc.). La Chine a massivement investi dans ces secteurs en leur ayant consacré la majorité de ses IDE pour la région, soit 75 % dans les hydrocarbures, les minerais et l’énergie sur un total de 200 Mds€ entre 2000 et 2024.⁸
La France pourrait diversifier ses sources d’approvisionnement en hydrocarbures et en minerais afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États arabes, du Maghreb et de la Chine. Dans la lignée de ce qui a été initié en Argentine (usine d’Eramet à Centenario), il serait pertinent d’orienter des entreprises françaises vers le secteur minier au Chili, au Pérou et en Argentine. En nouant des partenariats et en procédant à des acquisitions croisées, des acteurs miniers de ces pays pourraient apporter leur savoir-faire dans les projets d’extraction de lithium lancés dans l’Est de la France. Après 20 ans de gouvernement socialiste fermé aux investissements occidentaux, la Bolivie pourrait s’ouvrir après la défaite historique du MAS aux dernières élections.
Placer les DROM-COM latinos au cœur du renouveau stratégique français en AMLAT
Si les DROM-COM caribéens et sud-américains ont un PIB par habitant plus élevé que la moyenne régionale, ils sont en réalité ignorés par les « politiques nationales ».⁹ Par conséquent, ils font face à des enjeux considérables liés au développement, à la sécurité, à la santé publique, etc. Cela affecte la crédibilité de la France en AMLAT, renforçant le discours anticolonialiste des États latinos. Véritables atouts géographiques (92 % de la ZEE française), les DROM-COM ne bénéficiaient pourtant pas de déclinaison spécifique au sein de la stratégie nationale portuaire de 2021. C’est dire le degré d’ignorance des élites métropolitaines.
Ainsi, le renouveau de la stratégie française en AMLAT doit être lié au développement de ces territoires éloignés et à une intégration de leurs réalités géographiques dans la pensée française à l’égard de la région. Par exemple, lorsque le chercheur Paco Milhiet propose de replacer les DROM-COM du Pacifique et de l’océan Indien au centre du concept stratégique d’Indo-Pacifique au moyen de « déclinaisons locales », nous proposons de faire de même avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour la France en AMLAT. L’île de Clipperton doit également être prise en compte, son état d’abandon participant au discrédit de la France dans la région.
À lire également : La France vue du Monde. Le Chili et la France, appartenances et opportunités multiples
Placer les DROM-COM latinos au cœur des dynamiques régionales
Le Guyana dynamise le plateau des Guyanes tandis que les aménagements colossaux de la Chine dans le nord-ouest brésilien fluidifient les routes d’exportation de la région. Même le petit narco-État du Suriname est à un tournant avec la mise en exploitation prochaine de son pétrole, où l’entreprise française Total investit plus de 10 milliards €. En mettant à profit son positionnement entre l’Atlantique et les Caraïbes, la Guyane pourrait se spécialiser dans le commerce de cabotage maritime, ainsi que le raffinage pétrolier avant réexportation.
Quant aux îles des Caraïbes, les deux ports de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre sont parmi les plus importants de France (tonnage et conteneurs) grâce à leur positionnement géographique. Ces deux territoires pourraient devenir des plateformes logistiques régionales alliant commerce de cabotage et interocéanique. En imaginant un statut particulier au sein de l’UE, voire leur sortie, ces territoires pourraient se doter de zones franches logistiques et industrielles plus abouties que les nébuleuses Zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) créées en 2019.
La coopération sécuritaire comme levier d’avenir
Les Forces armées en Guyane (FAG) et aux Antilles (FAA) constituent le meilleur atout de la France dans la région. Fortes de 3 300 militaires, elles déploient quotidiennement leurs compétences opérationnelles dans la lutte contre les trafics (or, drogue, pêche, etc.), en soutien des populations civiles, ainsi que lors d’opérations et d’exercices multinationaux (DUNAS 2025, NARCOPS, etc.).
Elles contribuent à la formation des armées partenaires (Centre d’entraînement à la forêt équatoriale de Guyane) et à la protection du Centre spatial guyanais. Forte de ces capacités opérationnelles éprouvées, l’armée française pourrait agir comme un facteur de stabilisation sécuritaire en mettant à profit le positionnement des DROM-COM telles des « plateformes de projection de puissance ».¹⁰ Les DROM-COM partageant des problématiques sécuritaires de la région (trafics, criminalité organisée, sécurité maritime, immigration, etc.), la France pourrait nouer de nouveaux partenariats sécuritaires. Par exemple, le Guyana et le Suriname souhaitent pour leurs armées de la formation, du matériel et du partage de renseignement, tandis que la Colombie aussi veut accroître la coopération en matière de renseignement. Un nouveau partenariat sécuritaire régional pourrait être fondé sur le triptyque : lutte contre les trafics, rédaction d’une « Revue stratégique régionale » et développement capacitaire des partenaires. Logiquement, le Brésil percevra cette initiative sécuritaire française avec méfiance. Il faudra alors lui concéder un rôle central dans cette nouvelle architecture sécuritaire régionale. Par exemple, l’emploi d’avions légers d’attaque tels que les Super Tucano brésiliens serait pertinent en Guyane française pour assurer la police du ciel et la lutte contre les trafics.
À lire également : Amérique latine : le défi des frontières
¹ Causes of War. The Struggle for Recognition, Thomas Lindemann, 2010, Colchester, UK, ECPR Press
² Selon le Code général des collectivités territoriales
³ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/relations-bilaterales/
⁴ Estrada Gaspard, Martin Kevin, « Avec le retour de Lula à la tête du Brésil : comment repenser le partenariat stratégique en matière de défense ? », Note de la DRGRIS et Sciences Po, Observatoire stratégique de l’Amérique latine
⁵ https://dialogo-americas.com/articles/chinas-expanding-playbook-legal-and-political-influence-in-latin-america/
⁶ https://www.revueconflits.com/no-cuenten-con-nosotros-la-vision-du-monde-de-javier-milei/
⁷ https://www.diploweb.com/Les-petites-puissances-quelle-strategie-diplomatique.html
⁸ Site de l’American Enterprise Institute (AEI), China Global Investment Tracker, consulté en ligne le 9 juillet 2025
⁹ M. Philippe Folliot, Mmes Annick Pétrus et Marie-Laure Phinera-Horth, Les outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale, Rapport d’information sénatorial au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer, 24 février 2022
¹⁰ M. Philippe FOLLIOT, Mmes Annick PETRUS et Marie-Laure PHINERA-HORTH, Les outre-mer au cœur de la stratégie maritime nationale, op. cit