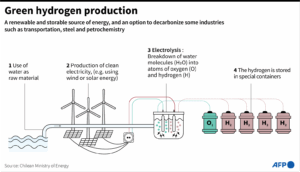Opportuniste et pragmatique sur la scène internationale, mais bousculée sur le plan de la politique intérieure, la Turquie traverse une époque importante de son histoire. Journaliste de terrain, Ariane Bonzon apporte un éclairage sur la situation générale du pays à l’heure du remodelage du Moyen-Orient, de l’effacement progressif de l’Europe en matière de géopolitique et de la crise économique qui frappe aujourd’hui la Turquie.
Propos recueillis par Étienne de Floirac.
Vous titrez votre ouvrage Turquie, l’heure de vérité. Qu’entendez-vous par là ? La Turquie se situerait-elle à un tournant et un moment clé de son histoire ?
En juin 2018, le président Erdoğan est réélu au suffrage universel, ce qui va lui permettre d’instaurer le régime présidentiel qu’il avait fait approuver par référendum l’année précédente, un système qu’il appelait de ses vœux depuis des années – bien qu’il y ait eu, jusqu’au sein de son parti, le parti de la justice et du développement (AKP), une forte opposition à ce modèle-là. L’argument de M. Erdoğan était de dire que le système présidentiel permettrait des prises de décision rapides et efficaces, une certaine stabilité politique et une meilleure gouvernance au sein de l’appareil d’État. L’heure de vérité est donc arrivée pour un premier bilan.
La seconde « heure de vérité » est géopolitique. Dans la mesure où il y a tout un pan de l’histoire turque qui est fortement lié à l’Europe, alors qu’Ankara mène une politique nettement antioccidentale et antieuropéenne, le vieux continent doit se positionner et dire ce qu’elle veut faire avec cette « nouvelle » Turquie.
Enfin, heure de vérité pour la popularité du président turc. En effet, le contrat social que M. Erdoğan avait passé avec si ce n’est son peuple, au moins son électorat, promettant la croissance économique, le relèvement interne du pays, est à bout de souffle du fait de la crise économique que traverse la Turquie.
Comment pourriez-vous qualifier le régime politique turc, personnalisé par R.T. Erdogan ? Sommes-nous en présence d’une démocratie illibérale, d’un populisme, d’un régime autoritaire ?
C’est un régime autocratique, ainsi que le qualifie l’un des meilleurs constitutionnalistes turcs. En effet, il n’y a plus de séparation de pouvoirs, car tous sont concentrés dans les mains du président Erdoğan qui nomme les ministres et vice-ministres et qui peut gouverner par décrets, ce dont il ne se prive pas.
Depuis la mise en place de ce système présidentialiste, la plupart de ces décrets ont cependant consisté à modifier les conditions de nomination, afin de permettre aux proches du président de pouvoir intégrer, entre autres, l’administration centrale. Dans le domaine judiciaire, c’est M. Erdoğan qui nomme directement la plupart des membres du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil constitutionnel afin de mettre la justice sous sa férule. Il a également institué des comités spéciaux thématiques entre lui et les ministres, ces comités étant supposés donner les grandes lignes politiques. Or cela ne fonctionne pas puisque tout remonte à lui finalement. En résumé, la Turquie est devenue un régime centré sur la personne du président et, de manière plus doctrinale, basé sur une alliance entre les nationalistes et les islamistes depuis 2015-2016.
La première alliance que M. Erdoğan avait nouée, à son arrivée au pouvoir en 2002, avec la mouvance islamique, dirigée par un imam auto-exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, semblait plutôt pro- européenne et pro-occidentale. L’enjeu, pour M. Erdoğan, était de maitriser et tenir l’État, alors aux mains de l’establishment politico-militaire kémaliste. Or, la « mouvance guléniste » comptait de nombreux membres dans l’appareil d’État, la justice, la police et l’armée, ce qui a permis à M. Erdoğan d’en gagner le contrôle. Jusqu’à ce que ces deux alliés s’affrontent pour le partage du pouvoir. La mouvance guléniste, qui ne tient pas sa légitimité des élections populaires, en voulait de plus en plus et particulièrement au sein des services secrets. Ce qui va conduire à la rupture et à des purges répétées de la part du président Erdoğan.
C’est cela, cette bataille au sommet de l’état, et cette rupture d’alliance qui explique le changement : au début, M. Erdoğan, apparaissait plutôt comme un musulman conservateur avec une certaine aspiration démocratique, puis il s’est tourné vers les ultranationalistes, d’autant que son parti l’AKP ne pouvait plus lui garantir la majorité parlementaire sans contracter une alliance avec le parti ultranationaliste, le MHP. On peut donc dire que M. Erdoğan adopte souvent la posture que lui imposent les circonstances et les opportunités politiques.
A lire aussi: Fenêtre sur le monde. Le réveil de la Turquie
Parlons à présent de la relation russo-turque qui apparaît comme manifeste, notamment depuis le putsch manqué de juillet 2016. Comment pourriez-vous caractériser ce partenariat, qui s’est également illustré dans le récent conflit au Haut-Karabakh ?
La relation turco-russe est passionnante, en termes d’analyse stratégique ! Au début, nombre d’observateurs prédisaient qu’elle ne tiendrait pas trois mois. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. Rappelons-nous la tension entre ces deux pays lorsque les Turcs avaient abattu un avion russe sous prétexte qu’il aurait survolé leur territoire. Vladimir Poutine avait alors répondu comme peu de gens répondent à M. Erdoğan : un embargo sévère et les touristes russes étaient priés de ne plus se rendre en Turquie. Mais les relations se sont ensuite apaisées, à tel point que l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara, ce qui était une manière par leurs auteurs de dénoncer le rapprochement turc avec les Russes, a été étouffé même si on ne peut exclure qu’il y ait eu des négociations en coulisses.
Le djihadisme tchétchène a longtemps constitué une pierre d’achoppement entre la Russie et la Turquie. En effet, Moscou soupçonnait Ankara, non sans raison, de protéger voire de soutenir la rébellion tchétchène. À la suite de l’avion abattu, Moscou et Ankara ont négocié un accord selon lequel la Turquie ne renouvellerait pas un certain nombre de visas de réfugiés politiques tchétchènes. Ce qu’elle a fait.
Dans quelle mesure le coup d’État du 15 juillet 2016 acte-t-il le rapprochement entre les deux pays ?
On a pu dire que ce furent les Russes qui auraient informé les Turcs de l’imminence du coup d’État de juillet 2016. Ce qui est sûr, c’est que Moscou s’est tout de suite alignée du côté de M. Erdoğan alors que l’Europe a fait grise mine, estimant ne pas comprendre ce que signifiait cet étrange putsch. La rupture avec le mouvement guléniste a également poussé le président Erdogan dans les bras des ultranationalistes et des Eurasistes, anti-OTAN, prorusses ou panturquistes pour la plupart. Autant d’éléments qui actent le rapprochement avec la Russie.
Dans quelle mesure la similitude des régimes politiques turcs et russes peut-elle favoriser une relation de confiance entre les deux chefs d’État ?
Le président Erdoğan a beaucoup appris de son homologue russe, en particulier sur la maîtrise et la nécessité de posséder un outil de communication et de désinformation performant. Il le rejoint voire le dépasse quant à la mise sur pied d’un narratif anti-européen et antioccidental. L’instrumentalisation par M. Erdoğan des flots de réfugiés va dans le sens de l’affaiblissement de l’Europe que M. Poutine peut rechercher.
En revanche, leurs positionnements respectifs en Syrie, en Lybie, et maintenant dans le Caucase, sont plus différenciés.
En Syrie et en Libye, ils ont certes réussi à définir un espace de collaboration, mais dans le Caucase, dans l’espace post soviétique donc, la tension s’est accrue. Cette région est le pré carré de M. Poutine. Le test pourrait venir lorsque M. Erdoğan voudra installer une base militaire en Azerbaïdjan, comme on lui en prête l’intention.
M. Erdoğan semble parfois n’avoir pas de limites, en ce sens, il peut un jour faire le pas de trop. Il me semble que M. Poutine (avec M. Biden désormais ?), est l’un de ceux qui peuvent le plus efficacement freiner les ambitions de M. Erdoğan : après tout ils parlent le même langage et n’ont pas de scrupules à utiliser la force. On l’a vu lorsque les Russes ont dernièrement bombardé et tué plusieurs dizaines de militaires turcs en Syrie : comme une sorte d’avertissement à Ankara.
Mais ayons tout de même à l’esprit que M. Erdoğan n’est pas complétement aligné sur la Russie, car ne reconnait pas la Crimée comme russe, notamment, et qu’il entretient de bonnes relations avec la Biélorussie ou la Moldavie, qui voient en Ankara un moyen de faire un pas de côté par rapport à Moscou. Cependant, la Russie a indéniablement permis à la Turquie de ne plus être un pays de second ordre, en l’incluant entre autres les négociations tripartites (Iran, Turquie, Russie) d’Astana.
Ankara est dépendante du gaz russe et les deux pays ont en commun le gazoduc TurkishStream. Or la Turquie veut devenir un hub énergétique, autrement dit contrôler au maximum l’approvisionnement de l’Europe. C’est ce projet qui explique aussi le soutien militaire d’Ankara à l’Azerbaïdjan qui devrait lui permettre un accès direct à la mer Caspienne. Ainsi, nous présentons souvent les conflits de manière idéologique, mais nous oublions souvent qu’ils sont aussi basés sur des projets concrets.
Notons enfin qu’à son arrivée au pouvoir M. Poutine, en tant qu’ancien des services secrets, avait plus ou moins le contrôle et le soutien de l’armée. Ce qui n’était pas le cas de M. Erdoğan qui a dû conquérir cette maîtrise des services et de l’armée, pour autant qu’il y soit parvenu. Dans ce domaine stratégique donc, M Poutine conserve une longueur d’avance.
Erdogan semble mettre en avant le nationalisme et la puissance sur la scène internationale pour faire oublier ses difficultés sur le plan intérieur. Mais est-il réellement en difficulté d’un point de vue économique ?
Les difficultés économiques sont bien réelles. Le PIB par habitant est tombé de 12 500 dollars en 2013 à 9 000 dollars l’année dernière. Et il faut au pays environ 200 milliards de dollars, soit 1/4 de son PIB, pour rembourser la dette privée extérieure en grande partie arrivée à échéance.
Les investissements extérieurs, qui avaient explosé en 2007, au moment où les négociations à l’intégration européenne commençaient, ont chuté de plus de 50% entre cette date et 2019. Ils sont passés de 16 milliards à 7 milliards d’euros. Or il faut des investissements pour créer des emplois dans ce pays où le chômage tournerait autour de 25% tandis que les actifs ne représentent même pas 50% de la population totale. Mais la confiance n’est plus là d’autant que le régime passe son temps à modifier les règles d’adjudication des marchés publics, ce qui a miné la confiance des investisseurs.
Le contrat social, établi entre le pouvoir et le peuple sur une promesse de prospérité économique, bat de l’aile.
A lire aussi: La grande ambition d’Erdoğan
Comment la population réagit-elle ?
Les sondages sur la popularité du président sont en baisse. Or, M. Erdoğan est obsédé par cela. Il entend pallier ses difficultés sur le plan intérieur par un vrai projet de puissance régionale, de hub énergétique et, surtout, de remise en cause des statu quo : sur les frontières maritimes en Méditerranée ou avec l’intervention dans le Caucase. D’autant plus que l’on s’approche du centenaire de la République de Turquie, et tout autocrate qu’il est, il veut laisser sa marque dans l’histoire.
À propos de popularité, comment expliquez-vous que les diasporas turques, spécialement en France, supportent avec autant de ferveur R.T. Erdogan ?
La diaspora turque n’existe pas en tant que telle, car elle est très hétérogène. En effet, la plupart des courants turcs y sont représentés. Elle est donc diverse et toute la communauté ne soutient pas le président Erdoğan. Mais les deux extrêmes, l’AKP et le Parti démocratique des peuples (HDP, kurde autonomiste, dont une branche soutient le PKK) sont surreprésentés, ce qui explique que l’on vote plus pour le Président Erdoğan en France qu’en Turquie ! C’est un phénomène d’allégeance classique, mais aussi identitaire.
Ajoutons à cela que les Turcs à l’étranger sont assez encadrés notamment par le biais de l’appareil des affaires religieuses qui dispose d’une branche en Europe. Parmi les 300 imams détachés en France, 150 sont Turcs, alors que la communauté turque tourne autour de 500 000 personnes. Bien organisée et très structurée, la diaspora turque pro-Erdogan fait donc échos à ses penchants nationalistes et islamistes. Le lien Turquie-diaspora a récemment été mis en avant par la dénonciation de la supposée islamophobie de la France par le président Erdoğan.
Comment envisagez-vous les élections générales de 2023, année qui sera d’ailleurs celle du centenaire de la création de la République par Mustafa Kemal ?
Là où M. Erdoğan joue fort, c’est que toutes ses projections de puissance militaire sont soutenues bien plus largement que par le seul camp islamo-nationaliste. L’opposition kémaliste et nationaliste ne critique pas les interventions militaires en Libye, en Méditerranée et avec l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh, elle les approuve. Je ne dis pas que cela lui fait gagner des voix – les gens privilégient l’économie – mais cela ne lui en fait pas perdre.
Il faut savoir que M. Erdoğan pourrait très bien tomber si un front se dégageait au Parlement : il suffirait que 60% des députés décident que le Parlement soit dissous ce qui entraînerait automatiquement (« effet guillotine ») de nouvelles élections présidentielles en même temps que législatives. Or le camp présidentiel est encore majoritaire et l’opposition trop divisée pour cela.
Quelle figure émergera en 2023 qui puisse éventuellement le concurrencer ? Difficile à dire. L’actuel maire d’Ankara peut-être, Mansur Yavaş ? La réélection du numéro 1 turc dépendra de la capacité de sa coalition, qui ne dit pas son nom, à survivre encore trois ans. Étant donné qu’il ne peut plus avoir de majorité parlementaire sans s’allier, elle lui est donc indispensable. Mais la force de M. Erdoğan réside aussi beaucoup dans les faiblesses et divisions, qu’il sait parfaitement creuser, de l’opposition.