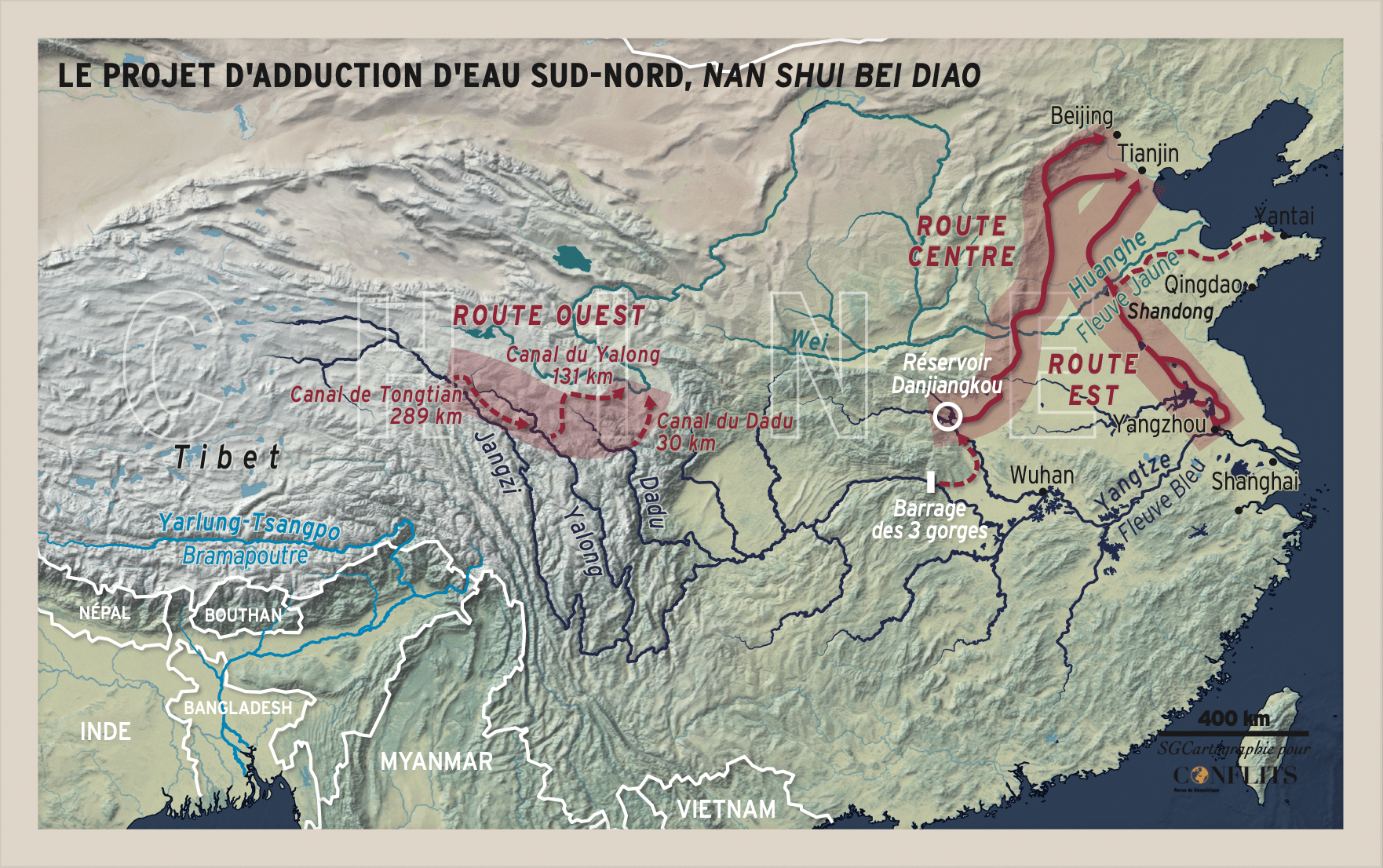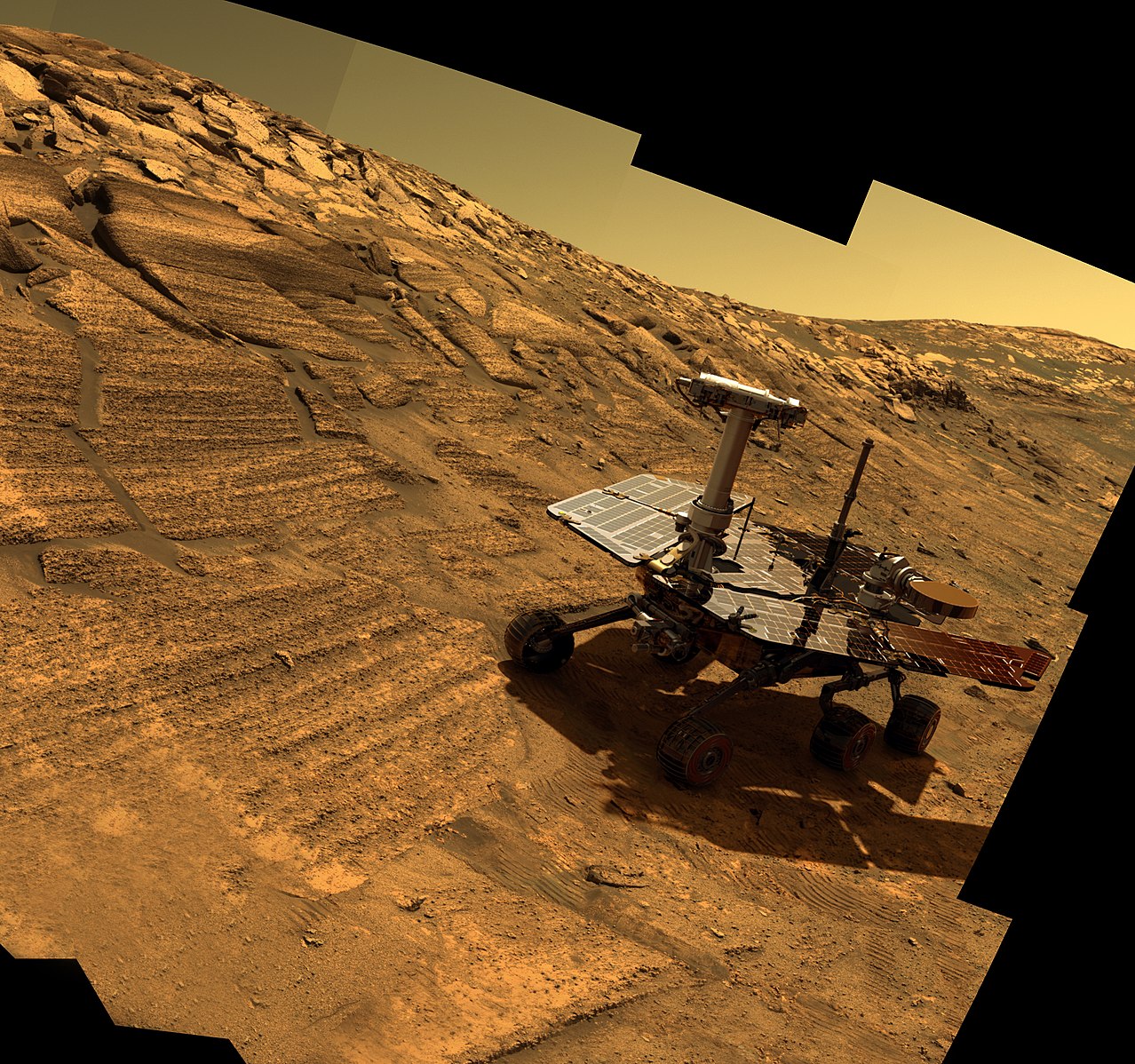Mythologiquement et historiquement, la ville apparaît comme le lieu du pouvoir, parce que le pouvoir s’y manifeste dans sa volonté efficace d’organisation, de circulation, de domination des hommes. Elle apparaît comme l’artefact par excellence qui déploie les pouvoirs spécifiquement humains dans un espace concentré. La ville est donc le concentré du pouvoir.
Si le pouvoir n’est tel que par sa capacité à mettre en perspective le monde, à l’ordonner selon ses perspectives, il s’accomplit jusque dans sa capacité à se rendre maître de sa propre visibilité. Par là il est le souverain metteur en scène de lui-même. Pas de pouvoir sans théâtre du pouvoir, pouvoir de représentation. Le pouvoir, par-delà sa capacité à contraindre par la force matérielle, est toujours et surtout de nature symbolique, pouvoir de commander la vision que l’on a de lui-même et du monde. C’est ce qui donne à tant de villes et de capitales leur dimension théâtrale. Lieu du pouvoir, la ville est par excellence le monde de la représentation spectaculaire et spéculaire de ce pouvoir.
La ville, concentré du pouvoir
Nos mythes de fondation urbaine articulent deux thèmes : la violence de la fondation inaugurale qui défigure une unité préalable et la loi qui vient protéger cette fondation de toute nouvelle violence. Les mythes relient ainsi la ville à une première et dernière violence, mais le pouvoir n’est-il pas justement dans cette capacité fondatrice et violente qui se veut définitive ? Et en même temps cette relation du pouvoir à sa violence primordiale entache l’avenir de la ville d’une obscure malédiction qui appelle toujours plus de pouvoir comme capacité de maintien d’un ordre d’autant plus pacificateur qu’il porte en germe son contraire.
La Genèse raconte, par exemple, que Caïn, le laboureur, après le meurtre de son frère Abel, le berger, « s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Eden ». Il bâtit une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Hénoc. Caïn, le laboureur qui fracture, fend et blesse la terre par le sillon, est donc le père mythique de la ville. Hénoc eut pour demi-frère Tubal-Caïn, qui forgeait « tous les instruments de fer et d’airain ». Significativement édifier une ville, c’est tracer positivement une délimitation au sein de l’unité primordiale : le grec polis désignait originellement le mur d’enceinte, le latin urbs dérive de orbis, le cercle, l’anglais town, ainsi que le rappelle H. Arendt dans La Condition de l’homme moderne, se rattache à la racine qui a donné l’allemand Zaun, la haie.
Romulus, en même temps qu’il trace les limites de Rome par un sillon, pose la première loi de la ville qui interdit à quiconque de le franchir, comme si le véritable rempart de la cité était sa loi. On sait que Rémus enjamba le sillon et fut immédiatement mis à mort par son frère jumeau, comme si, encore une fois, la ville brisait nécessairement l’unité primordiale.
Ainsi l’histoire des villes n’est-elle que le long cycle des prises de pouvoir par destructions et reconstructions urbaines, réactualisation de la genèse mythique du pouvoir et de la ville. L’instauration d’un nouvel État (y compris dans la prétention à un nouveau Califat) ne va pas sans le choix identificateur de sa capitale, que l’on désire souvent au centre du territoire, selon une double préoccupation de domination et de protection. Car dans l’imaginaire du pouvoir, son lieu naturel est dans un enchâssement de centres de cercles concentriques ; véritable sanctuaire, Saint des Saints, centre de tous les centres, le centre-ville de la capitale réunit tous les lieux de pouvoir, qu’ils soient religieux, culturels, économiques, politiques. L’excentrement est la trace de son affaiblissement : Versailles en marge de Paris garde la trace de la blessure qui révèle sa fragilité : le terrible souvenir royal de la fuite d’Anne d’Autriche avec le jeune Louis XIV et son frère, Philippe, devant la Fronde ; l’excentrement de Vienne dans le territoire autrichien figure la trace de la ruine de l’Empire austro-hongrois.
Le centre urbain est ce point de convergence qui unifie parce qu’il irradie et diffuse.
A lire aussi : Málaga, la ville espagnole dynamique qui aspire à mieux
La ville, lieu de la représentation spectaculaire et spéculaire.
Le pouvoir n’est pas tant pouvoir de que pouvoir sur : la capacité de faire adopter par les hommes des comportements qu’ils n’auraient pas eus spontanément n’est jamais que le pouvoir d’agir sur leurs représentations, celles par lesquelles ils se déterminent. L’homme est bien cet être qui agit d’après ses représentations. Le pouvoir, à l’inverse de la force, agit donc de façon médiate, par le biais des représentations qu’il manipule. C’est ce en quoi nous pouvons dire qu’il est de nature plus symbolique que matérielle ou strictement physique. Et même en période de crise, là où le symbolique ne fonctionne plus assez dans ses effets de persuasion idéologique, ce n’est cependant jamais à une pure et simple force brute que l’on a affaire, mais à une démonstration de force : la force y joue selon un double registre, celui physique de la brutalité immédiate, celui de la force transformée en signe spectaculairement démonstratif de la puissance. Les défilés militaires n’ont d’autre effet ; les cérémonies terrorisantes d’exécution capitale publique de même.
Le pouvoir doit donc toujours produire du spectacle, son spectacle dans un double sens.
En premier lieu, il s’affiche dans sa puissance organisatrice visible, dans son écriture de l’espace. Tout grand homme de pouvoir est un grand architecte : Périclès change le visage d’Athènes en faisant appel à Phidias ; la révolution urbaine médiévale des xiie et xiiie siècles est inséparable de nouveaux sky-lines, ponctués de cathédrales, beffrois et tours communales où se lisent les mutations du pouvoir. Tout Prince italien de la Renaissance reconfigure également sa ville selon les modèles d’une rationalité idéale dominée par les perspectives aérées qui permettent l’extrême visibilité quasi-panoptique[1] de la ville depuis les lieux centraux de pouvoir.
L’organisation urbaine répond alors aux mêmes critères que ceux qui ont, par exemple, commandé les décors en perspective du teatro olimpico de Vicence, que ceux qui commandent le triomphe de la perspective géométrique dans la peinture de la Renaissance. Il s’agit d’organiser un espace d’extrême visibilité depuis un point de rayonnement central idéal devant la scène du théâtre, comme devant le tableau, comme depuis le centre de la ville et ses lieux de pouvoir, point pertinemment appelé l’œil du maître ou du Prince, celui de la loge d’où le spectacle du monde prend clairement forme. Certes au fil de l’histoire, l’écriture de l’espace par le pouvoir évolue, tel style urbanistique est un style de conception et d’exercice du pouvoir, mais parce qu’il en va du pouvoir, la stratégie de la bonne visibilité prime. Songeons à la destruction, par Haussmann et le Second Empire en quête de perspectives sans angle mort, des méandres obscurs du vieux Paris médiéval auquel Hugo rend hommage dans Notre-Dame de Paris.
Cette écriture de l’espace conjugue donc un double impératif corrélatif : voir et se donner à voir.
La ville, lieu de la mise en scène du pouvoir
En second lieu, si le pouvoir est bien tel, pensé sur le modèle d’un sujet ordonnateur (le Prince, l’État souverain et son incarnation dans le chef de l’État), il ne va pas sans la capacité à conditionner nos perceptions par son image, c’est-à-dire littéralement qu’il se montre, au sens où il reste maître de sa propre manifestation en se mettant en scène. C’est en cela justement que le style architectural des bâtiments dits officiels est politique : il imprime l’idée que le pouvoir entend faire passer de lui-même et pérenniser dans l’inébranlable. Napoléon III fut frappé par la phrase prêtée à Auguste : « J’ai trouvé une Rome de boue, je laisserai une Rome de marbre. »
Ainsi existe-t-il un style stalinien, un style mussolinien, faits de rigueur homogénéisatrice ; et si François Mitterrand a pu un jour regretter qu’il n’existât pas de « style Mitterrand » au fil de ses grands travaux, c’est sans doute qu’en démocratie ce n’est pas le chef de l’État qui impose unilatéralement et toujours son goût, mais des jurys qui choisissent des projets architecturaux dans des concours normalement anonymes.
C’est aussi cela que donne à voir l’extraordinaire inventivité et diversité architecturale contemporaine de la City londonienne, celle du pouvoir économique, issu du libre marché, l’intégration harmonieuse reflétant, en dépit de la concurrence et des surenchères, le travail de la main invisible !
Le centre-ville monumental
Le pouvoir ne va pas sans la reconnaissance qui lui confère sa légitimité. Le pouvoir s’exerce ainsi toujours avec un alibi : au nom de… par délégation : Nulla potestas nisi a Deo (nul pouvoir qui ne vienne de Dieu), Saint Paul, Épître aux Romains 13,1 ; Par le peuple, pour le peuple, Abraham Lincoln, Discours de Gettisburg. Seule la référence à une transcendance incontestable lui confère sa véritable vertu efficace de puissance. Nous l’avons dit, il s’ensuit que le principe du pouvoir tient du sacré ; il y a du religieux et du magico-religieux dans tout pouvoir, même laïc. Dès lors le spectacle que donne le pouvoir est d’une étrange nature puisqu’il doit en se représentant représenter son principe, qui par définition est irreprésentable.
Il faut alors répondre à un défi architectural et urbanistique : comment représenter matériellement la transcendance de son principe et alibi ? Par une architecture qui fait signe vers un au-delà insaisissable : l’architecture monumentale au double sens du terme.
En premier lieu, le monument nous place dans un état d’esprit (latin mente) tel que nous nous souvenons (latin monere, faire souvenir, faire songer), le monument est comme une admonestation de pierre, un memento, et c’est d’ailleurs en cela que le monument aux morts est peut-être la vérité du monument, comme mémoire des grands absents dont le sacrifice nous endette. On comprend que la verticalité des cathédrales ait ainsi pu confondre l’élan authentiquement religieux vers Dieu et l’affirmation d’un pouvoir communal médiéval jouant de l’ambiguïté.
En second lieu le monumental renvoie au démesurément grand, à l’inimaginable, au grandiose, bref à ce qui met à mal notre finitude, notre petite mesure humaine, trop humaine, par le sentiment d’être débordé, voire écrasé. Le pouvoir aime ainsi à se représenter dans le sublime. Il faut en effet se souvenir avec Kant (Critique de la faculté de juger, analytique du sublime) que l’expérience du sublime se distingue du sentiment de la beauté. Ce dernier est inséparable de l’intuition d’une harmonie, d’une connivence secrète entre les belles proportions d’une réalité sensible – phénomène naturel ou œuvre d’art – et nos facultés ; le sublime comporte à l’inverse un moment de déplaisir par le sentiment d’être écrasé, dépassé. Le sublime fait donc signe par la démesure, tel un index, vers un au-delà du sensible. Et c’est pourquoi le pouvoir n’est tel que de pouvoir exiger de chacun le dépassement de soi, de son individualité finie, ce que lui-même donne à voir dans le grandiose de ses constructions qui doivent alors conjuguer la tension paradoxale de l’énormité monumentale et de la maîtrise. Esthétiquement, il y faut du génie, sauf à tomber, comme le plus souvent, dans la lourdeur des pompes académiques.
Les régimes passent, mais le pouvoir demeure dans et par ses demeures monumentales, comme si les acteurs ne faisaient que passer sur la grande et immuable scène du spectacle du pouvoir. La République, s’est ainsi installée dans les ors des palais aristocratiques et le néo-classicisme des temples gréco-romains, dont l’architecture est également reprise par le jeune État américain et tant d’autres. Les bolcheviks en ont fait de même avec le Kremlin.
A lire aussi : New York, la ville-monde
Les caméras de surveillance, nos derniers monuments ?
Qu’en est-il aujourd’hui où l’on assiste à une double crise, dit-on, et de la ville et du pouvoir, du moins dans la forme des représentations traditionnelles ?
Pour reprendre le titre d’un recueil du poète belge Émile Verhaeren, les villes sont devenues tentaculaires. Les banlieues commerciales ou pavillonnaires s’étirent à n’en plus finir dans de vastes zones qui ne sont plus classiquement urbaines sans être encore vraiment rurales. Les centres commerciaux attirent plus que les centres-villes dépourvus de leur vraie centralité, celle qui rassemble dans une reconnaissance de sens et de valeur partagés. Les monuments patrimoniaux valent surtout encore pour les regards exotiques des touristes, et certains centres-villes pour une élite socio-économique sans autre légitimité que son pouvoir d’achat.
Parallèlement, le pouvoir est, dans tous les sens du terme, décentralisé ; il prend en grande partie la forme d’un réseau. Pour le meilleur, celui des institutions démocratiques et de leurs services publics, pour le pire, celui des normes comportementales (qui n’ont plus rien à voir avec l’ancienne urbanité !), et enfin celui des caméras de surveillance, témoins d’une réalité urbaine conflictuelle et d’un regard anonyme, sans sujet ; elles sont nos derniers monuments.