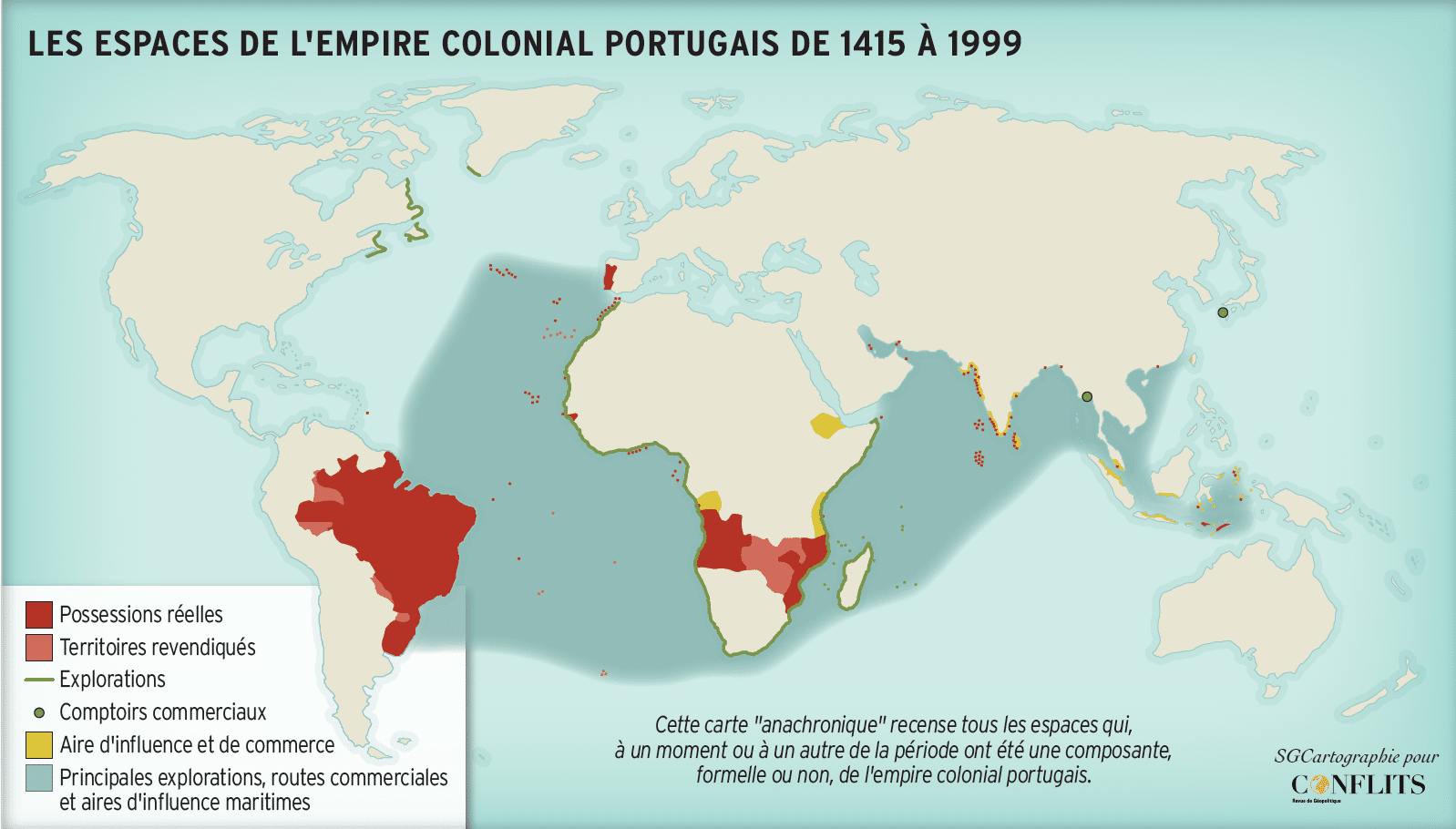20 ans après le début du XXIe siècle, où en est le monde ? Conflits vous propose une série de Noël pour faire un bilan des 20 dernières années écoulées. Entretien avec Nicolas Klein sur les évolutions de l’Espagne.
Après s’être débarrassée des séparatistes de l’ETA, l’Espagne se confronte dans la foulée au mouvement indépendantiste catalan. Pourquoi la nation espagnole, qui a une telle longévité historique et une telle consistance nationale, donne-t-elle l’impression de ne pas avoir de terreau commun suffisant pour maintenir son unité ?
Les causes de ce phénomène sont multiples et parfois très anciennes. Si je devais résumer, je dirais que le problème a véritablement débuté durant l’Ancien Régime, car l’union entre Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, qui permet de réunir les royaumes ibériques au tournant des années 1470-1480, n’est que personnelle. Les Couronnes qui composent l’Espagne conservent des particularités monétaires, économiques, légales, culturelles, etc., seuls les souverains et la religion servant de liant à l’ensemble.
Les Habsbourgs ne remettent pas en cause cette politique, exception faite du comte-duc d’Olivares, favori de Philippe iv (1621-1665). Le ministre s’essaye en effet à une « Union des Armes » (Unión de Armas) censée répartir le poids financier et démographique des guerres menées par la Monarchie hispanique entre les territoires qui composent l’Espagne. Jusqu’alors, seule la Couronne de Castille assume ce coût. Mais l’initiative d’Olivares se solde par un échec cuisant et de graves troubles dans le pays.
Ce n’est qu’avec l’arrivée des Bourbons sur le trône, en 1700, et plus encore après la Guerre de Succession d’Espagne qu’un certain centralisme est mis en œuvre outre-Pyrénées. Pourtant, ledit centralisme est très relatif : il ne s’applique que marginalement aux provinces basques, par exemple, car elles ont majoritairement soutenu la nouvelle dynastie durant le conflit qui s’achève en 1714. Par ailleurs, la France d’Ancien Régime est elle aussi une constellation de provinces aux habitudes, aux lois, aux parlers, etc. divers et la situation antérieure à la Révolution française n’a donc rien d’immuable. Notons aussi que ce centralisme dépeint sous le pire jour par les séparatistes catalans ou basques leur a beaucoup profité sur le plan économique…
À mon sens, c’est au xixe siècle que se joue véritablement l’évolution de l’Espagne. En effet, à une époque où les nationalismes commencent à fleurir en Europe et où les conséquences de 1789 sont véritablement perceptibles, Madrid a beaucoup d’idées pour « faire nation »… mais des moyens humains, matériels et financiers limités. L’Espagne est sortie exsangue de l’occupation napoléonienne, a été marginalisée par les nations victorieuses du Premier Empire et a du mal à concrétiser une réalité nationale préexistante. Prenons un exemple concret : en 1857, le ministre Claudio Moyano fait passer une loi rendant, entre autres choses, l’instruction obligatoire et gratuite de 6 à 9 ans. Ce texte a une longévité considérable, puisqu’il n’est remplacé par la Loi générale d’Éducation… qu’en 1970 ! Et nous parlons d’une législation imaginée un quart de siècle avant les célèbres lois Ferry en France.
Pourtant, faute de moyens, la loi Moyano est très inégalement appliquée, dépend des finances de chaque commune et fonctionne souvent grâce à l’initiative privée. Or, on sait à quel point l’instruction est fondamentale dans les processus d’unification et de « nationalisation » au cours de ce siècle.
De façon générale, les « nationalismes périphériques » (principalement en Catalogne et au Pays basque) qui naissent à la fin du xixe siècle cherchent à occuper une place que l’État central a justement du mal à occuper. Il y aurait beaucoup à dire sur le caractère profondément suprémaciste de ces nationalismes chez nombre de leurs représentants (Enric Prat de la Riba, Bartolomé Robert, Valentín Almirall, Sabino Arana, etc.). Ce n’est cependant pas le lieu pour développer cette idée – même si la pensée de ces « pères fondateurs » est bien au cœur des séparatismes actuels.
Quoi qu’il en soit, en dépit de la très rapide synthèse que je viens de brosser, il existe bel et bien une nation espagnole et un sentiment national outre-Pyrénées. C’est aussi le cas dans les communautés autonomes les plus travaillées par le sécessionnisme à l’heure actuelle. Les manifestations « unionistes » des 8 et 29 octobre 2017 à Barcelone, par exemple, l’ont amplement démontré.
À lire également
Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité
L’Espagne ne s’est jamais réconciliée avec son passé. Les plaies identitaires et culturelles du XXe siècle suppurent encore dans la vie politique dans la mesure où l’histoire nationale paraît en grande partie ignorée et généralement méprisée par la population espagnole. La politique mémorielle de Madrid développée par les gouvernements successifs de ces dernières décennies explique-t-elle la crise de cohésion qui traverse l’Espagne ?
La Loi de Mémoire historique de 2007 et la Loi de Mémoire démocratique présentée en 2020 répondent à des interrogations légitimes d’une partie de la population espagnole, notamment au sein des jeunes générations. Il existe en effet d’importants secteurs de la société qui estiment que toute la lumière doit être faite sur un certain nombre d’événements survenus durant la guerre civile (1936-1939) et la dictature franquiste (1939-1975), voire durant la transition démocratique (1975-1982).
Ces deux textes présentent en revanche d’importants inconvénients, que ce soit per se ou en raison du climat politique outre-Pyrénées. En premier lieu, si mémoire historique il y a, elle doit prendre en compte les crimes des deux camps durant le conflit civil et pointer toutes les responsabilités dans la marche vers la guerre au cours de la Seconde République (1931-1939). Mais la gauche espagnole ne le souhaite évidemment pas, car cela reviendrait à montrer que la faute revient aussi à des formations comme le Parti socialiste ouvrier espagnol ou le Parti communiste. Ces derniers s’affichent pourtant comme de « blanches colombes » victimes de l’histoire et du fascisme.
Y a-t-il eu un coup d’État (qui a failli) et une volonté délibérée de la part des nationalistes d’abolir le régime en vigueur en 1936 ? C’est exact. Ces mêmes nationalistes ont-ils perpétré des atrocités durant la guerre civile et après ? Ce n’est pas moi qui le nierai. Pourtant, comment expliquer qu’une partie non négligeable de la population espagnole, au-delà des élites économiques et politiques, ait soutenu lesdits nationalistes ? La dégradation de la situation politique, institutionnelle et sociale à partir de 1931 est patente. Or, elle est aussi le fait de formations de gauche qui n’ont jamais hésité à recourir à la violence et à tordre le cou à l’État de droit quand elles en avaient besoin.
Quant aux massacres commis à partir de 1936, il y en a eu des deux côtés. Les « républicains » autoproclamés se sont eux aussi acharnés sans raison sur la population civile (pensons au bombardement de Cabra en novembre 1938) ou des personnes qui, objectivement, ne représentaient pas de danger réel dans le cadre des hostilités (je citerai les tristement célèbres massacres de Paracuellos, qui se sont déroulés entre novembre et décembre 1936).
Du point de vue de la démocratie actuelle, rien de tout cela n’est défendable – ni le franquisme, ni les exactions « républicaines ». Mais la gauche espagnole ne veut rien entendre. Elle n’a de cesse que d’instrumentaliser l’idée de mémoire historique pour faire subrepticement comprendre que seuls les partis qui la composent sont légitimes à gouverner et que tous ceux qui s’opposent à elles ne sont, au fond, que des reformulations vaguement maquillées du franquisme.
L’autre grand problème posé par la « mémoire historique » telle qu’elle est défendue outre-Pyrénées est qu’elle sert les intérêts des séparatismes. Elle leur permet en effet d’asséner des coups de boutoir continus aux institutions issues de la Constitution de 1978 avec un seul et unique but : obtenir gain de cause en matière de sécession. Socialistes et gauche « radicale » sont leurs complices assumés dans cette entreprise, tout comme dans la manœuvre de « blanchiment historique » des séparatistes basques et catalans. Pourtant, ceux-ci ont généralement lâché la Seconde République en rase campagne durant la guerre civile (pacte de Santoña, août 1937). Ils se sont également servis d’elle pour mieux la trahir et se débarrasser physiquement de ses défenseurs (songeons aux terribles journées du printemps et de l’été 1937 en Catalogne). Et ne parlons même pas des apports financiers décisifs de la bourgeoisie catalane aux franquistes… ni même des très nettes sympathies de l’ERC ou de la Ligue régionaliste (principales formations nationalistes catalanes de l’époque) pour l’Italie fasciste, voire l’Allemagne nazie.
De manière générale, il existe en Espagne un net déficit de « fierté nationale » lié en partie à une vision déformée du passé – au-delà même du siècle écoulé. On observe néanmoins des changements (encore timides) dans le domaine depuis une quinzaine d’années.
Les dix dernières années ont été symboliquement marquées par l’avènement de Philippe VI après l’abdication de Juan Carlos en 2014. Y a-t-il eu une rupture dans l’exercice du pouvoir et dans la manière de concevoir leur rôle de roi ?
À cette question, je répondrais à la fois « oui » et « non ». Philippe vi n’a pas bouleversé l’institution monarchique en elle-même et tente de poursuivre l’idéal (souvent non formulé comme tel) d’une « république couronnée » qui était celui de son père. Il continue d’apparaître comme un roi proche, accessible, qui utilise le faste de la Couronne uniquement lorsque c’est nécessaire.
En revanche, il a évidemment dû redresser la barre après les scandales financiers qui ont émaillé la fin du règne de Juan Carlos et ont terni l’image de la famille royale. Il a ainsi misé sur la transparence et la sobriété – ce qui, au vu des sondages depuis de nombreuses années, lui réussit plutôt bien. Philippe vi a conscience de l’existence d’un secteur républicain au sein de la société (secteur que les partisans d’un changement de régime estiment majoritaire, même si j’ai d’énormes doutes à ce sujet). Cette conviction guide aussi son comportement et ses choix.
Par ailleurs, il a pris des responsabilités historiques par son discours du 3 octobre 2017, deux jours après le référendum sécessionniste illégal en Catalogne, notamment en condamnant les actions des responsables politiques catalans. Je crois que l’on mesure encore mal aujourd’hui les répercussions de cette prise de position inédite, mais conforme aux attributions et devoirs que prévoit la Constitution concernant le roi – puisqu’il est aussi le garant de l’unité nationale.
Bien entendu, il est impossible de savoir comment Juan Carlos aurait réagi face à de tels événements, mais le « défi indépendantiste » a débuté en 2011-2012, à la fin de son règne. Or, le père de l’actuel monarque était dans une démarche plus conciliante à l’égard des autorités régionales catalanes. Avec du recul, beaucoup d’Espagnols ont reproché à Juan Carlos une célèbre déclaration qu’il a eue en 2003 lors d’une discussion avec le président du Parlement régional catalan de l’époque, Ernest Benach : « hablando se entiende la gente » (soit « c’est en parlant que les gens peuvent se comprendre »). Sa bienveillance démonstrative avec un dirigeant séparatiste comme Artur Mas (en tant que président régional catalan, c’est lui qui lance le processus séparatiste en 2012) a aussi été vivement critiquée. Philippevi ne semble pas suivre le même chemin et prend ses distances avec son père aussi dans le domaine.
À lire également
La guerre de Succession d’Espagne. Clément Oury
En quelques mots, comment résumer les relations de l’Espagne avec l’Amérique latine d’une part avec le monde hispanophone d’autre part depuis vingt ans ?
L’Espagne est très consciente du poids de la langue espagnole dans le monde (elle est, de fait, la deuxième langue en Occident, voire au monde, derrière l’anglais, aussi bien sur le plan démographique qu’économique, médiatique et culturelle). Depuis les années 1990, elle multiplie les initiatives pour se placer en tête d’un vaste mouvement de promotion de la langue de Cervantès. Elle est accompagnée en cela aussi bien par des institutions publiques (Maison de l’Amérique, Institut Cervantès, Académie royale, etc.) que par des acteurs privés (notamment des multinationales implantées en Amérique latine).
Outre-Atlantique, l’Espagne est très bien positionnée sur le plan des investissements dans bien des pays (Mexique, Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, etc.). Elle tente également de faire valoir son legs historique et culturel. Bien entendu, les courants tendant à remettre en cause l’œuvre passée de notre voisin pyrénéen en Amérique se font plus pressants ces dernières années. C’est probablement l’un des défis majeurs que devra relever Madrid dans cette partie du monde en ce début de siècle.
Il y a également la question des enclaves espagnoles au Maroc sur lesquelles Rabat exerce une pression constante, tandis que Madrid soutient officieusement les séparatistes du Sahara occidental. Comment l’Espagne se positionne vis-à-vis du Maroc ?
Le Maroc est, du point de vue espagnol, un partenaire ambigu. D’un côté, il est un récepteur privilégié des investissements et du commerce espagnols. Il constitue également un allié dans la lutte contre le terrorisme. Ajoutons que les liens personnels entre monarchie espagnole d’un côté et monarchie marocaine de l’autre ont permis de résoudre des crises bilatérales de diverses natures.
D’un autre côté, ces dernières années, Rabat joue un jeu trouble visant à faire pression sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, ainsi que sur les « places de souveraineté » que l’Espagne possède au large des côtes africaines. Les événements de mai 2021 à Ceuta ont démontré que les autorités marocaines entendaient utiliser la pression migratoire pour déstabiliser l’Espagne sur place. À terme, l’objectif est de pouvoir récupérer des territoires dont Rabat estime qu’ils lui reviennent de droit. L’asphyxie commerciale pratiquée par le Maroc sur ces fameuses enclaves fait partie d’une stratégie comparable.
De même, le pays maghrébin multiplie les partenariats stratégiques ces dernières années, notamment avec les États-Unis et Israël, pour se renforcer sur le plan militaire, tâcher de contrôler le détroit de Gibraltar et s’étendre dans les eaux territoriales espagnoles dans l’océan Atlantique. Outre l’existence de ces « confettis » à la souveraineté disputée, la présence de ressources clés au large des Canaries (notamment des terres rares) est un enjeu crucial dans les relations hispano-marocaines.
Du point de vue de la diplomatie française, on a l’impression que l’Espagne est quasiment invisible. Pourquoi n’existe-t-il pas de couple franco-espagnol alors même que les gouvernements de part et d’autre des Pyrénées sont souvent de la même couleur politique ?
L’adjectif « invisible » me semble très bien choisi. Le grand public ignore à peu près tout des réalités politiques, économiques, sociales, culturelles, etc. de l’Espagne, mais c’est malheureusement aussi le cas d’une partie des élites françaises.
Même en ne pensant qu’à nos intérêts bien compris, cette méconnaissance est très nocive pour nous, car elle nous pousse à sous-estimer (pour ne pas dire mépriser) tout ce qui vient de l’autre côté des Pyrénées. Et nous multiplions ainsi depuis quelques années les déconvenues commerciales et économiques. Si je m’en tiens au domaine des infrastructures et transports, en 2010, Paris a découvert avec stupéfaction que l’Espagne disposait d’excellentes entreprises dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire et qu’elle pouvait ainsi nous ravir le « contrat du siècle » en Arabie saoudite avec la ligne TGV La Mecque-Médine. Plus récemment, la firme espagnole CAF a racheté l’usine qu’Alstom possédait à Reichshoffen, en Alsace. Et je pourrais multiplier les exemples…
La diplomatie espagnole ne brille pas par son caractère entreprenant ou visionnaire et l’absence de « couple franco-espagnol » est donc partiellement explicable en prenant ce phénomène en compte. Néanmoins, le principal responsable dans l’affaire reste la France elle-même, ou tout du moins ses actuelles élites politiques. Il faut aussi blâmer les médias, qui ne s’intéressent à l’Espagne que de façon très sporadique (et rarement pour en dire du bien).
Après quelques tergiversations, François Mitterrand avait tenté un rapprochement avec Madrid, mais l’effort n’a pas été poursuivi ensuite. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron sont particulièrement peu intéressés par ce pays (et par le monde hispanophone en général). Ils lui ont d’ailleurs bien fait comprendre. Lorsque Mariano Rajoy arrive au pouvoir, en 2011, une occasion historique s’ouvre pour la France, car le président du gouvernement espagnol tente de rééquilibrer le jeu européen durant la crise économique en s’ouvrant à une alliance avec François Hollande. Mais ce dernier ne s’en préoccupe pas et privilégie le partenariat avec Berlin. Rajoy lui emboîte donc le pas.
Il est vrai que certains désaccords idéologiques ont pu jouer. Songeons par exemple à l’inimitié entre Jacques Chirac et José María Aznar, qui éclate au grand jour avec l’affaire de la guerre en Irak. Néanmoins, ces épisodes sont, depuis les années 1980, plutôt rares.
Je suis convaincu qu’au-delà du jeu diplomatique habituel, Madrid serait sincèrement demandeur d’une collaboration plus étroite avec Paris. L’inverse me semble bien moins vrai, même si Jean Castex a récemment affirmé le contraire lors d’une visite à Madrid…
À lire également
Les prix Princesse des Asturies, symbole d’une Espagne attractive