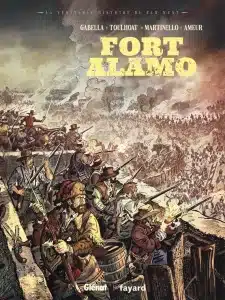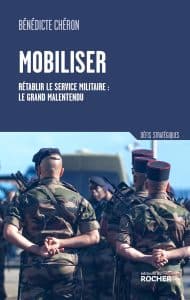Le plan de Donald Trump pour Gaza projette une recomposition du Proche-Orient. S’il ne satisfait personne dans sa totalité, il est encore la meilleure chance de succès pour la région.
Ce plan en 20 points de Donald Trump pourrait bien être la première feuille de route crédible depuis deux ans de guerre. Parce qu’il ne parle pas seulement de Gaza et d’Israël : il s’inscrit dans une dynamique régionale, dans le sillage des Accords d’Abraham. Autrement dit, un projet où la paix n’est plus une finalité politique, mais une condition préalable à l’intégration économique et aux alliances régionales.
À lire également : Le plan de paix pour Gaza. Texte complet
C’est quoi ce plan ?
La logique du plan repose sur une dynamique régionale. Il fixe un cadre impliquant directement la communauté internationale et les pays du Moyen-Orient, dans la continuité des Accords d’Abraham. L’objectif affiché : transformer Gaza en une zone stable et non menaçante, en plaçant la reconstruction et la gouvernance sous une tutelle internationale.
Cette approche rejoint l’analyse de Mohammed Baharoon, directeur du Dubai Public Policy Research Center (b’huth), qui identifie deux tendances : le « retour des empires » et l’émergence d’une « géopolitique quantique ».
D’un côté, les logiques impériales persistent : Turquie d’Erdogan revendiquant l’héritage ottoman, Russie annexant la Crimée, Israël consolidant le Golan et affichant une capacité de frappe régionale. Ces dynamiques identitaires et militaires nourrissent l’émergence d’acteurs contestataires non étatiques.
De l’autre, une nouvelle logique émerge : celle des réseaux économiques transcontinentaux. Les corridors, comme la Belt and Road Initiative ou l’IMEC redessinent les cartes d’influence. Les États du Golfe coopèrent à la fois avec Washington, Pékin, Moscou et New Delhi. La stabilité ne se pense plus en blocs idéologiques, mais en flux : commerce, énergie, infrastructures.
Le plan Trump s’inscrit dans ce basculement. Il n’est pas seulement un cessez-le-feu, mais un projet où l’économie et les alliances deviennent les leviers principaux. La stabilité de Gaza dépend moins d’un tête-à-tête israélo-palestinien que d’un enchevêtrement d’intérêts reliant Washington, les capitales arabes, l’Europe et même l’Asie. La reconstruction est pensée comme un chantier international, financé et supervisé par une coalition. La paix n’est plus une fin politique, mais une condition préalable au développement et à l’intégration régionale. Gaza devient un laboratoire de cette nouvelle gouvernance internationale.
Enfin, le texte établit un cadre sécuritaire, prioritaire pour Israël : démilitarisation de Gaza, force internationale de stabilisation et retrait progressif de Tsahal. Il esquisse ensuite une feuille de route politique vers un État palestinien, conditionnée à des réformes institutionnelles, à la sécurité et à la reconstruction.
L’avantage du flou
Paradoxalement, le plan gagne à rester vague. Moins il entre dans les détails, moins les parties peuvent bloquer chaque clause. Il trace une ligne directrice et donne un cadre, sans fournir d’excuses juridiques ou politiques pour refuser – sauf au Hamas.
En Israël, on parle d’un plan « en cash » : la libération des otages serait immédiate, sans condition sur le reste du processus. Le journaliste Nahum Barnea rappelle qu’après la guerre du Kippour, Israël refusait d’entrer dans les détails : Moshe Dayan voulait poursuivre la guerre, Golda Meir doutait de l’accord, mais Henry Kissinger l’imposa. Résultat : la paix avec l’Égypte. Est-ce que le plan en 20 points de Trump pourrait jouer un rôle similaire ?
Refermer le goulot des extrémismes
Le plan Trump en 20 points présente un avantage majeur : il referme le goulot des extrémistes et remet sur la table le droit des Palestiniens à l’autodétermination et le droit d’Israël à vivre en sécurité. Le monde arabe et musulman dit non au Hamas, mais Donald Trump dit non également aux fantasmes de l’extrême droite israélienne vivant dans l’illusion d’un grand Israël. Washington a déjà prévenu : les États-Unis ne laisseront pas Israël annexer la Cisjordanie ni Gaza, fermant ainsi la porte aux illusions de la droite messianique, tout en tenant compte des lignes rouges israéliennes.
Côté arabe, plusieurs capitales, dont Riyad et Abou Dhabi, insistent publiquement sur l’inclusion – même symbolique – de l’Autorité palestinienne. Mais même elles savent que les conditions ne sont pas réunies et que donner les clés à Mahmoud Abbas, c’est risquer de les remettre au Hamas. Pourtant, Abbas accepte le plan. Il faut bien commencer quelque part, au grand dam des militants pro-palestiniens en Occident, qui dénoncent un « génocide » depuis le 8 octobre, mais critiquent aussi l’initiative.
On revient donc aux fondamentaux : un État juif et un État palestinien, sous conditions et sous tutelle, mais l’idée est relancée.

Donald Trump aux côtés de Benyamin Netanyahu, lors de la conférence de presse commune lors de laquelle le président a présenté son plan de paix pour Gaza. 29 septembre 2025, Washington.
À lire également : Hamas : l’intégralité de sa réponse au plan de Donald Trump
Un plan unilatéral ?
En Israël, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich dénoncent déjà ce plan comme une capitulation et un retour au 6 octobre – autrement dit, l’illusion qu’Israël n’a rien appris et cherche à apaiser ses ennemis. Dans l’ensemble, l’opposition israélienne a critiqué les excuses faites par Netanyahou au Qatar, mais soutient le plan, comme une large majorité de la population, à gauche comme à droite.
À Gaza, des voix se sont fait entendre pour dire qu’il fallait accepter le plan et mettre fin à la guerre. Impossible de mesurer le degré réel de soutien, mais, étant donné l’état du territoire, l’aspiration à un cessez-le-feu paraît évidente.
En revanche, une partie de la gauche pro-palestinienne dénonce un plan « sioniste » visant à écraser la « résistance ». Si l’on parle du Hamas, alors oui, c’est bien l’objectif. Mais refuser une initiative qui met fin à la guerre revient à privilégier la défaite israélienne plutôt que le bien-être des Palestiniens.
La rue arabe, elle, parle de capitulation : l’Autorité palestinienne n’obtient qu’un rôle marginal et Gaza serait placée sous une tutelle internationale, incarnée par Tony Blair. Ironie de l’histoire, mais explication logique. Les dirigeants arabes, eux, se souviennent du prix payé par leurs pays : la guerre civile libanaise déclenchée par l’OLP en 1975 ou « Septembre noir » en Jordanie en 1970. Dans les deux cas, l’implantation de forces palestiniennes armées avait créé un État dans l’État, provoquant chaos et affrontements. L’histoire régionale impose donc cette solution imparfaite : avancer malgré tout.
Et le Hamas dans tout ça ? Un « Oui, mais »
Le Hamas a annoncé accepter certaines parties du plan. Il se dit prêt à libérer tous les otages – vivants et morts – selon la formule d’échange prévue, et à transférer l’administration de Gaza à un organe de technocrates, validé par un consensus palestinien et soutenu par les pays arabes et islamiques. Mais le désarmement, exigence clé d’Israël, n’est pas mentionné. Bref : le Hamas répond « oui, mais ».
Cette réponse a déclenché une mécanique trumpienne : annoncer un résultat avant qu’il ne soit acté, pour forcer l’alignement. Trump a aussitôt affirmé que « le Hamas est prêt pour une paix durable » et appelé Israël à cesser ses offensives. Netanyahou a alors annoncé la « phase 1 » : fin des attaques offensives, passage à une posture défensive et gel de l’opération visant Gaza City, afin de préparer la libération des otages. Autrement dit, Israël remet désormaÒis le choix dans les mains du Hamas.
Même si l’implémentation pourrait prendre plus que les 72 heures annoncées et que des zones d’ombre subsistent (désarmement, gouvernance internationale, conditions des négociations), ces annonces marquent peut-être le début de la fin de la guerre. Car, même affaibli, le Hamas reste maître du jeu : il détient les otages, l’alpha et l’oméga du conflit pour Israël.
En parallèle, le Qatar, rejoint par la Turquie et l’Égypte, semblent prête à tourner la page de la guerre (et du Hamas), accentuant la pression sur le Hamas. Mais certaines clauses reviennent à une quasi-reddition : exclusion de la reconstruction et de la gouvernance, destruction des tunnels et dépôts, désarmement complet. Or, perdre ses armes, c’est perdre son monopole coercitif et donc sa légitimité comme « défenseur du peuple palestinien ». L’image de « résistance », relayée en Occident ces deux dernières années, s’effriterait au profit d’acteurs institutionnels : une Autorité palestinienne réformée, des forces internationales, et des pays arabes. La difficulté sera de gérer le vide de pouvoir et le démantèlement des réseaux sans recréer un nouveau foyer de radicalisation. Un pari risqué, mais nécessaire pour stabiliser Gaza.
Conclusion
Deux ans après le 7 octobre, alors que 48 otages – dont une vingtaine encore en vie – restent aux mains du Hamas, que Gaza est détruite, que les rapports de force régionaux ont basculé, et que Trump promet à Netanyahou d’achever la destruction du Hamas en cas de refus, ce « oui, mais » n’est qu’un moyen de gagner du temps. Le Hamas ne pourra pas se réfugier éternellement dans des négociations stériles : ce blocage ramènerait tout le monde au point de départ, avec une différence majeure – la perte probable de ses relais régionaux, et peut-être même occidentaux.
Netanyahou, lui, avance « by the book ». La réaction du Hamas déterminera si ce plan ouvre une nouvelle ère ou referme une parenthèse diplomatique. Car dans ce dossier, l’inverse de la guerre n’est pas encore la paix : c’est une accalmie fragile, un espace d’expérimentation où les acteurs jouent aux équilibristes pour éviter que tout ne recommence demain.
À lire également : Guerre au Proche-Orient : un point de vue américain