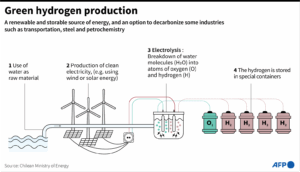Les rapports du Groupe international d’étude du climat de l’ONU (GIEC), fondé dans les années 1980, se succèdent et prévoient les uns après les autres un réchauffement de la planète compris entre 2 et 6 °C au xxie siècle, selon les scénarii envisagés. Les effets du changement climatique se feraient déjà ressentir sous la forme de montée des eaux et de phénomènes naturels extrêmes comme les tempêtes, les inondations, les coups de froid, les canicules, etc.
La question est de savoir quels liens existent entre l’utilisation des énergies (production, transport, consommation) et les risques écologiques qui pèsent de plus en plus sur les sociétés humaines, comme les marqueurs d’une « nouvelle modernité » (Ulrich Beck). En un mot le réchauffement est-il principalement provoqué par l’activité humaine ou a-t-il d’autres causes comme l’activité solaire ?
La prise de conscience assez brutale de ces risques, au tournant des années 1970, mène à la formulation de la notion de développement durable dans les années 1980, qui prétend réconcilier les logiques économique, sociale et environnementale en vertu de la solidarité entre les générations (1987). La transition énergétique occupe évidemment une place essentielle dans ce nouveau paradigme.
Une perception toujours plus aiguë du risque environnemental
L’homme est perçu comme agent créateur de risque depuis la Révolution industrielle du xixe siècle, lorsque se produisent les premières catastrophes technologiques et industrielles, par exemple les coups de grisou dans les mines de charbon comme à Courrières dans le nord de la France en 1906 (plus d’un millier de morts). Avant cela, on invoquait la fatalité, désormais on cherche à prévenir les risques et à s’assurer contre eux (sociétés de secours mutuel).
Les années 1960-1970 sont une période charnière dans la prise de conscience d’une montée des risques. Beaucoup n’ont rien à voir avec l’énergie : utilisation des pesticides dans l’agriculture (Rachel Carson, The Silent Spring, 1962), déforestation ; d’autres lui sont liés – pollution de l’air (smog), des eaux, des mers et océans (marées noires, scandale de Minamata au Japon), phénomène des pluies acides (en particulier dans la région des Grands Lacs américains), incidents nucléaires (Three Miles Island, 1979). Le risque devient « global » selon le sociologue allemand Ulrich Beck : il s’agit d’un processus qui affecte les équilibres d’ensemble de la reproduction de la Planète et de la biosphère. Pour lui, il constitue une menace majeure qu’il compare à un « volcan de notre civilisation » (La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, 2001).
Les énergies fossiles sur le banc des accusés
Le problème soulevé est celui des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment du dioxyde de carbone (CO2) dont les rejets sont dus pour une grande part aux industries et en particulier au secteur de l’énergie, du fait de l’utilisation des combustibles fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel (à un moindre degré). La concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère aurait ainsi augmenté d’un tiers depuis les débuts de la Révolution industrielle, processus qui s’accélère depuis le milieu des années 1970 d’après le GIEC. La combustion de l’énergie fossile serait ainsi la première activité humaine responsable de l’émission de gaz à effet de serre. Les transports en particulier sont responsables d’environ 30 % de ces émissions mondiales quand on se remémore que plus de 1 milliard de véhicules circulent dans le monde, soit dix fois plus que dans les années 1950. Ces gaz à effet de serre sont rendus responsables de la hausse des températures, les changements de l’activité solaire étant considérés comme secondaires par le GIEC.
Si on se limite à l’étude des conséquences possibles du changement climatique mondial, on note que, selon le GIEC, le relèvement du niveau des mers sera en moyenne de 18 à 60 centimètres (certains auteurs avancent même 1 mètre avant la fin du siècle) touchant les régions côtières et deltaïques (Gange, Mékong, Godavari, Fleuve Bleu…), certains États insulaires (Tuvalu, Maldives, Marshall), certains pays en grande partie (Égypte, Bangladesh, Pays-Bas). Le manque d’eau potable devrait s’aggraver dans des zones déjà soumises au stress hydrique. Désertification, faim, malnutrition, maladies virales sont autant de dommages collatéraux à attendre. Les guerres même pourraient être de plus en plus liées à l’environnement : certains spécialistes à l’ONU avancent que le conflit au Darfour serait en grande partie causé par les migrations d’éleveurs nomades du Nord-Darfour menacé de désertification vers les terroirs plus fertiles du Sud occupés par des tribus arabes sédentaires. Il existerait d’ores et déjà 26 millions de réfugiés climatiques selon le rapport Stern (2007). 3 000 habitants de Tuvalu dans le Pacifique Sud ont déjà migré vers la Nouvelle-Zélande – même si la montée des eaux dans cet archipel a été remise en cause par un article dans la revue Nature Communications en février 2018.
C’est au lieu même de l’activité que les dommages sont les plus fréquents : stockage de produits polluants (charbon, pétrole brut ou raffiné), rejet de déchets (terrils des charbonnages, eaux salines et chaudes rejetées par les centrales). Mais les eaux de surface circulant, la pollution peut s’étendre considérablement, jusqu’à des centaines ou milliers de kilomètres.
À lire aussi : La géographie de l’énergie est celle de la puissance. Éditorial du hors-série n°9
Le transport des énergies est aussi en cause, avec des phénomènes comme les marées noires qui se multiplient depuis les années 1970 et choquent les consciences : des accidents très spectaculaires, avec des côtes souillées durant de nombreux mois, des milliers d’oiseaux marins mazoutés, la surmortalité des poissons et crustacés, les déchets toxiques sur les plages… On connaît la longue liste des catastrophes Torrey Canyon en 1967 (120 000 tonnes de brut), Amoco Cadiz en 1978 (230 000 tonnes de brut au large de la Bretagne), Exxon Valdez en 1989 (40 000 tonnes de brut), guerre du Golfe en 1991 (800 000 tonnes) et plus récemment Erika et Prestige, Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique (la pire marée noire de l’histoire). Pourtant, les marées noires ne représentent que 2 à 6 % des pollutions maritimes par le pétrole, selon les années et en fonction des estimations. L’essentiel provient des déballastages, du nettoyage des cuves des cargos, des résidus de filtration des fuels lourds.
D’autres nuisances liées aux énergies complètent ce tableau : coups de grisou (méthane) et maladies comme la silicose, liés au charbon, déforestation liée à l’utilisation du bois de chauffage, affaissements de terrains liés à l’exploitation du charbon et aux mines souterraines (par exemple, dans le bassin de Liège, des enfoncements de terrains compris entre 10 et 15 m, ce qui provoque des inondations), occupation de l’espace au détriment d’autres activités : cultures industrielles contre cultures vivrières (biocarburants).
Le risque nucléaire
Sans même évoquer ici le risque de prolifération nucléaire militaire, des dizaines d’incidents dans des centrales électronucléaires civiles ont eu lieu à partir des années 1950-1960. Un des plus célèbres est celui de Three Miles Island en 1979 en Pennsylvanie, dont une fuite dans un réacteur a fait craindre le pire et a conduit à évacuer quelque 200 000 habitants des environs. Il est vrai que le nucléaire est le secteur où les risques sont les plus élevés et où les accidents ont les plus fortes répercussions : à Tchernobyl en 1986, 4 000 morts selon les sources officielles soviétiques, 30 000 à 60 000 selon une étude britannique, plus de 90 000 selon Greenpeace.
Une mobilisation internationale croissante
Les mouvements écologistes, associatifs et politiques, naissent en particulier du combat contre le nucléaire, avec la création de Greenpeace en 1971. La mobilisation contre le développement du nucléaire civil est contemporaine de l’installation des centrales de première génération. En France, les premiers grands rassemblements ont lieu en 1971 à Fessenheim dans le Haut-Rhin et à Bugey dans l’Ain. En Allemagne ou au Japon sont organisées des actions ponctuelles dans le cadre des « initiatives de citoyens », Bürgerinitativen en Allemagne ou « Mouvement Habitant » au Japon. En Allemagne, plusieurs mouvements de contestation mutent en partis régionaux : par exemple, le Parti de protection de l’environnement de Basse-Saxe. Le Landtag de Brême est le premier à ouvrir ses portes aux Verts en 1979. Cette même année, différentes tendances écologiques s’entendent pour présenter une liste commune aux élections européennes. Cette entente débouche en 1980 sur la création du parti national allemand Die Grünen.
Les premières théories de la décroissance fleurissent au début des années 1970. Le rapport Meadows (1972), commandé par le Club de Rome, vient donner un retentissement mondial à ces thèses. Des experts du MIT dirigés par Dennis Meadows travaillent sur ordinateur à partir de l’analyse de cinq variables (la population, l’alimentation, la technologie, les ressources naturelles, l’environnement) et établissent des projections de l’évolution de la planète jusqu’en 2100, sous la forme de graphiques. Publié sous le titre de The Limits of Growth, le rapport final fait couler beaucoup d’encre : pour la première fois apparaît l’idée que les ressources terrestres sont limitées et qu’elles peuvent en s’épuisant stopper net le développement. C’est le cas du pétrole, dont le rapport annonce des pénuries grandissantes jusqu’à l’épuisement complet en 2000 – ce qui ne s’est pas vérifié. Le rapport met ainsi en avant la menace d’effondrement irrémédiable de la croissance au tournant du nouveau siècle, réactivant les théories malthusiennes : l’accroissement des populations et des productions mondiales doit être stoppé.
Est ainsi posée la question d’une « croissance zéro » pour le Nord industriel afin, d’une part, de compenser les écarts de plus en plus grands entre États développés et États en développement et, d’autre part, de stopper les déprédations et gaspillages. Dans ce sillage émergent les paradigmes de l’« écodéveloppement » puis du « développement durable ».
Stockholm, 1972 : un tournant historique
La première conférence internationale sur l’environnement, qui se tient à Stockholm en Suède, pose un diagnostic inquiétant dans la continuité du rapport Meadows. Elle est dans les esprits depuis la proposition initiale faite par la Suède en 1968, mais le rapport du Club de Rome accélère le mouvement. Sous l’égide de l’ONU, elle réunit la plupart des États du monde, à l’exception de l’URSS et des démocraties populaires d’Europe de l’Est. Cette conférence marque la naissance du concept d’« écodéveloppement », dans le sens de développement plus écologique.
Alors sont prises les premières grandes décisions de protection de l’environnement à l’échelle internationale. Un Programme des Nations unies sur l’environnement (PNUE) est adopté dans la foulée. Gagnés par l’« esprit de Stockholm », un grand nombre de pays industriels se dotent de ministères et secrétariats d’État à l’environnement (110 pays au total au début des années 1980) et votent des dizaines de grandes lois sur l’environnement. Ainsi, les travaux et discussions de Stockholm témoignent-ils d’un nouveau souci de protection de la planète et d’utilisation plus parcimonieuse des ressources.
En 1979 se tient ainsi la première conférence internationale onusienne sur le réchauffement climatique et ses conséquences puis, en 1980, est créé le Programme climatologique mondial, en 1988 est fondé le Groupe d’experts internationaux sur l’évolution du climat (GIEC). Néanmoins, des divergences d’intérêts existent dès le départ : les représentants des pays du Nord et ceux du Sud ont envisagé la réunion dans des perspectives différentes : le Nord insiste sur les risques environnementaux globaux et sur le partage de la responsabilité à leur égard ; le Sud refuse de faire passer son développement économique après la protection de la planète et accuse le Nord de colonialisme écologique.
Vers le développement durable ?
Au sein des grandes organisations intergouvernementales apparaît dans les années 1990 le concept de développement durable (sustainable development) pour incarner un nouveau projet politique alliant le développement économique, la justice sociale et la protection de l’environnement. Ce concept est utilisé pour la première fois dans un séminaire organisé en 1979 par les Nations unies sur les questions écologiques. Le rapport Brundtland, paru sous le titre Our Common Future (1987), le théorise. Il s’agit d’un rapport commandé par l’ONU à la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED), créée en 1983. La commission interroge de nombreux savants et experts, politiques, citoyens issus de la société civile et en tire un panorama général des rapports entre développement et environnement sur la planète. Le développement durable y est défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». C’est-à-dire leur léguer une planète à la fois saine, sûre et productive. Il met en avant les idées de limitation des besoins et de la consommation d’un côté, celles de solidarité intergénérationnelle de l’autre, et alerte en particulier sur l’urgence d’une transition écologique.
Le Sommet de Rio en 1992 popularise le thème. Il s’agit du premier « Sommet de la Terre » réunissant 172 chefs d’État et de gouvernement, plus d’un millier d’associations et ONG, des dizaines de milliers de participants. Il voit la signature d’une convention-cadre sur le changement climatique qui ouvre la voie au Protocole de Kyoto. L’« Agenda 21 » précise, pour le siècle à venir, les responsabilités dévolues à chacun des acteurs de la société civile, à toutes les échelles, et prétend constituer une stratégie globale pour le développement durable. Le développement durable connaît à sa suite une vogue exceptionnelle dans le grand public et d’une certaine manière tout devient « durable », avec des interprétations assez variées en fonction des secteurs d’activité. Les gouvernements s’emparent progressivement du thème, par-delà les clivages politiques, appliquant la formule « Think Global, Act Local », que l’on doit au microbiologiste René Dubos, un des auteurs du rapport de la conférence de Stockholm de 1972, qui doit guider l’action en faveur du développement durable, dessinant un projet global de société dans laquelle les acteurs se mobilisent à toutes les échelles : mondiale, nationale, régionale, locale. Les entreprises suivent le mouvement, développant un capitalisme vert.
Les grands-messes environnementales se suivent et se ressemblent : elles rabâchent les mêmes thèmes, mais sans se concrétiser suffisamment : Sommet Planète Terre + 5 (après Rio) à New York, deuxième Sommet sur la Terre des Nations unies à Johannesburg en 2002, avant le Sommet Rio + 20 prévu en 2012… À Johannesburg, la célèbre formule de Jacques Chirac « la maison brûle et pendant ce temps nous regardons ailleurs » est un constat fait trente ans plus tôt à Stockholm, démontrant l’inefficacité au moins relative des actions entreprises jusque-là. Le sommet s’achève sur l’adoption d’un plan d’action en 153 articles couvrant tous les aspects du développement durable, de la lutte contre la pauvreté à la préservation des ressources naturelles en passant par la réduction des pollutions par dioxyde de carbone. Toutefois, ce plan déçoit, car ses dispositions restent floues, il ne comporte aucun engagement chiffré ni daté. L’idée d’une Autorité mondiale de l’environnement est soulevée, mais sans débouché concret. Jacques Chirac restera connu pour sa taxe sur les billets d’avion, décidée en duo avec le président brésilien Lula, qui n’est cependant appliquée que par une poignée de pays.
La transition écologique et énergétique en souffrance…
De multiples protocoles d’accord internationaux ont été signés depuis les années 1980, parmi lesquels le protocole sur la protection de la couche d’ozone à Montréal en 1987, le protocole de Kyoto sur la limitation des gaz à effet de serre (GES) en 1997, le protocole sur la biodiversité à Carthagène (Colombie) en 1999 et l’accord de Paris dessinant l’après-Kyoto en 2015.
Dans la lignée de ces accords internationaux, une nouvelle législation environnementale s’écrit progressivement à l’échelle des États, promouvant à la fois limitations et incitations. La plus grande diversité règne en la matière et les objectifs fixés par la diplomatie internationale peinent à être atteints.
À lire aussi : Électrification : Haïti à l’heure des grandes manœuvres
Différents outils sont mis au service des politiques publiques.
Les quotas et interdictions, qui s’attaquent aux aspects les plus visibles des dégradations environnementales : pesticides, produits dangereux, pollution de l’eau et de l’air. Ainsi, les Clean Air Acts votés tous les cinq ans aux États-Unis, pionniers en la matière, depuis les années 1960.
Les taxes vertes ou écotaxes dont le but est de faire peser le coût des pollutions non plus sur la collectivité, mais sur les agents pollueurs. En la matière, il y a aussi des échecs patents, comme la taxe carbone en France, par exemple, finalement abandonnée face à la fronde des « bonnets rouges » : elle a coûté environ 1 milliard d’euros à l’État.
Les marchés des droits à polluer, institués par le Clean Air Act américain de 1991 ou une législation européenne de 2005.
L’encouragement aux démarches volontaires de qualité, comme les labels, ou au recours à la certification par des agences indépendantes (normes ISO).
Les politiques sectorielles : politique industrielle et énergétique (subventions publiques aux énergies renouvelables), politique des transports (promotion des transports en commun et du ferroutage), aménagement du territoire (entretien paysager des espaces ruraux et agricoles).
Au début du xxie siècle, la population mondiale devient à majorité urbaine et le taux de croissance des villes, en particulier des grandes métropoles, s’accélère. Le nouveau paradigme est celui de la ville écologique et durable, dont témoigne la Charte d’Aalborg des villes européennes en 1994, la première en la matière. Les projets urbanistiques futuristes se multiplient au tournant du siècle, associant hautes technologies informatiques et énergies vertes, à l’exemple de Masdar City dans les Émirats arabes unis : le projet initial est lancé en 2006 et toujours inachevé. À 20 km au sud d’Abu Dhabi, une « éco-cité » zéro carbone, zéro déchet, 100 % renouvelable avec des champs de panneaux solaires en plein désert, un arbre à vent qui capte l’air en hauteur et le redistribue vers le bas, permettant de faire chuter la température d’une dizaine de degrés. Le projet porte sur 6 km² à urbaniser et espère accueillir 40 000 habitants à terme avec une forte dimension éducative développée par le Masdar Institute, université technologique et scientifique.
Des mesures inefficaces ?
L’expansion du droit national et international de l’environnement ne doit pas masquer le constat d’une relative inefficacité des instruments adoptés, comme l’a montré le Protocole de Kyoto : symbolique, mais largement inopérant. Difficile notamment d’imposer les exigences du développement durable aux pays en développement, car ces impératifs contribuent à faire peser sur les pays les plus faibles les contraintes les plus lourdes, notamment l’interdiction des techniques de production qui ont permis autrefois aux pays du Nord de s’industrialiser, mais également les coûts directs et indirects élevés suscités par la protection de l’environnement. La Chine, signataire de Kyoto, est ainsi devenue le premier pollueur mondial au tournant du siècle. Par ailleurs, le développement durable est souvent accusé par le Sud de constituer un outil d’ingérence des pays du Nord et des grands organismes internationaux (Banque mondiale, FMI), mais également de certaines ONG, dans les affaires intérieures des pays en développement – l’Inde critique souvent ces dernières.
L’un des problèmes est l’existence de contradictions dans les objectifs écologistes.
La plupart des écologistes réclament une sortie du nucléaire alors que cette énergie n’émet pas de gaz à effet de serre. Il est vrai qu’elle expose à des risques graves et que le traitement des déchets pose problème. Mais sortir du nucléaire entraîne une hausse des émissions de CO2, comme l’Allemagne l’a démontré. Récemment le GIEC a évolué sur ce sujet et s’est montré plus favorable au nucléaire. Que deviendront les programmes de réduction de l’énergie nucléaire adoptés par un pays comme la France ?
L’Allemagne privilégie les énergies renouvelables – l’éolien et le solaire. Le problème est que leur production est intermittente, elle dépend de la force du vent et de l’ensoleillement. Faute de moyen pour stocker l’électricité quand la production est au maximum, le surplus est gaspillé, et il faut faire appel à une énergie d’appoint pour compenser l’offre insuffisante quand la production est à son minimum. L’Allemagne a choisi de le faire en s’appuyant sur les centrales thermiques au charbon ou, pire, au lignite, qui émettent beaucoup de CO2.
Ces centrales se révèlent aussi très polluantes (poussières, rejets de métaux). Les accords internationaux se sont focalisés sur le réchauffement climatique dont le CO2 était rendu responsable. Ils ont du coup négligé d’autres problèmes, la pureté de l’air dans ce cas, ou encore la pureté de l’eau, la diversité des espèces…
Les États-Unis ont pu contenir leurs émissions de CO2 (très importantes par ailleurs) en développant la production de gaz de schiste, qui en émet moins que le charbon ou le pétrole. Mais cette production est accusée de provoquer des failles dans les terrains soumis aux fractures nécessaires à la production, de consommer des quantités considérables d’eau et de polluer les nappes phréatiques.
Le problème est que l’environnement est menacé de multiples façons. En se focalisant sur le réchauffement climatique, les politiques ont négligé les autres atteintes à l’environnement qui ne bénéficient ni de la même attention des médias, ni des mêmes moyens financiers, ni du même effort des entreprises. Les optimistes estimeront que le réchauffement de la planète est la menace la plus grave et qu’il est légitime d’en faire une priorité, les pessimistes parleront d’un effet de mode qui altère le jugement et empêche une analyse objective.
Reste que la transition énergétique est ainsi incomplète et inachevée : les énergies bas-carbone constituent environ un tiers du mix énergétique (32 %), contre plus des deux tiers pour les hydrocarbures et le charbon (68 %). L’absence de prix dissuasif du carbone explique largement cette situation.
Vers le capitalisme vert ?
Les entreprises sont souvent mises en cause pour leurs atteintes à l’environnement et particulièrement au climat. Comme le World Business Council for Sustainable Development qualifié par Yves Cochet, écologiste français, de « club de criminels en col blanc », accusés de piller les ressources naturelles (et particulièrement des énergies fossiles) et de pratiquer un lobbying intense pour empêcher une législation environnementale trop poussée. Ainsi, aux États-Unis, la Global Climate Coalition, qui regroupe des industriels et des pétroliers, a mobilisé l’opinion publique contre une « taxe carbone » qui contribuerait à augmenter le prix de l’essence et des énergies.
En retour, les entreprises ont tout intérêt à occuper le terrain du développement durable pour redorer leur image (pratique dite du green washing). C’est en la matière le scandale de la marée noire de l’Exxon-Valdez en 1989 qui a servi de déclic à nombre de firmes qui se mobilisent ensuite au service de nouveaux principes de bonne conduite. Emblématique est également la création du World Business Council for Sustainable Development, basé à Genève, qui regroupe 170 entreprises représentant une vingtaine de branches d’activité dans 35 pays. Les entreprises n’hésitent plus à collaborer avec ONU, ONG et syndicats professionnels dans le cadre des partenariats du Global Report Initiative (1997), constitué à l’initiative du PNUE (ainsi le partenariat Lafarge-WWF). Une écologie industrielle est également née des efforts de certaines entreprises pionnières en matière de recyclage et retraitement des déchets. Dès 1985, l’entreprise chimique américaine Dow Chemical, à la suite de la tragédie de Bhopal en Inde, lance le programme Waste Reduction Always Pays (connu sous ses initiales WRAP) qui fait figure de modèle pour le recyclage des produits chimiques.
À lire aussi : Les grands marchés de l’énergie aujourd’hui et demain
C’est que les entreprises convoitent de plus en plus le très lucratif marché de l’écologie qui se dessine : un marché en forte croissance, de l’ordre de 8 % par an à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ainsi, les constructeurs automobiles se mettent aux moteurs hybrides puis électriques dans le sillage de la firme Toyota, qui lance sa Prius dès 1997, mais aussi de l’usage de biocarburants, de pots catalytiques. Le marché des énergies propres et renouvelables est investi par des firmes comme Iberdrola, alors leader européen. Les constructeurs danois (Vestas) et allemand (Enercon) dominent le marché de l’énergie éolienne. Déjà leader mondial de l’éolien, l’Allemagne devient au tournant du siècle le premier marché mondial du photovoltaïque, elle recourt déjà aux énergies renouvelables pour 20 % de sa production d’électricité.
Enfin, les populations sont sensibilisées à la citoyenneté et la « consommation » écologiques. Dans les sociétés postindustrielles, les sondages d’opinion attestent d’une conscience aiguë des problèmes environnementaux, même si les nouveaux gestes de préservation de l’environnement ne sont pas encore entrés totalement dans les mœurs : le décalage reste fort entre les discours et la pratique. Mais les pouvoirs publics prennent conscience de l’urgence : en France, le « principe de précaution » est inscrit dans la Constitution de la Ve République et les objectifs d’éducation au respect de l’environnement et au développement durable sont inscrits dans les programmes scolaires du primaire au supérieur dans les années 2000.
Une mode écologiste se développe, surtout au sein des populations des grandes villes du Nord, qui prônent la simplicité volontaire et la « déconsommation ». Elle vient des États-Unis et de Californie en particulier (downshifting) et consiste à réduire volontairement son niveau de vie et limiter ses besoins. C’est un héritage de 1968 et de la pensée d’Ivan Illich (La Convivialité, 1973) : sobriété (consommer moins) et don (autoproduire et échanger). Dans ce cadre, la « consomm’action » est une forme d’engagement.
Les préoccupations environnementales ont fait émerger le concept de développement durable. Il peut permettre de concilier les logiques économiques, sociales et environnementales, ainsi que les temporalités courtes de la politique et de l’économie avec les temporalités plus longues des sociétés humaines et de l’environnement. Toutefois, les plus grandes difficultés pour sa mise en œuvre sont posées par la nécessité d’une gouvernance mondiale, étant donné la globalisation croissante des risques.
A-t-on donc besoin d’une Organisation mondiale de l’Environnement comme il existe une OMC ? Avec ou sans les États-Unis ?
Économie et écologie : irréconciliables ?
Malgré l’exemple de ces entreprises, il semble délicat de concilier économie et écologie. Les temps d’abord ne sont pas les mêmes, l’écologie raisonne à long terme tandis que les acteurs économiques, États ou entreprises, pensent souvent à court terme – l’équilibre du budget ou le profit annuel sinon trimestriel. On l’a vu lors du conflit des gilets jaunes en France, le gouvernement s’inquiétant de la « fin de la Terre » et les gilets jaunes de « la fin du mois », avec d’autant plus de virulence que la prétendue taxation écologique finance rarement des mesures pour l’environnement.
À lire aussi : Livre – Protection de l’environnement et changement climatique au Bénin
En dernier ressort, c’est bien d’un problème de financement qu’il s’agit. Faut-il investir les capitaux disponibles dans la production, pour accélérer la croissance, ou dans la protection de l’environnement ? Sacrifier la première risque de provoquer la stagnation du PIB et donc des revenus et des profits : comment pourra-t-on dès lors financer la politique écologique ?
Plus profondément, la performance économique dépend du progrès technique. C’est le rôle de l’entrepreneur d’innover, selon Joseph Schumpeter. Mais la technique épuise la nature, selon la formule d’Heidegger, elle permet de mettre en valeur toujours plus de ressources, d’accroître les rendements du sol et des mines, elle produit des changements souvent irréversibles. Avec cette vision, écologie et économie seraient totalement incompatibles. C’est bien ce que veulent dire les partisans de la décroissance.
Les optimistes notent au contraire que c’est l’intérêt des entreprises que de se montrer écologistes : pour leur image de marque sans doute, mais aussi pour lutter contre le gaspillage (voir ci-dessus). Les écologistes parlent d’une double crise, économique et environnementale, qui imposerait une même réponse, la croissance verte qui utilise de nouvelles technologies (vertes) et ouvre de nouveaux marchés (verts bien sûr). Tout le problème est de savoir si ces nouvelles activités sont rentables : cela n’est pas toujours démontré dans le cas des énergies renouvelables qui dépendent des subventions accordées par les États.
Toujours l’argent, car il est un « vert » aussi important que celui de la végétation terrestre, le dollar.