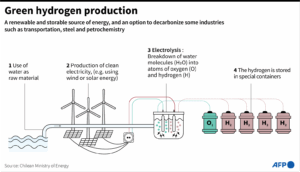Historien des relations internationales, Georges-Henri Soutou a publié plusieurs ouvrages sur la Guerre froide, l’Europe et la diplomatie au XXe siècle. Il est Professeur émérite à la Sorbonne (Paris IV), et membre de l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques).
Entretien réalisé par Louis du Breil.
Qu’est-ce que la puissance géopolitique selon vous ? Est-elle une domination ou un moyen de se développer et de se protéger ?
On connaît les deux cas, et toutes les gradations intermédiaires. La puissance géopolitique est d’abord le résultat d’un état d’esprit, d’une pensée stratégique, l’intériorisation du fait que le monde repose, pas uniquement, mais largement, sur des rapports de puissance et qu’un État doit en tenir compte. De ce point de vue, la Confédération helvétique, par exemple, a toujours eu une conscience stratégique, et le maintien de sa neutralité pendant les deux guerres mondiales et la guerre froide prouve qu’elle a su établir une puissance stratégique certes limitée, mais conforme à ses objectifs et à ses possibilités, et destinée avant tout à se protéger. Pour se faire elle a établi un système militaire rendant sa conquête plus coûteuse que ce qu’un adversaire pouvait espérer en retirer, et elle a joué entre les différents belligérants, en fonction de l’évolution du conflit et en maximisant ses atouts.
Retrouvez les ouvrages de Georges-Henri Soutou.
Vous avez bien sûr les cas extrêmes de domination. L’Empire romain s’est étendu jusqu’à des frontières qu’il n’a pas pu franchir, il n’a pas pu conquérir la Germanie ou la Perse, à cause d’une limite tenant pratiquement à un équilibre hémostatique entre les moyens dont il disposait et la volonté de soumettre des adversaires réels ou potentiels. Mais sa domination, en fait très décentralisée, ne connaissait pas de limite de principe, tout en étant guidée par une volonté de sécurité absolue plus que d’expansion systématique.
L’Allemagne nazie en revanche a donné l’image d’une volonté de contrôle géopolitique absolue et assumée : la domination de l’espace eurafricain, comme base vitale du peuple allemand et de ses alliés germaniques. L’Union soviétique était quant à elle guidée par une idéologie mondialiste par essence : le communisme gagnerait un jour l’ensemble de la planète, c’était une vérité « scientifique », les autres systèmes sociaux disparaîtraient. Mais on n’était pas pressé : à court et à moyen terme, à la différence de l’Allemagne nazie, Moscou pouvait pratiquer une politique de puissance plus habile.
À lire également
Qu’est-ce que la puissance ? #2
Les États-Unis ont une vision, plus qu’une géopolitique: « to make the world safe for Democracy », comme disait Wilson. Mais de fil en aiguille cela les a conduits à une volonté de contrôle mondial, dont la manifestation la plus poussée est la prétention des tribunaux américains à exercer une « compétence universelle » sur les sociétés étrangères, si leurs opérations ont le moindre lien avec les États-Unis, ne serait-ce que le recours au dollar pour leurs transactions. Mais cette volonté s’exerce de fait dans de nombreux secteurs, y compris la finance, l’énergie et les communications de toute nature. On a parlé dans les années 1960 à leur sujet d’ « empire informel » : on pourrait invoquer un projet géopolitique informel.
La Grande-Bretagne est un exemple original d’adaptation constante entre les intérêts, les moyens et les projets. Partie de la défense de l’indépendance des Îles britanniques face aux Continentaux, Londres est passée à un Empire mondial, transformé ensuite en Commonwealth de plus en plus distendu mais jamais disparu, et a recyclé son rôle dans le monde régulièrement, de la « relation spéciale » avec Washington à l’entrée dans la CEE, puis au Brexit et à l’ambition de « Global Britain ». Géopolitique soft, pas toujours couronnée de succès, mais têtue, avec depuis toujours un soin jaloux des facteurs clés de la géopolitique : contrôle des circuits financiers, des communications, et des services de renseignement.
Les autres, font ce qu’ils peuvent (comme l’Italie) ou renoncent et rejoignent un giron accueillant (Alliance atlantique, Union européenne), en essayant d’y faire entendre leur voix. Et puis on a ceux qui ne peuvent plus, ou ne veulent plus, comme la RFA, dont la vision se limite désormais à l’économie et au commerce. Mais peut-on encore parler d’une géopolitique ?
Comment un pays développe et déploie sa puissance ? Peut-on dresser une typologie de la puissance ?
Classiquement la première forme de puissance est le Hard power, en gros la puissance militaire. Mais on reconnaît de plus en plus depuis une trentaine d’années le rôle du Soft power, qui est plutôt une convergence de toutes les formes d’influence (idéologique, politique, culturelle, économique, informationnelle…). En fait la véritable puissance ne se conçoit de nos jours qu’au croisement (certes dans des proportions variables) du Hard et du Soft Power. L’un ne va plus sans l’autre, des États-Unis à la Chine.
On a le cas particulier de la Russie. Elle a du Hard Power, avec des forces armées régénérées depuis leur grave crise des années 1990, et qui, de la Géorgie en 2008 à la Crimée en 2014 et depuis 2015 en Syrie ont démontré leur efficacité. Mais elle n’a que peu de Soft Power au sens occidental du terme, son économie est relativement peu développée, sa présence culturelle, sans être nulle, reste limitée. Cependant elle dispose d’atouts qu’elle utilise à fond : son gaz et son pétrole, les minorités russophones dans l’ancien Empire soviétique, l’attrait de son modèle anti-libéral auprès de certains Européens. C’est ainsi qu’elle arrive à maintenir une zone d’influence, vers la Biélorussie, vers une partie de l’Ukraine, vers le Moyen Orient et l’Asie centrale, qui évoque parfois un empire informel. Une stratégie très systématique compense l’absence relative de moyens.
Dans La Guerre froide de la France (2018), vous montrez comment la France a opté pour une voie spécifique, ni antisoviétique ni antiaméricaine. Était-ce un choix de puissance, destiné à imposer sa stratégie à ses voisins, ou bien le choix d’une non-puissance, contraint de ménager les deux superpuissances ?
Les deux, sans doute ! Ou plutôt le choix d’une puissance moyenne, mais qui ne renonce pas à jouer un rôle mondial, ou au moins sur la scène mondiale. C’est évident pour la Ve République, mais c’était déjà le cas pour la IVe. La IVe République avait poursuivi le projet de l’Union française, créée en 1946 pour tenter d’adapter l’Empire aux temps nouveaux, mais auquel la défaite de Dien Bien Phu en 1954 porta un coup fatal. Elle avait également promu le concept d’Eurafrique, jusqu’à l’expédition de Suez avortée en 1956. Le fait que cette dernière opération ait été lancée avec les Anglais mais sans le soutien ou même l’accord américain montre bien que l’on ne voulait pas dépendre des États-Unis et que l’ « atlantisme » avait des limites.
À lire également
Frédéric II, un modèle de puissance ? Entretien avec Sylvain Gouguenheim #1
A partir de 1958, de Gaulle tira la leçon de ces échecs. Il n’abandonna pas une vision mondiale mais il la modernisa. Elle ne reposerait plus principalement sur une Union française transformée en Communauté franco-africaine, et devenant d’ailleurs une zone d’influence plus qu’un ensemble géopolitique. D’une part le Général dota la France de l’arme nucléaire, désormais le cœur du Hard Power, et il mit en place une « géopolitique à la française », qui visait à la fois à prendre la tête de l’Europe occidentale et à ménager, dans un monde bipolaire, un espace de liberté pour la France. C’est ainsi que la France contrôlerait l’évolution de la question allemande grâce à Moscou, tout en rééquilibrant l’URSS grâce à un rapprochement franco-allemand permettant d’organiser l’Europe occidentale. Cet entrecroisement d’équilibres juxtaposés permettant de compenser le déficit de puissance de la France. Et Paris se situerait au point de rencontre de trois ensembles : l’Afrique, l’Europe et un monde atlantique abandonnant l’intégration militaire de l’OTAN et réorienté vers des accords bilatéraux de collaboration avec les États-Unis. Sans hésiter à faire entendre sa voix en Amérique latine ou en Asie (reconnaissance de la Chine populaire en 1964). Cette vision, très ambitieuse mais sans doute trop, avait cependant sa cohérence, et ses successeurs ne l’abandonnèrent jamais totalement.
La construction européenne est tributaire d’une certaine vision de la puissance. Pour certains, elle est un démultiplicateur de puissance, pour d’autres, elle pallie la disparition de la puissance française. Ce débat sur les rapports entre puissance et construction européenne est-il seulement français ou se retrouve-t-il également en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale ?
Le débat autour du rapport entre la construction européenne et la puissance française n’a pas cessé depuis les années 1950. Castration ou résurrection ? C’était tout le sens de l’affrontement autour de la Communauté européenne de Défense (CED) en 1951-1954, aboutissant à son échec devant le Parlement français en 1954. Le débat, presque dans les mêmes termes, reparut en 1992 (référendum à propos du traité de Maastricht) et en 2005 (référendum à propos du projet de traité constitutionnel).
Le débat était plus complexe qu’on ne le pense souvent. En effet la construction européenne ne vise pas la puissance, elle en est par construction même antinomique. Elle vise d’abord à dépasser les clivages historiques entre peuples européens, qui ont produit tant de guerres catastrophiques. Mais elle ne promeut pas vraiment une sécurité et une défense proprement européennes: l’Armée européenne de la CED aurait été en effet placée sous commandement atlantique, pas européen. Le traité de Maastricht maintient la Politique Extérieure et de Sécurité Commune (PESC) résolument dans le cadre de l’Alliance atlantique, tout comme le traité de Lisbonne (2009), même si ce dernier comporte une clause d’assistance obligatoire, y compris sur le plan militaire.
La tentative française la plus nette pour construire une Union politique avec un important volet stratégique fut le « Plan Fouchet » de 1961, mais qui échoua justement parce que de Gaulle refusa d’y inclure une référence à l’Alliance atlantique. Certes, des choses ont été faites à partir de 1998, avec de nombreuses opérations de l’Union européenne pour « le maintien ou le rétablissement de la paix », des Balkans à l’Afrique et à l’Océan indien. Mais ces opérations sont en fait des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre, ce ne sont pas des opérations militaires majeures, qui pour nos partenaires restent et doivent rester du domaine de l’OTAN.
Ajoutons que depuis le début du siècle la politique européenne de sécurité vise d’abord à élargir aux régions voisines de l’UE les normes de toute nature de l’État de droit et de la démocratie (« politique de voisinage » depuis 2004) avec pour objectif d’assurer ainsi la sécurité de l’Union, la perspective d’adhésion devant dans certains cas faciliter l’adoption de ses valeurs et ainsi élargir le périmètre de sécurité de l’Europe. Les gouvernements français successifs ont toujours trouvé cela insuffisant, mais leurs appels à une « souveraineté stratégique européenne» ou à une « autonomie stratégique de l’Union » n’ont jamais convaincu leurs partenaires.
Le débat se retrouve aussi en Allemagne, mais évidemment avec des paramètres différents, la politique de puissance pratiquée de 1871 à 1945 n’ayant pas produit tous les résultats escomptés. Lors de sa création en 1949 la RFA ne jouit encore que d’une souveraineté très limitée, et le premier objectif du chancelier Adenauer sera d’obtenir l’ « égalité des droits ». C’est pourquoi il soutiendra le projet de CED, qui eut mis Bonn sur un pied d’égalité, mais il misa encore plus sur l’entrée de la RFA dans l’Alliance atlantique (1955) qui lui assurait à la fois un statut égal et la protection américaine face à l’URSS. Mais à partir de 1957, avec les progrès nucléaires et balistiques de la Russie, le chancelier et certains de ses collaborateurs, comme son ministre de la Défense Franz-Josef Strauss, pensèrent que la garantie américaine devenait incertaine. D’où un rapprochement stratégique avec Paris, qui aboutit au traité de l’Élysée de janvier 1963, qui comporte un important volet défense.
À lire également
Qu’est ce que la puissance maritime ? Entretien avec Yan Giron #3
Mais les Américains contre-attaquèrent vigoureusement et en fait le monde politique allemand ne suivit pas Adenauer : la garantie américaine paraissait plus crédible que la française, et personne n’avait envoie de voir l’Allemagne devenir le « brillant second » de la France. La RFA revint donc dans le giron atlantique, dont elle ne devait plus sortir, malgré quelques tentatives de rapprochement stratégique avec Paris (Giscard d’Estaing-Schmidt, Kohl-Mitterrand, Chirac-Schröder). Depuis les années 2010 l’orientation atlantique est plus marquée que jamais, tandis que le souci de la puissance, pas éteint totalement jusque-là, a disparu largement avec Angela Merkel, et encore plus radicalement avec le nouveau gouvernement du chancelier Scholz, dont le logiciel ne fait pas de place à la puissance mais compte sur l’exemplarité du modèle démocratique transnational, y compris toutes les variations sur l’égalité des droits et sur la lutte pour le climat et l’écologie, à l’instar de l’Union européenne.
Beaucoup d’hommes politiques se réfèrent au général de Gaulle, sans que le gaullisme soit réellement défini. Est-ce que la vision de la puissance portée par de Gaulle a évolué au cours de sa carrière, ou bien est-elle restée la même de 1940 à 1969 ?
L’axe principal a été de 1940 à 1969 la défense envers et contre tous de l’indépendance nationale, inséparable de la nature même de la démocratie, selon de Gaulle. Mais une indépendance modernisée, incluant les aspects financiers, économiques, scientifiques et techniques.
A partir de là la France a pour lui un rôle international à jouer, afin de maintenir sa nature historique et son message. On peut dire que l’influence et l’exemplarité sont plus importantes pour le Général qu’une puissance de nature essentiellement matérielle, de type traditionnel. D’où l’importance du discours (Appel du 18 juin, discours de Phnom Penh en 1965…). Le discours gaullien ne se sépare pas de l’action, il est performatif, pas seulement explicatif ou simplement destiné à rallier l’opinion, française ou étrangère. De Gaulle avait parfaitement compris qu’à l’époque de la radio et de la télévision, le discours a une autre portée qu’une intervention devant une assemblée ou un parlement.
Bien entendu, le Général est un réaliste et sait ce que c’est qu’un rapport de force. D’où l’avantage pour lui de la dissuasion nucléaire : l’atome possède un pouvoir égalisateur, il permet au faible de dissuader le fort. Et c’est pourquoi il consacra ses plus grands efforts, dès 1945, afin de doter la France de cette arme.
D’autre part de Gaulle pouvait évoluer : à partir de 1958, quand il comprit que la politique de 1944 (alliance avec Moscou, et division de l’Allemagne) n’est plus suffisante ou actuelle dans le cadre de l’affrontement Est-Ouest, il intégra le « multiplicateur européen » dans sa réflexion (Plan Fouchet, traité de l’Élysée…).
Finalement, la puissance s’exprime de manière spécifique en fonction des pays. Y a-t-il une continuité historique dans l’idée que la France se fait de sa puissance ?
Sans doute. Le premier à l’avoir exprimée fut le roi Philippe le Bel face à l’empereur romain-germanique, en 1302 ou 1303 : « Le roi est empereur en son royaume ». C’est le point de départ : la puissance, c’est d’abord la souveraineté sans partage ni inféodation.
La deuxième caractéristique est la volonté de proclamer un message à portée universelle : c’était déjà le cas de Louis XIV, « roi du Monde », de la Révolution, de la IIIe République, de la Ve…
La troisième caractéristique est une volonté de faire reposer l’ordre international sur la notion d’équilibre entre les puissances, plutôt que de rechercher une sécurité absolue par un contrôle aussi étendu que possible. Du moins si on excepte des périodes expansionnistes, comme Louis XIV ou la Révolution et l’Empire…
La quatrième caractéristique est que les moyens de la puissance sont souvent négligés (marine, finances, communications, renseignement…). Peut-être parce qu’une société historiquement terrienne, fascinée par le service public, de la Monarchie à la République, a du mal à intégrer le véritable logiciel de la puissance ?
Parallèlement depuis 1789 (voire avant…) la France a connu une organisation politique souvent peu faite pour la projection de la puissance, au mieux pour la défense nationale… La Ve République a essayé de corriger cette tendance : y est-elle parvenue définitivement ? On peut en douter…
À lire également