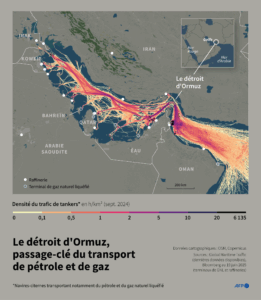Le « pouvoir feutré » des États-Unis est-il sans limites ? Il se heurte à celui de leurs principaux concurrents, mais là n’est pas la principale menace. Les limites du soft power américain sont internes, elles tiennent à la nature même de ce soft power.
Caractérisé en 1990 par Joseph Nye dans son ouvrage Bound to Lead, le concept de soft power, soit la capacité d’une nation à séduire et à persuader les autres acteurs internationaux grâce à l’attrait de ses valeurs, de ses idées et de sa culture, connaît depuis 25 ans un incontestable succès sur le plan du marketing intellectuel, à l’égal de la « fin de l’histoire » de Samuel Huntington, ou du « choc des civilisations » de Francis Fukuyama[1].
Une vieille nouvelle idée
Qu’on en traduise le principe par « puissance douce », comme au Québec, ou « influence culturelle », comme en France, l’idée d’un lien entre puissance et influence n’a rien d’inédit en elle-même. Nye le reconnaît volontiers : « La réalité du “soft power” est bien loin d’être nouvelle ; je n’ai, pour ma part, fait qu’apporter des mots, des concepts et une réorientation des méthodes d’analyse[2]. » On en trouve déjà la logique chez le Français Gustave Le Bon en 1895 : « Les phénomènes du monde visible, observait celui-ci, ont leur racine dans un monde invisible où s’élaborent les sentiments et les croyances qui les mènent[3]. » Dans les années 1920, le politiste britannique Edward Hallett Carr met quant à lui en avant la notion de power over opinion.
Néanmoins, ce sont bien les universités américaines qui, au sortir du second conflit mondial, ont, les premières, caractérisé véritablement les phénomènes d’influence dans les relations internationales, en tentant de les mesurer et d’en déduire des stratégies d’action. Dès les années 1960, au moment même où le phénomène d’américanisation culturelle de la planète bat son plein, le Centre Edward R. Murrow de la Fletcher School, à l’université de Tufts, pose significativement les bases du concept de diplomatie publique (Public Diplomacy). Celui-ci repose sur deux présupposés principaux. D’une part, et sur le plan historique, la reconnaissance d’un fait : le développement, en un endroit déterminé du globe, d’un « modèle américain », laboratoire humain aux contours juridiques, économiques et politiques fondés sur la maximisation du bien-être individuel. D’autre part, sur le plan culturel et moral, le développement d’une conviction subséquente, celle que ce modèle est seul véritablement porteur de valeurs universelles, et que son exportation dans le monde entier servira tout à la fois les intérêts des États-Unis et de l’humanité.
De ce fait et de cette conviction découle une politique d’influence au travers de laquelle il s’agira moins de gagner l’alliance d’un gouvernement étranger que d’assurer progressivement l’adhésion des sociétés civiles mondiales aux valeurs constitutives du modèle culturel américain. C’est en fonction de cette Public Diplomacy que le concept de soft power de Nye prend tout son sens. Selon Pierre Pahlavi, « la diplomatie publique est, surtout, l’effort d’un gouvernement cherchant à influencer l’opinion publique dans un État étranger en faveur de son propre intérêt. L’hypothèse sous-jacente est qu’il est possible, par l’intermédiaire des populations étrangères, d’atteindre des objectifs stratégiques de politique étrangère comprenant des intérêts sécuritaires et économiques, au lieu de se limiter à ne convaincre que leurs seuls gouvernements[4]. »
Cette stratégie, portée par un savoir-faire américain indubitable en matière d’exportation de contenus culturels, a donné des résultats impressionnants sur le plan politique. « Que serait la place effective des États-Unis dans le monde sans l’imposant soft power médiatique déployé par Washington depuis la Seconde Guerre mondiale ? », interroge avec justesse Alexis Bautzmann[5]. Le classement 2017 du Soft power 30, publié par le cabinet de conseil britannique Portland, valorise les pays « champions de l’ouverture, de la tolérance et de la collaboration internationale ». Intouchables sur le plan du rayonnement de leurs établissements d’enseignement supérieur, de l’innovation technologique, de la maîtrise d’Internet, les États-Unis y sont encore très bien placés (3e). Dans les années 2000, 75 % des films projetés dans le monde sont toujours américains. Pour Ophir Lévy, « cela a constitué une vitrine formidable pour les États-Unis. Leur mode de vie, leur mode vestimentaire, leurs habitudes alimentaires, leurs traditions se sont imposés petit à petit de par le monde en nous devenant familiers[6]. » Dans La Fin du rêve américain ?, publié en octobre 2017, Lauric Henneton va dans ce sens, en jugeant que le « rêve américain » conserverait un immense pouvoir d’attractivité sur des millions de gens de par le monde[7].
A lire aussi : Les États-Unis face au défi chinois
Nye l’optimiste
La diplomatie publique américaine, qui porte un message politique dont le coefficient de séduction est d’autant plus élevé qu’il peut s’appuyer sur un fort rayonnement culturel, posséderait donc toujours des bases solides. Le soft power américain, tel que Joseph Nye le décrit, a-t-il pour autant résisté à la perte de crédibilité et de leadership dont semblent actuellement souffrir les États-Unis ? À quel niveau réel se situe aujourd’hui la capacité de l’Amérique à influer, à modeler les perceptions, à faire rêver, à susciter le désir de rejoindre ou d’approcher les valeurs universelles qu’elle est censée représenter ?
Il faut tout d’abord rappeler que le cœur de l’argumentaire de Nye (on l’oublie parfois), porte moins sur l’influence elle-même que sur ce que l’on pourrait appeler l’interdépendance asymétrique : « Économiquement, explique-t-il ainsi, [la Chine], avec les vagues de dollars qu’elle brasse, a les moyens de mettre à genoux les États-Unis. Mais sur d’autres plans, notamment sur celui des valeurs et de la culture, la relation est asymétrique : les États-Unis bénéficient d’une adhésion beaucoup plus forte des autres pays du monde que la Chine. Les États-Unis, c’est la démocratie, une culture populaire qui séduit partout sur le globe. “Attaquer” les États-Unis, sur le plan économique, serait donc un très mauvais calcul de la part des Chinois, qui se placeraient eux-mêmes dans une position délicate par rapport au reste du globe. Il est essentiel de donner leur importance aux symétries et aux asymétries dans les relations d’interdépendance. »
La question n’est donc pas de savoir si les États-Unis sont plus dépendants qu’autrefois envers leurs partenaires et concurrents – c’est évidemment le cas – mais si leur soft power leur donne toujours une asymétrie d’influence susceptible de compenser leur perte relative de puissance économique et politique. Pour Nye, qui est d’abord un penseur de la puissance avant d’être un théoricien de l’influence, le tableau reste positif de ce point de vue. Dans The Future of Power, en 2011, il estime ainsi que la culture américaine a toujours suffisamment de dynamisme pour transcender les politiques conjoncturelles des gouvernements américains, fussent-ils impopulaires, et les crises économiques, fussent-elles prolongées. En dépit des difficultés consécutives à la désastreuse aventure irako-afghane post-11 septembre, Washington reste ainsi, selon lui, le seul acteur mondial à contrôler le triptyque fondamental constitué de la puissance économique, de la puissance militaire (« hard power ») et, en l’occurrence, de la puissance douce (« soft power »), cette dernière permettant encore aux États-Unis d’attirer sur leurs campus les meilleurs cerveaux de la planète, convaincus de la supériorité du modèle politique des Pères Fondateurs de la République du Nouveau Monde[8]. Que ce soft power soit affaibli conjoncturellement n’aurait donc pas vraiment de répercussions systémiques.
Suivez l’argent
Le facteur Trump est, certes, reconnu comme globalement très négatif pour l’image de Washington : en juin 2017, le Pew Research Center, qui mesure tous les ans l’image des États-Unis dans le monde, indique que seul un tiers des Danois (32 %) et des Espagnols (31 %), et un quart des Allemands (26 %) pensent que l’extension du soft power américain est une bonne chose. Les chiffres sont mauvais en Amérique latine et en Russie, désastreux au Moyen-Orient, meilleurs en Asie-Pacifique et excellents en Israël.
Pourtant, le même institut indique également, malgré le facteur Trump, que l’attrait pour la culture populaire américaine est toujours assez largement partagé dans le monde : 30 pays sur 37 étudiés par l’institut de sondage ont une majorité de leur population déclarant apprécier les produits culturels américains. Les Russes, qui ne sont que 26 % à souhaiter l’extension du soft power américain, pensent à 61 % que les États-Unis respectent les libertés individuelles des Américains (une progression de 20 points par rapport à 2015). Conclusion des chercheurs du Pew Center : « L’image des États-Unis souffre, tandis que les publics mondiaux questionnent le leadership de Donald Trump », constat corrigé, selon les mêmes, par le fait que « l’Amérique suscite toujours l’adhésion pour son peuple, sa culture et ses libertés civiles[9] ». En d’autres termes, il est a priori toujours possible pour les États-Unis de viser l’adhésion latente de la société civile mondiale aux « valeurs » américaines, et de continuer à assurer à Washington un avantage comparatif décisif dans l’arène internationale, compte tenu des chaînes d’interdépendance constitutives de la mondialisation actuelle, sur le plan économique en particulier.
Un certain nombre d’analystes abondent dans le sens de cette interprétation optimiste, en utilisant des arguments complémentaires : pour Ruchir Sharma, stratégiste chez Morgan Stanley, il n’est ainsi « pas évident qu’une quelconque érosion du soft power due à Trump représente une menace pour le hard power américain, y compris sa force économique et financière mesurable ». Les États-Unis, rappelle-t-il, représentent toujours 24 % de la richesse mondiale, ils restent la seule superpuissance financière globale, et 90 % des transactions bancaires internationales sont conduites en dollars. Conclusion de Sharma : « Pour identifier en quelle nation le monde a réellement confiance à long terme, suivez l’argent. Et cet argent circule en dollars. Indubitablement c’est le vote de confiance en faveur de l’Amérique qui compte le plus[10]. »
A lire aussi : Guerre commerciale entre Trump et la Chine
Les déceptions de la « promesse » américaine
La fragilité de ce raisonnement est assez frappante. On peut en effet considérer que le problème à moyen terme pour le soft power américain n’est sans doute ni la force de frappe financière globale de Washington, ni le niveau d’entraînement du corps des Marines, ou, au choix, le fait que Games of Thrones soit la série la plus téléchargée au monde, mais bien la question du revenu de la famille américaine typique et des perspectives réelles d’ascension sociale aux États-Unis. Ce sont ces indicateurs, et non le bilan de santé des banques d’affaires de Wall Street, qui conditionnent le fonctionnement fluide de la démocratie américaine et l’équilibre de son modèle culturel, bases d’un soft power national qui repose d’abord et avant tout politiquement sur les éléments du « credo américain » (liberté, égalité, individualisme, gouvernement représentatif, propriété privée), et socialement sur les fondamentaux de l’American way of life.
Pourtant le modèle américain est lézardé. Quoi qu’en disent les tenants de la thèse pérennialiste, d’Henry Nau (The Myth of American Decline) à Fareed Zakaria, lesquels ne croient pas au déclin des États-Unis, ceux-ci ne sont plus le modèle politique, culturel et social qu’ils étaient encore en partie à la veille des attentats du 11 septembre 2001. Leur aura morale s’est affadie. Leur modèle consumériste et inégalitaire a été fortement abîmé par une crise économique et financière systémique dont ils portent la responsabilité indubitable[11]. Leur potestas est certes immense, avec une puissance militaire inégalée, mais ils ne semblent plus parvenir à en tirer l’auctoritas nécessaire pour s’imposer dans les relations internationales, où d’autres acteurs bousculent leurs positions.
Le plus inquiétant est, de fait, la question de leur cohésion sociale. En 2012, le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz l’explique éloquemment dans Le prix de l’inégalité : « La puissance mondiale de l’Amérique, c’est son soft power, le pouvoir de ses idées, un système pédagogique qui éduque les dirigeants du monde entier, le modèle qu’elle propose aux autres. (…) Les États-Unis ont longtemps exercé leur influence à travers la vigueur de leur économie et l’attrait de leur démocratie. Mais le modèle américain perd une partie de son lustre. Pas seulement parce que le capitalisme américain n’a pas apporté la croissance prolongée. C’est plutôt que les autres commencent à comprendre que la grande majorité des citoyens d’a pas bénéficié de cette croissance : un modèle de ce genre n’est pas politiquement très attrayant. Et ils sentent bien, aussi, la corruption (à l’américaine) de notre système politique, que pénètre de toute part l’influence d’intérêts privés[12]. »
L’argument qui consiste donc à penser que Donald Trump serait la principale cause de la perte d’influence américaine et qu’il suffirait que celui-ci quitte le pouvoir pour que la situation se rétablisse, apparaît en réalité biaisé. L’opinion mondiale fait certes la différence entre Trump et la société civile américaine Mais cela ne l’empêche pas de juger de l’état de fragmentation et d’inégalité qui marque aujourd’hui une Amérique de plus en plus polarisée politiquement, économiquement, socialement et ethniquement.
C’est cette Amérique en plein doute, maussade et passablement névrosée – celle que l’on rencontre dans « We Blew it », le superbe documentaire de Jean-Baptiste Thoret en forme de plongée dans la campagne présidentielle de 2016 – qui peut constituer le facteur décisif d’orientation pour la trajectoire future du soft power des États-Unis. Celui-ci, qui restera conséquent, ne demeurera cependant pas tout-puissant, et n’empêchera pas la survenue d’un déclin de la puissance américaine globale, malgré l’articulation effectivement unique du triptyque économique, militaire et culturel décrit par Nye. Le phénomène en cours renvoie aux prédictions de Charles Cogan en 2010, lequel annonçait pour 2030 des États-Unis marqués par la conjonction d’une métamorphose interne et d’un déclin externe[13]. C’est sur cette « métamorphose » interne qu’il faudrait sans doute se concentrer davantage du point de vue de l’analyse, comme le fait Robert Schiller dans un article récent extrêmement éclairant, en rappelant la définition du « rêve américain » que donnait en 1931 James Truslow dans The Epic of America, le livre qui popularisa la notion : « Le rêve d’une terre où la vie serait meilleure, plus riche et plus complète pour chaque homme, avec des opportunités pour chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses accomplissements […] Ce n’est pas un rêve de voiture ni de hauts salaires, précisait Truslow, mais un rêve d’ordre social dans lequel chaque homme et chaque femme seront capables d’atteindre le niveau le plus complet dont il sont intrinsèquement capables, en étant reconnus par les autres pour ce qu’ils sont[14]. »
C’est une définition morale, et non matérielle, qui est donnée ici, comme le fait remarquer Schiller à bon escient. Le rêve américain est à la base du soft power américain, cette base est morale et elle s’exprime en termes de trajectoire. En ce sens, et malgré toute la puissance d’innovation technologique, le potentiel militaire et l’industrie culturelle américaine, la crise morale, sociale et politique qui s’aggrave aux États-Unis pourrait bien, à terme, s’avérer le facteur le plus décisif de faiblesse pour l’avenir du soft power américain, davantage peut-être que le tournant nationaliste pris par la présidence Trump sur le plan externe.
- Joseph Nye, Bound to Lead. The Changing Nature of American Power. Basic Books, New York, 1990.
- « Sur la valeur stratégique du Soft Power » – Interview de Joseph Nye, France Culture, 23 décembre 2012.
- Gustave Le Bon, Enseignements psychologiques de la guerre européenne, Paris, Flammarion, 1920, p. 2.
- Pierre Pahlavi, « La diplomatie publique », dans Frédéric Ramel et Thierry Balzacq, Traité de relations internationales, Paris, Presses de Science-Po, 2015, p. 554.
- Alexis Bautzmann, « éditorial », Les grands dossiers de Diplomatie, n° 41, octobre-novembre 2017, p. 1.
- Ophir Lévy, Le cinéma ou le pouvoir de l’image au service de l’influence et de la propagande », Les grands dossiers de Diplomatie, op . cit., p. 33.
- Lauric Henneton, La fin du rêve américain ?, Paris, Odile Jacob, 2017.
- Joseph P. Nye, The Future of Power, New York, PublicAffairs, 2011.
- “U.S. Image Suffers as Publics Around World Question Trump’s Leadership. America still wins praise for its people, culture and civil liberties”, Pew Research Center, 26 juin 2017, http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-question-trumps-leadership/
- Ruchir Sharma, “Which Nation Does the World Trust Most? (Hint: Follow the Dollar)”, New York Times, 25 décembre 2017.
- Stéphanie M.-L. Heng, « Interroger le soft power dans les réseaux de production et de diffusion d’informations d’actualité sur les pays émergents », Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], 7 | 2015.
- Joseph Stiglitz, Le prix de l’inégalité, Paris, Les liens qui libèrent, 2012.
- Charles Cogan, « Métamorphose à l’intérieur, déclin à l’extérieur : les États-Unis et le monde en 2030 », Revue internationale et stratégique, 2010/4 (n° 80), p. 97-106.
- Robert B. Schiller, « The Transformation of the “American Dream” »,,New York Times, 4 août 2017.