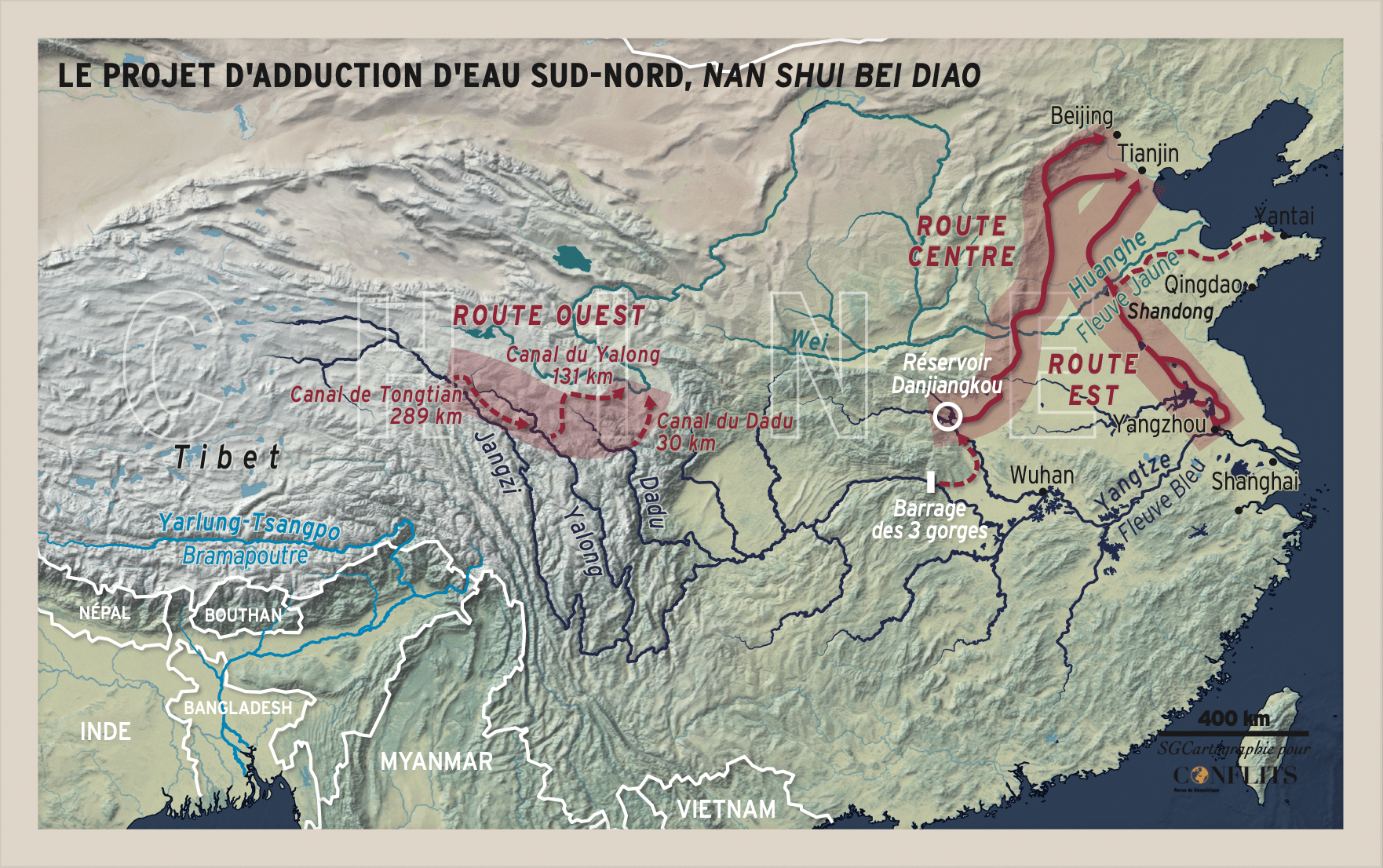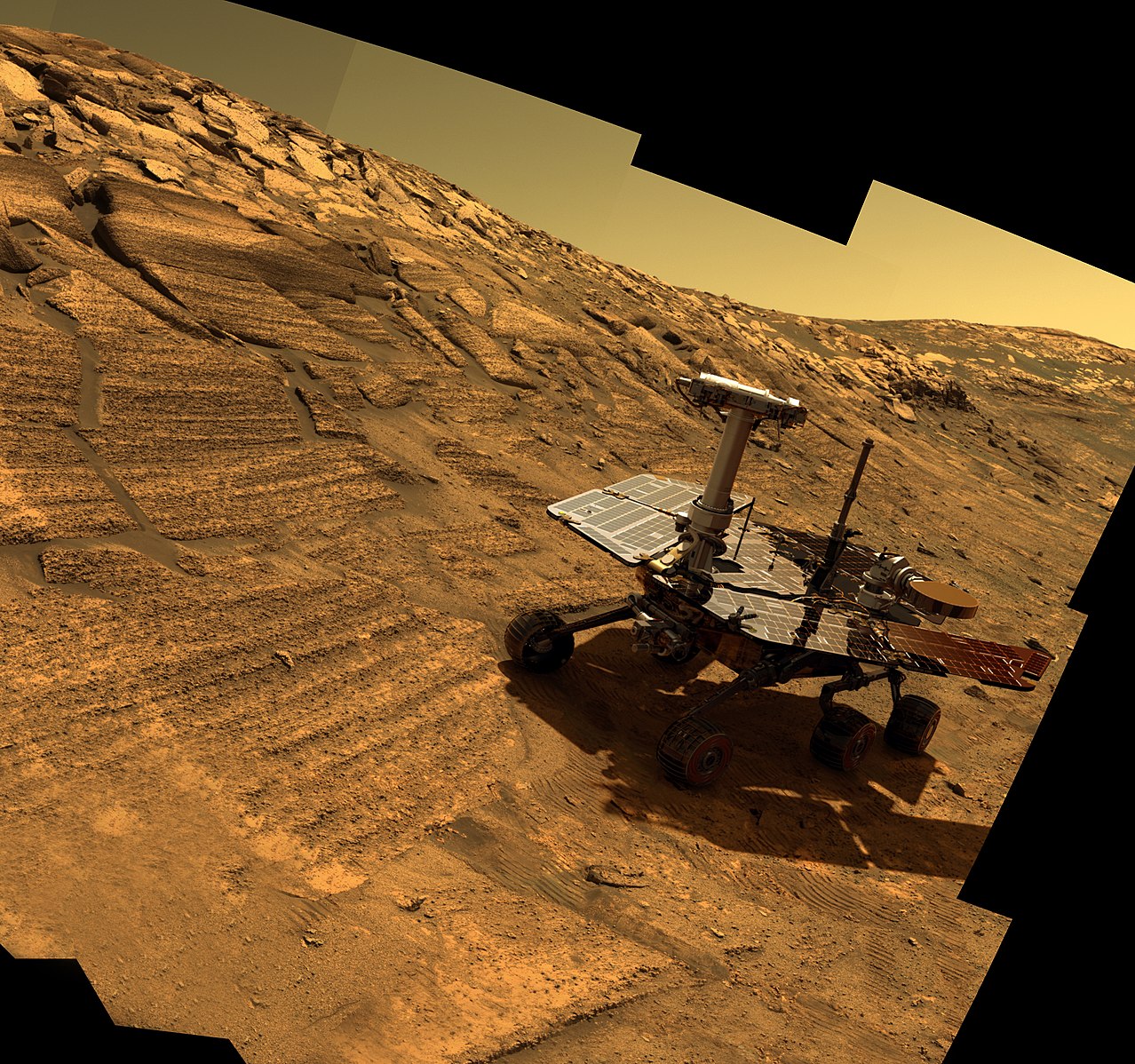Conflits est heureux de vous offrir un article inédit consacré au Grand Jeu, c’est-à-dire à l’affrontement entre les grandes puissances pour le contrôle du cœur de l’Eurasie. Par Christian Greiling, historien et observateur du Grand Jeu eurasiatique.
Expression popularisée par Rudyard Kipling, le « Grand jeu » fut, au XIXème siècle, la rivalité pour le contrôle de l’Asie centrale entre l’Angleterre victorienne, installée aux Indes, et la Russie tsariste, en expansion vers le sud et l’est. Cet affrontement, qui prenait la forme d’une lutte d’influence, d’une course à l’exploration ou de tentatives d’alliances avec les principautés ou tribus locales, se déroulait dans les décors somptueux de l’Himalaya, du Pamir, des déserts du Taklamakan ou de Gobi, sur une terre d’une richesse historique incroyable.
À la croisée des chemins, au cœur de l’Eurasie, l’Asie centrale a vu la naissance ou le passage des principaux éléments qui ont façonné l’histoire du monde. Les peuples indo-européens en sont partis pour s’installer, par vagues successives, en Europe, en Iran ou en Inde, suivis, deux mille ans plus tard, par les peuples turcs. Les invasions des Huns ou des Mongols furent plus courtes mais bouleversèrent le monde sédentaire de fond en comble. Les plus grands conquérants y sont passés – Cyrus, Alexandre, Gengis Khan, Tamerlan ou Babur, le fondateur des Grands Moghols – mais l’Asie centrale était également terre de culture. Non loin des cavaliers turcs ou mongols, une société raffinée s’est épanouie au fil des siècles et des civilisations prestigieuses et parfois improbables – penser par exemple au royaume gréco-bouddhiste de Ménandre dans l’actuel Pakistan – s’y sont succédées, dont Boukhara, Samarkand ou Lhassa sont les témoins privilégiés. Outre la soie, dont les Romains raffolaient, la Route de ce nom apporta en Occident les découvertes majeures de la civilisation chinoise : poudre, papier, imprimerie. En sens inverse, les grandes religions universelles qui coexistaient le long de cette voie commerciale multimillénaire – le mazdéisme qui y est né, le chamanisme, le manichéisme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme et même le judaïsme – prirent le chemin de l’Orient.
L’invasion mongole fut le chant du cygne des nomades. Les peuples se sédentarisaient, les États modernes se constituaient et bientôt, deux grands empires s’y rencontrèrent. Après avoir mis fin au joug turco-mongol de la Horde d’or, la Russie avait engagé son expansion vers l’est tandis que l’empire maritime britannique avait mis la main sur les Indes et avançait vers le nord. La rencontre eut lieu en Asie centrale et c’est à un Grand jeu subtil et romanesque que se livrèrent les deux puissances sur l’énorme échiquier allant du Caucase « barbare » au Tibet glacé. Appelé « Tournoi des ombres » par les Russes, cet affrontement épique, jamais déclaré, mettait en scène aventuriers, espions ou explorateurs, souvent déguisés en pèlerins autochtones, une boussole dissimulée dans leur moulin à prières bouddhiste ou comptant les mètres grâce aux boules de leurs chapelets ! Car cette rivalité n’a que rarement débouché sur des affrontements armés, même si le souvenir de la désastreuse expédition britannique reste très présent en Afghanistan : des 16 000 sujets de Sa Gracieuse Majesté qui quittèrent Kaboul en janvier 1842, un seul parvint à la frontière, tous les autres ayant été massacrés dans les défilés par les tribus pachtounes – déjà ! Le Grand jeu consistait surtout à nouer d’improbables alliances avec des potentats locaux versatiles qui ne se privaient pas de jouer double jeu, mais aussi à dresser des cartes et à reconnaître des itinéraires dans des régions alors très peu connues, des territoires grandioses et sauvages, au milieu de tribus farouches où être découvert signifiait généralement la mort…
Plusieurs dates ont été mises en avant pour marquer la fin du Grand jeu. La création de l’actuel Afghanistan comme État tampon à la fin du XIXème siècle ou la défaite du tsar en 1905 dans la guerre russo-japonaise ou encore la convention anglo-russe de 1907 définissant les sphères d’influence respectives des deux empires en Perse, en Afghanistan et au Tibet. En réalité, le Grand jeu n’a jamais vraiment pris fin et l’on retrouve encore des luttes d’influence dans les années 30 entre Russes devenus Soviétiques et Britanniques, notamment au Turkestan chinois, l’actuel Xinjiang (sur la riche histoire de l’Asie centrale, on se réfèrera à l’incontournable ouvrage du regretté Jean-Paul Roux, L’Asie centrale : histoire et civilisation, Fayard. Sur l’épique rivalité entre Britanniques et Russes : Peter Hopkirk, Le Grand jeu, officiers et espions en Asie centrale, Nevicata).
Il n’est pas un géopolitologue qui ne parle à présent d’un « nouveau Grand jeu » en Asie centrale, moins romanesque mais tout aussi passionnant, dont les ramifications s’étendent à l’échelle de la planète et qui vise, ni plus ni moins, à la domination du monde. Une partie de poker infiniment plus complexe et variée, à plusieurs joueurs – Russie, États-Unis et Chine, auxquels il faut ajouter les éternels frères ennemis Inde et Pakistan et, en toile de fond, l’Iran, la Turquie et le Japon –, le tout saupoudré d’islamisme et de terrorisme, de ressources énergétiques gigantesques qui vont conditionner le futur développement économique du monde, d’une guerre des « tubes » sans merci et de conflits locaux anciens et irréductibles. Une partie de l’avenir du monde se joue entre les montagnes du Pamir, où trois puissances nucléaires – Inde, Chine et Pakistan – se regardent en chiens de faïence, et les sables du Gobi, entre la Caspienne – qui ne produit plus de caviar mais inonde le marché de son gaz et de son pétrole – et le Tibet. Rivalité des grands, terrorisme, hydrocarbures, guerres, pipelines, nucléaire, le tout dans la zone la plus disputée du globe : le cocktail est explosif ! Faites vos jeux, rien ne va plus…
Le pivot du monde

La pensée géopolitique britannique puis celle des États-Unis, qui en ont hérité, s’articule autour de la thèse de pivot du monde (Heartland).
Dans la foulée d’Halford Mackinder (1861-1947), la pensée géopolitique britannique puis celle des États-Unis, qui en ont hérité, s’articule autour de la thèse de pivot du monde (Heartland). Pour l’école anglo-saxonne, c’est autour de l’Eurasie et plus particulièrement de son centre, l’Asie centrale, véritable cœur du monde, que s’articulent toutes les dynamiques géopolitiques de la planète : « Celui qui domine le Heartland commande l’Ile-Monde. Celui qui domine l’Ile-Monde commande le Monde ». Disciple de Mackinder, Nicholas Spykman (1893-1943) est considéré comme l’un des pères de la géopolitique aux États-Unis. S’il reprend la théorie du Heartland, il y rajoute un Rimland, sorte de croissant entourant le cœur du monde, région intermédiaire entre le Heartland et les mers riveraines et comprenant l’Europe, le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l’Extrême-Orient. Pour Spykman, c’est dans cette zone tampon du Rimland que se joue le vrai rapport de forces entre la puissance continentale et la puissance maritime et il convient d’empêcher à tout prix l’union du Rimland et du Heartland en soutenant les États du croissant contre le centre. Cela correspond ni plus ni moins à la politique de « containment » qui sera menée durant la Guerre froide par les États-Unis contre l’URSS, mais nous verrons que celle-ci ne fut qu’un avatar d’un endiguement beaucoup plus ancien. Cette vision marquée par le sentiment d’insularité d’une puissance maritime excentrée, « en bordure » du centre du monde – Grande-Bretagne puis États-Unis – a également été influencée par les travaux de l’historien et stratège naval américain Alfred Mahan (1840-1914) qui explique la puissance britannique par sa suprématie maritime face à une Eurasie divisée. De fait, la politique étrangère britannique depuis le XVIIème siècle vise à prévenir et à lutter contre toute tentative d’unification continentale – Habsbourg, Napoléon, Allemagne hitlérienne. La crainte, reprise ensuite par les géopolitologues américains à une échelle plus vaste, sera d’assister à l’émergence d’une puissance continentale hégémonique contrôlant l’Eurasie, donc le monde… (sur toute cette question, l’on pourra se reporter aux écrits de Mackinder et Mahan ou à la bonne synthèse de Tanguy Struyedeswielande, Caucase et Asie centrale : la guerre pour le contrôle du Rimland, Réseau Multidisciplinaire d’Études Stratégiques, 2007).
Cette idée force, constante de la pensée géopolitique anglo-saxonne, se retrouve de nos jours chez Zbigniew Brzezinski, l’une des têtes pensantes de l’école américaine actuelle. Dans Le Grand échiquier, l’ancien conseiller à la sécurité du Président Carter adjure ses dirigeants : « Il est impératif qu’aucune puissance eurasienne concurrente capable de dominer l’Eurasie ne puisse émerger et ainsi contester l’Amérique ». Le message est clair : c’est sur le grand échiquier eurasiatique que se joue l’avenir du monde et les États-Unis se doivent de le contrôler afin de maintenir leur primauté globale. Diviser pour mieux régner, l’idée est vieille comme le monde mais très actuelle dans la politique des dirigeants américains vis-à-vis de l’Eurasie, nous le verrons. Les menées de Washington sous-tendues par cette conception géopolitique et, par contrecoup, les réactions de ses rivaux russe et plus récemment chinois expliquent pour bonne partie les événements que le monde a connus ces vingt dernières années. Derrière l’écume de l’actualité, la lutte qui sourd est celle-ci. Le Grand jeu conditionne tout, c’est l’armature du théâtre sur la scène duquel se jouent les événements quotidiens de l’actualité. Guerres du Golfe de 1991 et 2003, guerre de Tchétchénie, guerre du Kosovo de 1999, attentats du 11 septembre et intervention américaine en Afghanistan, guerre de Géorgie de 2008, isolation de l’Iran, « révolutions colorées » des années 2000, coupures de gaz répétées entre la Russie et l’Europe, mise en place de l’Organisation de Coopération de Shanghai, discours des néo-conservateurs américains sur la « nouvelle Europe », « guerre fraîche » entre Moscou et Washington, crise ukrainienne de 2014 etc. ; tous ces événements découlent du Grand jeu ou s’y rattachent d’une manière ou d’une autre.
En plus d’être le pivot du monde, le point névralgique du globe, l’Asie centrale est également terre de richesses, d’immenses richesses. Les soieries, le jade, les épices, les tapis persans ou le caviar ont été remplacés par les hydrocarbures, pétrole et gaz, principalement autour de la Caspienne ou au Xinjiang chinois, sans compter les immenses ressources russes un peu plus au nord. Certes, les premières estimations enthousiastes pour ne pas dire délirantes des années 90 concernant les réserves de la Caspienne ont été revues à la baisse, mais n’ont-elles pas à l’époque conditionné l’intérêt soudain des pétroliers occidentaux et des dirigeants américains pour cette région ? Si l’euphorie est quelque peu retombée, il n’en reste pas moins que l’Asie centrale au sens large – incluant l’Azerbaïdjan – est une région incontournable sur la carte énergétique planétaire, dotée d’un potentiel considérable tandis que les réserves moyen-orientales ou américaines s’épuisent (il convient ici de faire un sort à l’euphorie elle aussi délirante concernant le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis. Les estimations sont maintenant revues à la baisse dans des proportions parfois gigantesques. Ainsi, en juin 2014, l’Agence d’Information sur l’Énergie américaine a réduit de 96% (!) ses estimations de pétrole de schiste récupérables dans le bassin de Monterey, en Californie, qui devait représenter à l’origine les deux tiers des réserves de pétrole non conventionnel du pays. Par ailleurs, selon l’US Geological Survey et de nombreux scientifiques, la technique de fracturation hydraulique consubstantielle à l’exploitation des hydrocarbures de schiste est responsable de l’augmentation des tremblements de terre aux États-Unis, sans même parler de la dégradation de l’environnement. L’euphorie du schiste a vécu ; il n’y aura jamais d’abondance énergétique américaine comme on a pu le lire…). Les gisements géants de Shah Deniz en Azerbaïdjan, de Tengiz et de Kachagan au Kazakhstan – les deux plus gros gisements découverts dans le monde depuis quarante ans – ou les énormes réserves gazières du Turkménistan et de l’Ouzbékistan ont attiré les convoitises des majors et des dirigeants politiques des principales grandes puissances. Aussi important sinon plus que les ressources elles-mêmes, c’est leur acheminement par les gazoducs et oléoducs et le moyen d’influence qui en découle qui cristallise les tensions et les grandes manœuvres, ce que d’aucuns nomment la géopolitique des tubes. Complétant la pensée de Mackinder, un nouvel axiome est apparu : « Qui contrôle les sources et les routes d’approvisionnements énergétiques mondiales contrôle le monde. » C’est particulièrement vrai pour les États-Unis dont les stratèges, quelle que soit leur tendance politique, sont conscients de l’inévitable déclin américain : le monde est devenu trop vaste, trop riche, trop multipolaire pour que les États-Unis puissent le contrôler comme ils l’ont fait au XXème siècle. Du Projet pour un nouveau siècle américain des néo-conservateurs au Grand échiquier de Brzezinski, une même question prévaut en filigrane : comment enrayer ce déclin, comment le retarder afin de conserver aux États-Unis une certaine primauté dans la marche du monde ? La réponse, qui n’est certes pas ouvertement explicitée, passe par le contrôle de l’approvisionnement énergétique de leurs concurrents. « Contrôle les ressources de ton rival et tu contrôles ton rival », Sun Tzu n’aurait pas dit autre chose. Et c’est toute la politique étrangère américaine, et subséquemment russe et chinoise, de ces vingt dernières années qui nous apparaît sous un jour nouveau. La bataille pour les sources et les routes énergétiques combinée à la domination du Heartland et du Rimland, sont les éléments constitutifs de ce nouveau Grand jeu qui définira les rapports de force mondiaux pour les siècles à venir. Surnommée par certains « Pipelineistan » (terme inventé par le journaliste-reporter Pepe Escobar dont on peut lire les articles très documentés et caustiques sur le site www.atimes.com, uniquement disponible en anglais malheureusement), l’Asie centrale énergétique, pivot géographique et géopolitique du monde, peut légitimement être considérée comme l’une des zones les plus importantes de la planète.
L’aigle, l’ours et le dragon
Héritiers et imprégnés des théories géopolitiques britanniques sur le Heartland, les dirigeants américains ont toujours tenté de contenir la grande puissance continentale qu’est la Russie ou, sous son avatar communiste, l’Union soviétique. L’on peut d’ailleurs parfois se demander, au vu du rapprochement ultérieur avec la Chine maoïste et de la bienveillance à l’égard des Khmers rouges de Pol Pot [Voir les conversations de novembre-décembre 1975 entre Kissinger et les gouvernements thaïlandais et indonésien au cours desquelles le Secrétaire d’État demande notamment à ses homologues d’assurer les Khmers rouges de l’entier soutien des États-Unis. L’ennemi était alors le Vietnam pro-soviétique qui venait de gagner la guerre, et face à lui, les Américains étaient prêts à soutenir les maoïstes cambodgiens, malgré les massacres perpétrés par ceux-ci (mémorandums déclassifiés du Département d’État aux Affaires étrangères)], si la Guerre froide a consisté pour Washington en un véritable combat contre le communisme ou en une tentative toute empreinte de realpolitik de lutter contre le seul véritable concurrent stratégique qu’était la Russie, affrontement qu’avait du reste prévu Tocqueville. Toujours est-il que les États-Unis mirent en place un réseau d’alliances militaires tout le long du Rimland – OTAN (Europe et Turquie), Pacte de Bagdad ou CENTO (Moyen-Orient et Pakistan), OTASE (Asie du Sud-est) – pour enserrer et contenir l’URSS dans son Heartland. L’on imagine avec quel soulagement Washington accueillit la rupture sino-soviétique de 1960, mettant fin au bloc communiste qui allait de l’Europe au Pacifique. Mais l’événement crucial fut évidemment le démembrement de l’URSS en 1991. L’apparition de nouveaux États indépendants – trois dans le Caucase et surtout les cinq républiques d’Asie centrale – permettait de faire reculer le Heartland, désormais occupé par la seule Russie, dans des proportions énormes tandis que les dirigeants américains tentaient d’intégrer les nouveaux États dans le Rimland par le biais d’alliances militaires, diplomatiques ou énergétiques ou de tentatives de déstabilisation.
Le vide politique de la Russie dans les années 90, menée par un président ivrogne et faible – Boris Eltsine – dont avaient tout lieu de se réjouir les Occidentaux et particulièrement les Américains, l’anarchie intérieure et l’explosion de la criminalité, ainsi que l’effondrement économique et démographique empêchèrent Moscou de réagir. Toutefois, les États-Unis n’en profitèrent que partiellement ; l’administration Clinton (1992-2000) était en effet plus préoccupée de politique intérieure que de grande géopolitique, ce qui enrageait les secteurs néo-conservateurs pour qui les années 90 furent une « décennie perdue ». Certes, Washington avança ses pions sur l’échiquier du Grand jeu par une série d’empiètements : guerre du Kosovo et installation d’un avant-poste dans les Balkans, tentatives de détachement des ex-républiques soviétiques du « grand frère russe » voire même, ce que d’aucuns soupçonnent sans pourvoir fournir de preuves formelles, soutien à la rébellion tchétchène qui aurait été le premier pas à un démembrement, non plus de l’URSS, mais de la Russie elle-même ! La terrible répression de l’armée russe qui s’ensuivit visait d’ailleurs à faire un exemple et à tuer dans l’œuf toute velléité indépendantiste future dans ce pays constitué d’une mosaïque de peuples et de cultures différentes mue par des forces centrifuges. Sur le plan énergétique, les États-Unis ne furent pas en reste et l’on assista aux premiers captages de l’énergie centre-asiatique avec l’arrivée massive des majors américaines sur les champs pétrolifères du Kazakhstan ou de l’Azerbaïdjan et les projets de pipelines évitant soigneusement le territoire russe.
Toutefois, cette politique ne fut pas poussée à bout et laissa un goût d’inachevé pour les tenants de la ligne dure. L’aigle américain avait laissé passer sa chance de porter définitivement le coup de grâce à l’ours russe et l’occasion ne se représenterait plus… Lorsque les faucons de l’administration Bush arrivèrent au pouvoir en 2001 et voulurent rattraper le temps perdu, Vladimir Poutine était président de la Russie depuis quelques mois et avait entamé un programme de redressement général, tant sur le plan intérieur qu’extérieur. Les années 2000 seront marquées par leur affrontement, dur et subtil à la fois, incessant, de très haute volée sur le plan stratégique, l’une des plus belles passes d’armes géopolitiques de l’ère moderne. Certains journaux ont parlé de « nouvelle Guerre froide », et si le terme peut sembler quelque peu exagéré, la résurgence de la Russie poutinienne heurta effectivement de plein fouet les velléités de Washington.
L’idée centrale de toute la politique étrangère russe depuis Catherine II consiste à désenclaver le Heartland et à accéder aux mers chaudes. Il est particulièrement intéressant de noter qu’au cours de l’histoire, chaque poussée de la Russie vers le sud ou l’Extrême-Orient, c’est-à-dire chaque incursion dans le Rimland, rencontra sur son chemin une opposition anglo-saxonne décidée : guerre de Crimée (1853-1856) et défense de l’Empire ottoman, « l’homme malade » de l’Europe, qui faisait office de tampon ; premier Grand jeu au XIXème siècle et tentative britannique de contenir la marche russe vers l’Océan indien ; guerre russo-japonaise de (1904-1905) où l’Empire du Soleil levant, fortement poussé et soutenu par Londres, fit reculer la Russie tsariste du Rimland mandchou tandis qu’au même moment, l’expédition britannique à Lhassa refoula l’influence russe sur le Tibet et mit fin aux tentatives d’alliance russo-tibétaines, faits assez peu connus ; coup d’État américano-britannique contre Mossadegh en Iran pour éliminer la menace d’une possible alliance irano-russe et le percement du Rimland par Moscou (1953) ; guerre d’Afghanistan (1980-1988) et soutien américain aux moudjahidines et aux djihadistes islamistes par l’entremise de ses alliés pakistanais et saoudien, ce qui comme on le sait se retournera contre les États-Unis avec les attentats du 11 septembre.
La Russie a très mal accepté la perte de ses républiques d’Asie centrale qu’elle considère comme son pré carré, à l’instar de l’Afrique de l’ouest pour la France ou de l’Amérique latine pour les États-Unis. Après l’impuissance des années Eltsine, la politique de Poutine consistera à consolider le Heartland, à regagner le terrain perdu sur ses marges, voire à percer le Rimland par le biais d’alliances régionales mais surtout par la mise en place d’une politique énergético-stratégique dont les pipelines seront les fers de lance. Pour cela, il fallait tout d’abord remettre la main sur le secteur énergétique, bradé à tous les vents sous la présidence Eltsine et tombé aux mains d’oligarques peu scrupuleux. Ioukos et son président Mikhaïl Khodorkovski mettant en danger le projet de redressement voulu par le nouvel homme fort de la Russie – opposant déclaré, Khodorkovski était également sur le point de vendre Ioukos à l’américain Exxon -, la société sera divisée et vendue par morceaux, son président inculpé pour « escroquerie à grande échelle » et emprisonné. A son arrivée au pouvoir, Poutine avait averti les oligarques : « Vous pouvez garder vos millions, mais ne touchez pas à la politique et ne vous mettez pas en travers de la politique de redressement de la Russie ». Tandis que Ioukos était dépecée, le mastodonte Gazprom – première compagnie gazière mondiale, que beaucoup d’observateurs considèrent comme le bras armé du Kremlin – mit en pratique les directives de Poutine, parfois au détriment de ses propres intérêts économiques, nouant des alliances avec les satrapes locaux, prenant des participations dans les gisements des ex-républiques soviétiques et acheminant leurs hydrocarbures par des gazoducs russes. Depuis octobre 2012, le Pipelineistan a un nouveau maître : avec le rachat de TNK-BP pour plusieurs dizaines de milliards de dollars, la compagnie russe Rosneft, dont le principal actionnaire est l’État russe, est devenu la plus grande compagnie pétrolière du monde, avec une production de 4,5 millions de barils/jour. Ainsi, la Russie de Vladimir Ier, tsar de l’énergie, compte maintenant les leaders mondiaux du gaz (Gazprom) et du pétrole (Rosneft).
Le subtil pas de deux américano-russe et ses incidences persane, européenne, afghane ou caucasienne a récemment été bousculé par l’irruption d’un troisième acteur, compliquant quelque peu le scénario. Dans le film Syriana (2005), un jeune prince arabe réformiste retire l’exclusivité des droits de forage de gaz naturel à une compagnie texane pour les attribuer à une société chinoise, s’attirant ainsi la vindicte de la CIA qui finira par le faire assassiner. Au-delà de cette mise en scène de la collusion entre les maîtres de l’or noir et les pouvoirs politiques, le scénario illustre un phénomène majeur : l’irruption de la Chine sur l’échiquier énergétique international, introduisant une inconnue supplémentaire dans l’équation de la géopolitique eurasienne et déséquilibrant les courants d’échanges énergétiques. Le dragon s’est enfin réveillé : afin de nourrir sa folle croissance qui en fera bientôt la première puissance économique mondiale, l’ogre énergétique chinois cherche désespérément à mettre la main sur toutes les ressources énergétiques disponibles. Sa richesse en charbon ne suffit plus à alimenter ses besoins toujours croissants. Dans un pays où la légitimité du Parti Communiste au pouvoir depuis soixante-cinq ans devient chaque jour plus mince et repose sur sa capacité à maintenir une croissance économique forte tout en préservant autant que faire se peut l’harmonie sociale mise en avant par la propagande, l’exploitation du charbon n’est pas sans présenter de risques. Pas une semaine ne passe sans qu’un accident n’ait lieu dans une mine, faisant des dizaines de morts et provoquant colère ou ressentiment dans la population, tandis que la pollution invraisemblable qui touche maintenant les grandes villes chinoises, et dont une grande part provient de la surexploitation charbonnière, suscite également des critiques acerbes sur l’incapacité du gouvernement à juguler le phénomène. Ses propres ressources en hydrocarbures ne suffisant pas, Pékin s’est tourné vers l’étranger, dans une boulimie d’acquisition de gaz et de pétrole, et toute sa politique étrangère consiste à sécuriser son approvisionnement énergétique. Ainsi, l’axe nord-sud du traditionnel affrontement américano-russe se trouve maintenant coupé par la poussée occidentale de la Chine vers les richesses énergétiques d’Asie centrale et du Moyen-Orient.
Pipelineistan ou la guerre des tubes
Dans ce contexte, les pipelines jouent évidemment un rôle majeur, leur tracé étant la matérialisation sur le terrain des objectifs stratégiques de leur promoteur. Les tubes russes sont autant de flèches visant à percer le Rimland afin de gagner les marchés de consommation européen ou asiatique, ceux promus par Washington courent le long de ce même Rimland et tentent d’isoler la Russie, tandis que l’irruption chinoise vient troubler la scène. L’équation est encore compliquée du fait de l’émergence d’autres acteurs qui ont également leur mot à dire : Inde, Pakistan, Iran, Japon. Au centre de l’échiquier, les pays producteurs ou de transit jouent un jeu parfois double mais toujours difficile.
Lors des coupures de gaz entre la Russie et l’Ukraine ou des discussions sur le tracé d’un pipeline approvisionnant l’Europe, l’homme de la rue se demandait parfois quel pouvait bien être l’intérêt des États-Unis dans cette histoire et pourquoi ils s’intéressaient autant à la route qu’empruntaient des tubes à 15 000 kilomètres de chez eux. La réponse est qu’il s’agit bien évidemment d’une pièce maîtresse du Grand jeu. Dans un contexte de perte relative de puissance à l’échelle mondiale, l’arme énergétique est une carte maîtresse ; en contrôlant les routes des hydrocarbures, Washington garde un certain levier de pression sur ses concurrents et évite d’être marginalisé. Pour les dirigeants américains, le tracé des pipelines en Asie doit nécessairement suivre celui du Rimland sur un axe est-ouest, encerclant la Russie et désenclavant les pays de l’Asie centrale ou du Caucase. Mais la situation est complexe : au sud de cette ceinture se trouvent des pays avec lesquels les États-Unis sont en conflit ouvert ou couvert – Iran, Irak, Syrie. Le numéro d’équilibriste consiste donc à construire des pipelines dans l’étroite bande séparant ces deux zones, parfois sans considération pour les difficultés économiques ou techniques.
À l’ouest, le Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) fut l’une des plus grandes victoires de la diplomatie énergétique de Washington. Ouvert en 2005, il transporte le pétrole caspien de l’Azerbaïdjan à travers la Géorgie et la Turquie, évitant soigneusement le territoire arménien, allié de Moscou. Toutefois, la guerre de Géorgie de 2008, au cours de laquelle la Russie prit rapidement le dessus sur l’armée géorgienne et effectua des bombardements à quelques hectomètres de l’oléoduc tout en se gardant bien de le détruire, montra la vulnérabilité du BTC. Est-ce le facteur qui coupa l’herbe sous le pied de Nabucco ? Présenté comme le projet des Européens pour assurer leur indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie mais, curieusement beaucoup plus appuyé par les Américains que par ces mêmes Européens, le gazoduc Nabucco devait en effet suivre le même tracé que le BTC, partant de l’Azerbaïdjan et traversant la Géorgie avant de bifurquer vers l’Europe. Bakou n’ayant pas assez de gaz pour le remplir, il était également question d’y ajouter du gaz en provenance du Turkménistan, que l’on aurait fait transiter par un pipeline sous la Caspienne. La réaction de Moscou fut immédiate et multiforme : accélération du projet South Stream, reliant l’Europe par la Mer noire ; manœuvres diplomatiques visant à « dissuader » le Turkménistan de se joindre au projet ; achat par Gazprom d’énormes quantités de gaz turkmène et azéri afin de vider dans l’œuf toute possibilité de remplir Nabucco ; refus de permettre la construction d’un pipeline sous-marin, qui requiert l’approbation de tous les pays riverains de la Caspienne dont le statut juridique reste flou. On le voit, la partie sur l’échiquier du Grand jeu peut prendre de nombreuses formes. L’ours russe a gardé de sa force de persuasion et il semblerait que les Américains aient plus ou moins jeté l’éponge. Le chantage turc à peine voilé qui utilisait le passage du gazoduc par son territoire pour avancer ses pions dans le dossier de son adhésion à l’Union Européenne ne favorise pas non plus l’aboutissement du projet. Nabucco, qui de plus pâtit de son coût trop élevé, reste une coquille vide et semble avoir dit son dernier mot… Quant à la Russie, elle était, jusqu’au conflit ukrainien actuel, en passe de réussir son pari, malgré les multiples velléités américaines – lobbying en faveur des pipelines non russes (Nabucco, BTC), tentatives de sabotage de tout rapprochement européo-russe et discours sur la « nouvelle Europe », « retournement » de l’Ukraine en 2004 et soutien indéfectible à la politique anti-russe de l’ancien président Yushenko, campagne d’une certaine presse contre la Russie poutinienne etc. Le gazoduc Nord Stream est entré en service en 2011 et rejoint directement l’Europe occidentale en contournant le glacis de « l’Europe nouvelle » mis en place par Washington qui, par le biais de ses alliés ukrainiens ou polonais, pouvait jusque là couper le robinet à tout moment, comme cela fut le cas à plusieurs reprises lors des conflits gaziers entre l’Ukraine et la Russie dans les années 2000. La construction de son pendant au sud, le South Stream, allait débuter lorsqu’éclata la crise ukrainienne, gelant le projet. Nous y reviendrons en fin d’article.
En Asie centrale proprement dite, la Russie semble également en position de force. Certes, les compagnies occidentales ont la part belle dans les consortiums exploitant les gisements géants kazakhstanais de Tengiz (pétrole et gaz, à forte majorité américain) et de Kachagan (pétrole, mis en route cette année et qui devrait rapidement devenir le troisième gisement du monde), mais Moscou garde la haute main sur leurs routes d’évacuation. Si rien n’a encore été décidé pour Kachagan, les pipelines de Rosneft font figure de favoris pour le transit de ses hydrocarbures. Quant au pétrole de Tengiz, il s’engouffre déjà dans les oléoducs russes à destination de Novorossiysk et les tentatives américaines de le faire transiter par le BTC ont peu de chance d’aboutir. Il existe une troisième route, plus économique, préconisée par le français Total : un oléoduc à travers l’Iran. Cette solution de bon sens a évidemment subi le véto de Washington qui tente d’isoler l’Iran depuis la Révolution de 1979. Et l’on touche là du doigt le véritable casse-tête des stratèges américains : comment désenclaver l’Asie centrale et la faire sortir de l’orbite russe tout en évitant les territoires de leurs ennemis dans « l’arc de crise » allant du Moyen-Orient au Pakistan ?
La première tentative fut aussi l’une des plus curieuses. A la fin des années 90, la société américaine Unocal, avec le plein assentiment de Washington, entreprit des négociations avec le régime des Talibans afin de faire passer un pipeline par l’Afghanistan. Les discussions étaient relativement avancées et une délégation talibane vint même rencontrer les dirigeants d’Unocal au siège texan de la société en décembre 1997. Pour l’administration Clinton, la principale préoccupation était la fin de la guerre civile afghane et l’émergence d’un pouvoir stable, relativement favorable aux intérêts stratégiques et économiques américains, c’est-à-dire permettant d’accéder aux richesses énergétiques de l’Asie centrale. C’est ce qui fit dire à l’époque à un diplomate américain : « Les Talibans vont probablement se développer comme les Saoudiens. Il y aura Aramco [la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, NDLR], des pipelines, un émir, pas de parlement et la sharia… On peut s’en arranger » (Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, Yale University Press, 2000). Ce n’est pas pour des raisons humanitaires mais devant l’incapacité des Talibans à vaincre l’Alliance du nord du commandant Massoud et à mettre fin à l’instabilité du pays que les États-Unis commencèrent à prendre leurs distances avec le régime des « étudiants de Dieu ». Ces derniers, de plus en plus influencés par Ben Laden qu’ils avaient accueilli en 1996, faisaient également preuve d’un anti-américanisme grandissant. Washington arriva finalement à la conclusion que le régime taliban était incapable de stabiliser l’Afghanistan et de permettre ainsi la pénétration américaine en Asie centrale, et des échos selon lesquels les États-Unis commençaient à planifier l’invasion de l’Afghanistan virent le jour dès la fin de l’année 2000 dans la presse américaine (comme le Washington Post ou l’influent magazine de défense et de stratégie Jane’s Weekly.). L’administration Bush fit toutefois une dernière tentative en juillet 2001 – deux mois avant les attentats du 11 septembre ! -, dans une réunion au cours de laquelle les officiels américains demandèrent aux Talibans de constituer un gouvernement d’unité nationale incluant toutes les factions afin de mettre fin à la guerre civile. Selon certaines sources, un représentant américain déclara textuellement : « Soit vous acceptez notre offre et nous vous couvrirons d’un tapis d’or, soit vous refusez et nous vous couvrirons d’un tapis de bombes. » Les Talibans, peu disposés à partager le pouvoir, refusèrent… Deux mois plus tard, les tours du World Trade Center s’effondraient et l’armée américaine intervenait en Afghanistan, ce qui fit dire aux théoriciens du complot que les attentats du 11 septembre n’étaient qu’un écran de fumée. La coïncidence est certes troublante, mais il semble que les États-Unis seraient de toute façon intervenus en Afghanistan, indépendamment des événements du 11 septembre. Le hasard faisant bien les choses, le président Hamid Karzaï et l’ambassadeur des États-Unis en Afghanistan Zalmay Khalilzad avaient tous deux été consultants de la firme Unocal lors des négociations avec les Talibans. Treize ans après, le premier est toujours considéré par une grande partie de la population afghane comme une marionnette américaine, n’ayant pu se maintenir au pouvoir que grâce à une fraude massive durant les élections de 2009 et à un système de corruption généralisée des leaders locaux ou tribaux influents qu’il arrosait avec les dizaines de millions de dollars que lui a versés la CIA pendant plus d’une décennie (With bags of cash CIA seeks influence in Afghanistan, New York Times, 29 avril 2013). Le second avait été un proche collaborateur de Brzezinski, l’auteur du Grand échiquier, à l’université de Columbia puis membre du think tank néo-conservateur Projet pour un nouveau siècle américain qui vise ni plus ni moins à la primauté mondiale des États-Unis. Toutefois, en treize ans de présence, l’armée américaine elle-même s’est révélée totalement incapable de stabiliser l’Afghanistan et les projets de gazoducs sans cesse remis au lendemain, tandis que Gazprom captait toujours plus les richesses énergétiques du bassin de la Caspienne. L’idée ne fut néanmoins pas perdue, comme nous allons le voir…
Malgré leurs échecs répétés pour isoler la Russie et en dépit de l’enlisement afghan, les États-Unis n’en gardent pas moins une certaine influence – certains parlent de capacité de nuisance. Ainsi ont-ils réussi à faire définitivement échouer, semble-t-il, un vieux projet de pipeline entre l’Iran, le Pakistan et l’Inde. Ce gazoduc, appelé Peace Pipeline ou IPI (pour Iran-Pakistan-Inde), devait fournir le gaz dont l’Iran regorge au Pakistan et à l’Inde, dont les besoins énergétiques s’accroissent de manière exponentielle au fur et à mesure de leur développement économique. L’idée tombait sous le sens : trois voisins, dont l’un très riche en énergie et les deux autres forts demandeurs, un tracé relativement simple, sans difficulté technique majeure et qui aurait permis de resserrer les liens de ces trois États aux relations compliquées. C’était sans compter sur Washington et sa volonté de diviser l’Eurasie et d’isoler l’Iran. Après des années de harcèlement, les Américains ont réussi à détacher l’Inde du projet en 2009 avec, à la clé, un accord sur le nucléaire civil. Notons toutefois que New Delhi fait souffler le chaud et le froid, des rumeurs faisant état d’un intérêt toujours persistant pour l’IPI voire pour un pipeline sous-marin Iran-Inde, l’intégration de l’Inde au sein des BRICS et de l’Organisation de Coopération de Shanghai n’y étant peut-être pas pour rien. Le Pakistan, pressé par Washington d’abandonner le projet, persiste dans sa volonté de mener à bien le projet. En lieu et place du Peace Pipeline, les États-Unis proposent un autre pipeline, le TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde), qui n’est ni plus ni moins qu’une reprise du projet Unocal.

En lieu et place du Peace Pipeline, les États-Unis proposent un autre pipeline, le TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde), qui n’est ni plus ni moins qu’une reprise du projet Unocal.
Sur le plan technique et politique, ce projet est extrêmement compliqué, irréaliste selon certains. Le gazoduc part du Turkménistan où le président-satrape Gurbanguly Berdimuhamedow, gagnant les élections avec des scores soviétiques, a mis en place un véritable culte de la personnalité et semble prendre ses décisions selon l’humeur du moment, témoin ses nombreux retournements, notamment dans le dossier Nabucco. Le TAPI doit ensuite traverser l’Afghanistan et notamment les zones pachtounes en conflit, se frayant un chemin à travers les millions de mines laissées par la guerre de 1980-1989, pour arriver à Quetta, la ville du mollah Omar et de milliers de Talibans réfugiés au Pakistan. Que les États-Unis parviennent à « convaincre » leurs partenaires d’un projet aussi saugrenu selon le mot de certains spécialistes montre le degré d’influence que Washington conserve dans la région. Surtout, l’on constate que, dans ce Grand jeu de poker menteur planétaire, le facteur stratégique prime sur toute autre considération, qu’elle soit économique ou technique. Mais un jeu, aussi important soit-il, reste divertissant et le dernier rebondissement en date prête à sourire : dès l’accord pour le TAPI conclu en 2012, Vladimir Poutine effectua une visite diplomatique en Afghanistan et au Turkménistan et, sur la demande de ces pays, la Russie s’est invitée dans la partie, par le biais de Gazprom ! Après des années d’efforts pour isoler l’Iran, voilà l’ours russe qui frappe à la porte. Les stratèges américains n’avaient sans doute pas prévu cela…
Tout comme ils n’avaient peut-être pas prévu l’inarrêtable expansion économique de la Chine, l’explosion de ses besoins énergétiques et son irruption dans le Grand jeu. Les regards de Pékin se sont tournés dès les années 90 vers sa région autonome du Xinjiang ou Turkestan chinois, riche en hydrocarbures et peuplé de Ouïghours, turcophones musulmans chez qui l’indépendance nouvelle de leurs cousins des ex-républiques soviétiques avait fait naître des espoirs de liberté et nourri le séparatisme. Cette tendance allait évidemment à l’encontre de l’intérêt accru de Pékin pour sa province occidentale et, à l’instar du Tibet, c’est avec une main de fer que les dirigeants chinois réprimèrent toute menée autonomiste tandis que la colonisation han – l’ethnie majoritaire – s’intensifia. Au-delà de la simple volonté de maintenir son intégrité territoriale, la région du Xinjiang est en effet hautement stratégique pour la Chine. Riche en hydrocarbures et en énergies renouvelables – les forages pétroliers se multiplient dans le désert du Taklamakan tandis que d’immenses parcs d’éoliennes ont vu le jour -, en uranium et en terres rares, le Xinjiang a surtout une immense valeur géostratégique : possédant une frontière commune avec huit États, il se trouve au carrefour des routes énergétiques. La majorité de ses approvisionnements provenant d’un Moyen-Orient de plus en plus instable, Pékin a porté son regard sur l’Asie centrale voisine. Une nouvelle Route de la soie sentant fortement le gaz et le pétrole a vu le jour. Un premier oléoduc entre le Kazakhstan et la Chine a été ouvert en 2007. Le gazoduc Trans-Asia ou Turkménistan-Ouzbékistan-Kazakhstan-Chine suivit deux ans plus tard, couvrant environ la moitié des besoins gaziers du dragon avec l’excédent du gaz turkmène que Gazprom ne pouvait acheminer. Dans ces conditions, il ne reste d’ailleurs pas grand-chose pour remplir Nabucco et il semble bien que le projet américano-européen restera à jamais dans les cartons. Récemment, un accord a été signé dans le cadre de l’Organisation de Coopération de Shanghai pour la construction d’un gazoduc Turkménistan-Tadjikistan-Chine qui devrait entrer en service d’ici 2016 et d’ailleurs poser problème pour l’approvisionnement du projet américain TAPI. Par ailleurs, la Chine investit massivement dans les infrastructures énergétiques de ses voisins d’Asie centrale et prend des participations dans leurs gisements par le biais de ses nouveaux géants Sinopec ou PetroChina – respectivement cinquième et sixième entreprises pétrolières mondiales. Cette pénétration chinoise vers le cœur eurasiatique a pris de court Washington comme Moscou. L’influence des États-Unis diminue à mesure que le Grand jeu s’enfonce dans l’intérieur des terres et, malgré une base aérienne au Kirghizstan qui a de toute façon fermé en juin 2014, ils n’ont aucun levier de pression dans la zone steppique qui s’étend de la Mandchourie au Kazakhstan. Quant à la Russie, après quelques hésitations dans les années 2000, elle a finalement accepté bon gré mal gré l’intrusion chinoise qui remet en cause son quasi monopole. Comme il se murmure à Moscou, « du moment que les hydrocarbures ne partent pas du côté américain… » Moscou et Pékin ont des intérêts économiques et stratégiques communs, notamment celui de voir partir les Américains d’Asie centrale, et appartiennent tous deux à l’Organisation de Coopération de Shanghai comme nous le verrons. La crise ukrainienne a encore rapproché leurs positions. Fini le temps où le Kremlin n’hésitait pas à faire des ouvertures au Japon, pour la plus grande fureur de Pékin et laissait traîner les discussions sur les immenses ressources sous-exploitées de la Sibérie orientale et leur acheminement vers la Chine. En mai, après dix ans de négociations, Pékin et Moscou ont signé le « contrat du siècle », la Russie fournissant son gaz sibérien pour la somme astronomique de 400 milliards de dollars. Cet accord est le pendant gazier d’un autre méga-contrat, pétrolier celui-là, signé entre Rosneft et le chinois CNPC en juin 2013 et portant sur la somme record de 270 milliards de dollars. Désormais, la subtile et traditionnelle méfiance entre les deux géants eurasiatiques a laissé place à une réelle convergence, ressemblant parfois à une osmose. Nous y reviendrons dans le dernier chapitre traitant des conséquences du conflit ukrainien et de l’accélération de l’intégration eurasienne.
Quand le Grand jeu descend vers le sud…
L’appétit chinois ne s’arrête cependant pas là et c’est avec horreur que les États-Unis ont vu Pékin passer des accords énergétiques avec l’Iran, nonobstant l’embargo mis en place pour isoler Téhéran et les menaces américaines aux pays qui l’enfreindraient. En octobre 2004, un véritable coup de tonnerre fit trembler la scène du Pipelineistan lorsque l’on apprit la signature d’un énorme contrat de 100 milliards de dollars pour la livraison de 250 millions de m³ de gaz durant 25 ans. Le chiffre donna alors le vertige à plus d’un, même s’il a depuis été dépassé par les méga-contrats russes… D’autres accords suivirent, ainsi qu’un rapprochement stratégique. En 2005, l’Iran fit son entrée dans l’Organisation de Coopération de Shanghai en tant que membre observateur, en compagnie de l’Inde et du Pakistan, et en deviendra très bientôt membre de plein droit. Il fut même question, en 2008, d’implanter une base navale chinoise sur le territoire iranien mais le projet n’eut pas de suite. Ce n’est peut-être que partie remise, Pékin ayant acquis une base navale à Gwadar, chez son allié pakistanais. Située face au détroit d’Ormuz, la porte du Golfe persique d’où provient la majeure partie de ses importations pétrolières, mais également à quelques kilomètres de la frontière iranienne et peut-être un jour au débouché des pipelines de l’Asie centrale, Gwadar est l’un des emplacements les plus stratégiques du monde, au carrefour de trois aires fondamentales pour le contrôle du Heartland – l’Asie centrale, le Moyen-Orient et le sous-continent indien – et des routes de l’énergie.
La base de Gwadar fait partie du fameux « collier de perles » mis en place par Pékin : un chapelet de ports commerciaux ou de bases navales dans l’Océan indien, destinés à ponctuer et sécuriser les grandes lignes maritimes de son approvisionnement en hydrocarbures ainsi qu’à encercler son grand rival indien.
La volonté de la marine pakistanaise est de faire de Gwadar une base navale conjointe pakistano-chinoise, même si les dirigeants chinois semblent pour l’instant quelque peu réticents à militariser le port. Il semble toutefois que les choses s’accélèrent et 2013 aura été une année pleine. L’Iran a en effet annoncé la construction d’une base navale à Pasabandar, près de la frontière avec le Pakistan, à une trentaine de kilomètres seulement de Gwadar. De plus, Téhéran vient de signer un accord avec le Pakistan pour la mise en place d’une raffinerie de pétrole d’une capacité de 400 000 barils par jour, à Gwadar même. Dans le même temps, le projet de gazoduc Iran-Pakistan, si souvent enterré et si souvent remis sur la table, semble être définitivement lancé, malgré les pressions de Washington. L’Inde hors-jeu sous pression américaine, c’est tout naturellement la Chine qui l’a remplacée et l’on parle même – mais à quel prix ! – d’un pipeline qui relierait Gwadar au Xinjiang chinois à travers tout le territoire pakistanais, le Karakoram et le Pamir, ce qui permettrait d’écourter sensiblement les distances et d’éviter le long transport maritime par les détroits du sud-est asiatique. Nous n’en sommes pas encore là, mais l’idée d’une double base navale pakistano-chinoise et iranienne, en face du détroit le plus important de la planète – Ormuz – où transite le tiers du trafic pétrolier mondial, protégeant un hub énergétique relié par pipeline aux gisements iraniens et à la Chine, a de quoi empêcher de dormir quelques stratèges à Washington. Les grandes manœuvres qui ont lieu actuellement dans cette zone ne font pas la une des journaux ; elles sont pourtant d’une importance extrême pour l’avenir du Grand jeu et donc du monde…

La volonté de la marine pakistanaise est de faire de Gwadar une base navale conjointe pakistano-chinoise, même si les dirigeants chinois semblent pour l’instant quelque peu réticents à militariser le port.
On le voit, l’Inde semble quelque peu isolée. Cet autre géant asiatique, futur grand de la scène mondiale, a également un besoin croissant d’énergie mais son rapprochement à la fin des années 2000 avec Washington semble lui avoir fait perdre une certaine marge de manœuvre et réduit son influence, même si l’élection de Narendra Modi cette année semble changer la donne, nous le verrons. Enlisée depuis soixante ans dans son conflit avec le frère ennemi pakistanais à propos du Cachemire – autre zone à haut risque de l’Asie centrale, où trois puissances nucléaires se font face sur les cimes de l’Himalaya et du Karakoram -, également en conflit territorial avec la Chine dans la même région, subtilement encerclée par le collier de perles et en perte de vitesse vis-à-vis de l’Iran, l’Inde cherche des alliances de revers. Afin de prendre en tenaille l’adversaire pakistanais, l’Inde a toujours tenté d’établir de bons rapports avec l’Afghanistan. À l’inverse, le Pakistan a toujours considéré comme vital pour la sécurité du pays un régime afghan favorable à ses intérêts. L’Afghanistan constitue une zone de repli lui offrant la profondeur stratégique qui lui fait défaut en cas de guerre avec l’Inde. Mais il existe une autre raison à cet intérêt d’Islamabad pour son voisin afghan, qui tient à l’intégrité même du territoire pakistanais. Les turbulentes tribus pachtounes, séparées artificiellement depuis 1893 par la ligne Durand, démarcation entre l’Afghanistan et l’Empire britannique des Indes, se retrouvent de part et d’autre d’une frontière qu’elles ne reconnaissent pas. Le paradoxe est d’ailleurs parlant : un tiers des Pachtounes se retrouve du côté afghan où ils représentent la moitié de la population tandis que les deux tiers sont au Pakistan où ils représentent une minorité (15%) de la population. Dès la fin du XIXème, une insurrection éclate afin de regrouper les tribus des deux entités. Créé avec l’Inde en 1947 sur les décombres de l’empire britannique, le Pakistan héritera de ce conflit et du danger lancinant de voir se constituer un « Pachtounistan » qui l’amputerait d’une partie de son territoire. La politique pakistanaise, dans un réflexe presque existentiel, a ainsi toujours consisté à s’immiscer dans les affaires afghanes et à installer à Kaboul un régime favorable à ses intérêts. Pendant des décennies, Islamabad et New Delhi s’y sont affrontés par procuration, le Pakistan combattant les régimes favorables à l’Inde – gouvernement pro-soviétique de 1980 à 1989, Alliance du nord, gouvernement Karzaï – et l’Inde s’opposant aux régimes favorables au Pakistan, notamment les Talibans. Ces derniers, créés par l’ISI (le très influent service secret pakistanais), ont un temps suscité l’espoir des États-Unis comme nous l’avons vu. Le 11 septembre renversa totalement la donne et Islamabad fut prise à son propre piège ; après avoir instrumentalisé les islamistes pendant des années, tant en Afghanistan qu’au Cachemire, le Pakistan était maintenant contraint, sous la pression internationale, particulièrement américaine, de se retourner contre ceux-là même qui représentaient son meilleur atout stratégique contre l’Inde. Une véritable quadrature du cercle… La guerre contre les « militants », commencée en 2004, a fait à ce jour près de 50 000 morts et l’armée pakistanaise ne peut pas la gagner. Pour les raisons évoquées plus haut, l’action d’Islamabad contre les divers groupes islamistes n’a jamais été claire, achetant la paix par-ci, lançant des offensives par-là, attaquant tel groupe (Al Qaeda et ses affiliés) mais pas tel autre (les Talibans pakistanais). Tandis que l’Inde avance ses pions en Afghanistan et gagne spectaculairement en influence – versement de deux milliards de dollars d’aide à la reconstruction, signature d’un Pacte stratégique commercial et sécuritaire en 2011, coopération en matière de sécurité et de terrorisme, accusations communes contre Islamabad -, le sommet de l’État pakistanais tergiverse, englué dans ses contradictions, tiraillé entre une sympathie naturelle envers les groupes islamistes et la nécessité de les combattre. Le Pakistan – certains se demandent d’ailleurs qui dirige vraiment le pays : l’ISI, l’armée, le pouvoir civil ? – est depuis des années accusées de pratiquer un double-jeu, comme l’a encore démontré le cas Ben Laden, le terroriste le plus recherché du monde ayant tranquillement passé ses dernières années à Abbottabad, ville des plus hautes instances militaires du pays. Ne sentant pas de direction claire, l’armée pakistanaise est démoralisée face à des mouvements islamistes bien armés et très motivés. Réfugiés avec leurs alliés d’Al Qaeda dans les zones tribales à la frontière pakistano-afghane, les Talibans ont étendu leur influence et peu à peu infiltré des lieux jusque-là épargnés par le phénomène, comme la première ville du pays, Karachi, ou les vallées de la Swat et de Dir dans le nord montagneux, autrefois lieux de villégiature privilégiés. On peut d’ailleurs se demander si le projet de pipeline reliant Gwadar à la Chine et devant passer par ces régions pourra réellement se réaliser.
Comme si cela ne suffisait pas, le Pakistan fait face à une insurrection nationaliste dans la rétive province du Baloutchistan, au sud du pays, où les tribus cherchent à obtenir leur indépendance. C’est un conflit peu connu du grand public occidental – sans doute parce que les insurgés sont d’obédience marxiste et non islamiste – mais qui peut se révéler pour le Pakistan au moins aussi dangereux que les troubles des zones tribales. Fait très important, c’est dans cette province que se trouve Gwadar, et plusieurs expatriés chinois y ont trouvé la mort au cours de ces dernières années, tués par des bombes ou le mitraillage de leur bus. Cela explique peut-être la légère réticence de Pékin à s’engager de plein pied dans le projet. Comme de bien entendu, le Pakistan accuse l’Inde de financer et d’aider le mouvement indépendantiste baloutche – où l’on retrouve le jeu des grandes puissances – ce qui semble effectivement le cas… New Delhi a en effet tout intérêt à ce que la situation au Baloutchistan s’envenime, faisant ainsi d’une pierre deux coups : empêcher la Chine de s’implanter dans cette zone stratégique tout en déstabilisant le Pakistan déjà englué dans les zones tribales et au Cachemire.
Des bases, des alliances et des révolutions
Les alliances de revers mises en place par l’Inde pour encercler le Pakistan ne s’arrêtent pas là et New Delhi réalisa un très joli « coup » en installant une base militaire au Tadjikistan, à Farkhor, au début des années 2000, au nez et à la barbe des Chinois et des Américains. Juché sur le Pamir, dominant à la fois le Xinjiang chinois, l’Ouzbékistan, l’Afghanistan et le Cachemire, le Tadjikistan offre à New Delhi une place de choix à la croisée des chemins et à proximité des nouvelles routes énergétiques prévues. L’emplacement est capital, permettant de sécuriser le futur TAPI ou de menacer l’éventuel pipeline pakistano-chinois Gwadar-Xinjiang. Le rapprochement indo-tadjik permet en outre de couper l’axe Pékin-Islamabad.
La Chine, qui reste le grand rival stratégique de l’Inde en Asie, a vu d’un très mauvais œil l’ouverture de cette base aérienne dans son étranger proche. Les dirigeants chinois ont à leur tour entamé des discussions avec le Kirghizistan et l’Ouzbékistan sur l’établissement d’une base militaire chinoise, mais sans résultat jusqu’à présent. Quant à la Russie, traditionnelle alliée de l’Inde durant la Guerre froide face à l’axe américano-pakistano-chinois et qui a elle-même conservé trois garnisons au Tadjikistan, elle a accueilli sans difficulté l’installation des soldats et des avions chasseurs indiens à Farkhor. À noter d’ailleurs que cette offensive de l’Inde en Asie centrale s’accompagne d’un soft power propre à gagner les cœurs : New Delhi bâtit des hôpitaux, une université indienne à Bichkek au Kirghizstan est en projet, les liens historiques qui unissaient ces deux régions – Ghaznévides, Moghols, Sultanat de Delhi – sont remis au goût du jour tandis que le cinéma bollywoodien fait son entrée dans les petites lucarnes ouzbèkes ou kazakhes.
La présence étrangère en Asie centrale, sous forme de bases militaires, est un facteur déterminant du Grand jeu. Les grandes puissances avancent leurs pions mais la partie est compliquée, du fait du nombre de joueurs – au moins quatre : Russie, États-Unis, Chine et Inde – et des règles – susceptibilité des dirigeants centre-asiatiques, retournements de situation, organisations régionales – qui viennent compliquer la donne. Nous venons de voir que l’Inde a installé sa seule base militaire à l’étranger à un carrefour stratégique et que la Chine n’a pas fait de grandes avancées jusqu’ici, mis à part le port de Gwadar susceptible d’être transformé en base navale. Restent la Russie et les États-Unis. Pour ces derniers, l’événement décisif fut bien évidemment la guerre en Afghanistan, débutée en 2001 après les attentats du 11 septembre et leur permettant enfin de mettre un pied en Asie centrale, au cœur du Heartland. Pour ravitailler les troupes de l’OTAN, Washington obtint l’ouverture de deux bases, l’une en Ouzbékistan, l’autre au Kirghizstan, avec l’accord tacite de Moscou pour cette intrusion dans son étranger proche. Toutefois, cette bonne volonté russe se transformera en gêne puis en colère lorsque, loin de remercier le Kremlin par une non-ingérence dans son pré carré, les États-Unis soutiendront les révolutions de couleurs et continueront leur politique d’isolement de la Russie. A titre personnel, Poutine fulminera contre les menées américaines qu’il considèrera comme une véritable trahison. A Washington, toutefois, l’euphorie céda la place à une certaine désillusion devant l’enlisement afghan et l’impossibilité de venir à bout des Talibans. Ce n’est pas pour rien que l’Afghanistan avait été le tombeau des ambitions britanniques ou russes par le passé, l’un de ces rares pays « impossibles à conquérir », à l’instar du Vietnam. De même, les États-Unis se rendirent compte du byzantinisme de la région et de la nécessité d’enlever ses « gros sabots » en y entrant. En 2005, devant la répression des émeutes d’Andijan en Ouzbékistan, l’administration Bush critiqua vertement le président Islam Karimov. Les faucons néo-conservateurs auraient sans doute été bien inspirés de prendre exemple sur Poutine, son habile diplomatie ménageant les susceptibilités et sa capacité de manœuvre hors pair. Toujours est-il que la réponse ne se fit pas attendre : les Américains étaient invités à quitter leur base de Karshi Khanabad dans les plus brefs délais ! Ils ne conservèrent plus que la base de Manas au Kirghizstan avant de l’évacuer l y a quelques mois, les autorités kirghizes refusant de renouveler le bail. Ainsi, à moins d’un nouveau retournement de situation qui n’est pas impossible dans cette région si prompte aux intrigues byzantines, le but des stratèges américains de s’implanter durablement en Asie centrale a largement échoué et l’ours russe peut dormir sur ses deux oreilles.
Héritière de l’URSS, ayant conservé des liens privilégiés avec les satrapes centre-asiatiques formés à l’époque soviétique, la Russie garde une influence certaine dans les ex-républiques d’Asie centrale. Ces dernières n’ont d’ailleurs jamais vraiment revendiqué leur indépendance à la chute de l’URSS, contrairement aux ex-républiques baltes ou caucasiennes qui voulaient se défaire de la tutelle de Moscou. Les bonnes relations sont entretenues par les fréquentes visites diplomatiques de Vladimir Poutine dans la région, où Gazprom est reçu avec le tapis rouge. De plus, le Kremlin joue de la dépendance de ces républiques à son égard. Plus du tiers du revenu du Tadjikistan dépend des transferts de ses émigrés travaillant en Russie. Quant à la dette kirghize, elle a récemment été annulée en contrepartie de la fermeture de la base américaine de Manas. En 2012, un accord a été signé avec le Tadjikistan pour maintenir jusqu’en 2042 les trois bases militaires russes dans ce pays. En outre, Moscou a signé en 2010 des accords avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, territoires auto-proclamés indépendants suite à la guerre de Géorgie de 2008, sur l’établissement de bases militaires jusqu’en 2059. Dans une autre zone sensible de l’étranger proche, la Mer Noire, la Russie avait assuré sa présence militaire jusqu’au milieu du XXIème siècle, avec la signature d’un accord avec l’Ukraine qui prévoyait le maintien jusqu’en 2042 de la flotte russe de Sébastopol. C’était avant la crise ukrainienne de cette année dont l’une des conséquences a été le rattachement de la Crimée à la Russie, Sébastopol étant maintenant définitivement russe. Mais revenons un peu sur l’Ukraine des années 2000. Cet accord n’avait été possible qu’après la victoire électorale en 2010 de Victor Ianoukovitch, présenté comme favorable à Moscou, contre son opposant Victor Ioutchenko, arrivé au pouvoir grâce à la Révolution orange de 2004, fortement soutenue et financée par l’administration Bush mais aussi par les fonds du milliardaire Georges Soros afin de mettre en place un régime ami en Ukraine (on se souvient de l’aveu de Victoria Nuland, célèbre par ailleurs pour son insulte des Européens (« Fuck the E.U »), qui admettait que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars depuis 2001 pour installer un régime « ami » à Kiev, c’est-à-dire détacher par tous les moyens l’Ukraine de la Russie). Pays crucial dans le Grand jeu, véritable nœud sur l’échiquier eurasien, point de passage de la moitié des exportations de pétrole russe et principale ouverture de la Russie sur la Mer noire, l’Ukraine devait jouer un rôle central dans l’isolement de la Russie préconisé par les stratèges de Washington. Comme le claironnait Brzezinski, « l’extension de l’orbite euro-atlantique rend impérative l’inclusion des nouveaux États indépendants ex-soviétiques, et en particulier l’Ukraine. » Après six ans d’un pouvoir marqué par des affaires de corruption et des difficultés économiques croissantes, Ioutchenko fut sévèrement battu par le candidat pro-russe Ianoukovitch lors de l’élection présidentielle de 2010, ne recueillant que 5% des voix. L’ours russe avait fait montre de patience et l’Ukraine revenait peu à peu dans le giron de Moscou, au grand dam des États-Unis (on relèvera par exemple la déclaration de la Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Hillary Clinton, en 2012 qui faisait état de la « profonde déception » que représentait l’Ukraine pour le Département d’État. C’est le moins que l’on puisse dire après l’énergie et les moyens mis en œuvre par les États-Unis pour faire de l’Ukraine un maillon central de leur politique d’encerclement de la Russie). L’on ne peut comprendre la crise actuelle, sur laquelle nous reviendrons en fin d’article, sans connaître la trame dans laquelle elle s’inscrit.
Les années 2000 avaient en effet été marquées par ces « Révolutions de couleur », mouvements populaires de protestation contre la corruption de leurs dirigeants, généralement alliés de Moscou, et de revendications démocratiques. Certaines voix assurent que ces « révolutions », fortement soutenues, financées et instrumentalisées par les États-Unis afin d’isoler la Russie, furent créées par Washington, mais cela semble exagéré. Il s’agit plutôt ici d’une convergence d’intérêt entre de réelles aspirations démocratiques locales et un soutien américain fortement intéressé, en fonction de l’emplacement stratégique de ces pays. L’on retrouvera cette politique lors du Printemps arabe, Washington soutenant les mouvements populaires contre des régimes ennemis mais se gardant bien d’apporter quelque soutien que ce soit aux révoltes contre des régimes alliés – voir par exemple le printemps arabe de Bahreïn, révolte de la population majoritairement chiite réprimée dans le sang par la monarchie sunnite alliée de l’Occident, sans que celui-ci n’émette le moindre mot de protestation.

Les pays touchés par les « révolutions colorées » des années 2000 n’avaient pas été choisis par hasard.
Les pays touchés par les « révolutions colorées » des années 2000 n’avaient pas été choisis par hasard et force est de constater qu’ils se trouvent sur le Rimland (Ukraine, Géorgie, Kirghizstan) ou constituaient des postes avancés de la Russie au-delà de cette ceinture (Serbie, « Grande Syrie »). La Révolution des roses amena le dynamique et russophobe Mikhaïl Saakachvili à la tête de la Géorgie, pion essentiel du corridor pétrolier pour le transit des richesses de la Caspienne vers la Méditerranée, évitant la Russie ou le Moyen-Orient. Le rapprochement à marche forcée vers l’OTAN engagé par Saakachvili, le décuplement du budget militaire géorgien – sans que curieusement Washington, si prompt par ailleurs à relever l’augmentation des budgets de ses concurrents, n’en souffle mot – ne pouvaient laisser Moscou sans réaction. Le bombardement en 2008 par la Géorgie de l’Ossétie et de l’Abkhazie, deux enclaves russes, donna un prétexte en or à Poutine et c’est une guerre éclair que la Russie mena et gagna, lançant un message fort dans le Caucase et ailleurs. La guerre de 2008 mit d’ailleurs fin à l’expansion de l’OTAN vers l’est. En Ukraine, la Révolution orange suivit celle des roses mais, stratégiquement parlant, se termina tout aussi mal pour Washington, comme on l’a vu. La dernière de ces « Révolutions », celle des tulipes au Kirghizstan, tourna court, l’opposition arrivée au pouvoir se divisant presque immédiatement tandis que, depuis, des émeutes agitent régulièrement le pays.
Un temps sur la défensive, Moscou regagne le terrain perdu, maniant la carotte – accords commerciaux, annulation de dette – et le bâton. Comme dans le dossier ukrainien, comme partout à vrai dire, les liens économiques, géopolitiques et historiques tissés durant des décennies voire des siècles entre la Russie et ses voisins prévalent sur les chimériques promesses des États-Unis, d’ailleurs rarement suivies d’effet. Washington n’a réussi qu’à gagner du temps, quelques années, face à ce qui apparaît comme une inévitable (re)constitution du Heartland, qu’il soit sous obédience russe ou plus certainement sous forme une confédération de pays aux intérêts stratégiques communs. Comme en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, le caractère parfois utopique de la politique étrangère américaine se heurte aux réalités du terrain. L’exemple kirghize est de ce point de vue éclairant. Intégré dans un espace eurasiatique en plein développement, fortement lié économiquement à ses voisins russes et chinois, le Kirghizstan était pressé par ceux-ci de ne pas renouveler le bail de la base de Manas. Que pouvait offrir Washington en contrepartie afin de maintenir sa présence militaire ? La réponse est très simple : rien. De fait, Bichkek n’a pas hésité longtemps et a annoncé la fermeture définitive, le 3 juin 2014, de la dernière base américaine en Asie centrale.
Non seulement les États-Unis n’ont pas réussi à pénétrer le Heartland ou à en détacher véritablement le Rimland, mais ils ont été témoins de ce qu’ils craignaient le plus : l’émergence d’une organisation susceptible de constituer un bloc eurasiatique. À peu près ignorée des médias français tournés vers l’écume des choses, l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) pourrait bien, à terme et au prix tout de même de certaines évolutions importantes, supplanter l’OTAN et contrôler l’échiquier eurasiatique, c’est-à-dire le destin du monde. Créée dans les années 90, l’OCS regroupe la Chine, la Russie, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan – soit toute l’Asie centrale sauf le Turkménistan, attaché à une neutralité absolue. Depuis 2005, elle compte également en tant que membres observateurs l’Afghanistan, et surtout l’Inde, le Pakistan et l’Iran, soit trois poids lourds de la périphérie centre-asiatique, qui deviendront membres à part entière en septembre de cette année, lors du sommet de Douchanbé. Sentant le danger, les États-Unis avaient immédiatement demandé un statut de membre observateur mais se sont vu opposer un niet sec et définitif. Certes, nous sommes encore loin d’une union militaire type OTAN ou d’un bloc homogène au sein duquel les différents États auraient une politique convergente et l’on ne peut passer sous silence les rivalités au sein de l’organisation – Tadjikistan-Ouzbékistan, Inde-Pakistan – susceptibles d’entraver son développement. Mais les choses évoluent très vite, l’intervention américaine en Afghanistan et les méfiances qu’elle a suscitées ont accéléré le mouvement. D’une structure relativement informelle dans les années 90, l’OCS s’est transformée en organisation de sécurité et de lutte contre « le terrorisme, l’islamisme et le séparatisme » – l’un des fondements de la charte de l’organisation. Elle constitue également un espace de dialogue économique visant à favoriser les échanges commerciaux. Passant à la vitesse supérieure, des manœuvres militaires communes, parfois de grande ampleur, ont vu le jour à partir de la fin des années 2000, notamment entre la Russie et la Chine. Fin août, de très grandes manœuvres ont eu lieu en Chine, regroupant 7 000 soldats des différents membres de l’OCS, incluant forces aériennes et terrestres, troupes parachutistes, opérations spéciales, guerre électronique…
 En prenant en compte l’Inde, le Pakistan, l’Iran et la Mongolie qui rejoindront l’alliance de plein pied cette année, c’est 40% de la population mondiale – dont les deux pays les plus peuplés de la planète -, près de 40 millions de km², quatre puissances nucléaires – et peut-être cinq si l’Iran parvient à acquérir la bombe -, les deuxième et troisième armées de la planète. Et last but not least, les ressources énergétiques fabuleuses de la Russie, des républiques d’Asie centrale et de l’Iran. De quoi faire se retourner Mackinder et Spykman dans leur tombe… À Washington, on ne prend pas du tout l’OCS à la légère et chaque sommet, chaque évolution de l’organisation est scruté à la loupe. Le sentiment d’impuissance des États-Unis est d’autant plus profond que c’est du fait de leurs interventions et de leurs menées dans le Heartland et le Rimland que s’est accéléré le processus d’intégration eurasiatique et le rapprochement sino-russe. Malgré les rodomontades de l’administration américaine – voir par exemple les déclarations très sèches de la Secrétaire d’État Hillary Clinton en décembre 2012 : « Les États-Unis s’opposeront à tout processus d’intégration dans l’espace postsoviétique » -, Washington n’a tout simplement pas les moyens de s’opposer à quoi que ce soit. Ce discours, qui peut paraître étonnant aux yeux des non-initiés qui ne comprennent pas en quoi cela peut bien concerner les États-Unis, relève évidemment du Grand jeu ; c’est une réaction relativement désespérée devant la constitution inéluctable du bloc eurasiatique, bloc qu’ils n’ont aucun moyen de saboter ou de ralentir.
En prenant en compte l’Inde, le Pakistan, l’Iran et la Mongolie qui rejoindront l’alliance de plein pied cette année, c’est 40% de la population mondiale – dont les deux pays les plus peuplés de la planète -, près de 40 millions de km², quatre puissances nucléaires – et peut-être cinq si l’Iran parvient à acquérir la bombe -, les deuxième et troisième armées de la planète. Et last but not least, les ressources énergétiques fabuleuses de la Russie, des républiques d’Asie centrale et de l’Iran. De quoi faire se retourner Mackinder et Spykman dans leur tombe… À Washington, on ne prend pas du tout l’OCS à la légère et chaque sommet, chaque évolution de l’organisation est scruté à la loupe. Le sentiment d’impuissance des États-Unis est d’autant plus profond que c’est du fait de leurs interventions et de leurs menées dans le Heartland et le Rimland que s’est accéléré le processus d’intégration eurasiatique et le rapprochement sino-russe. Malgré les rodomontades de l’administration américaine – voir par exemple les déclarations très sèches de la Secrétaire d’État Hillary Clinton en décembre 2012 : « Les États-Unis s’opposeront à tout processus d’intégration dans l’espace postsoviétique » -, Washington n’a tout simplement pas les moyens de s’opposer à quoi que ce soit. Ce discours, qui peut paraître étonnant aux yeux des non-initiés qui ne comprennent pas en quoi cela peut bien concerner les États-Unis, relève évidemment du Grand jeu ; c’est une réaction relativement désespérée devant la constitution inéluctable du bloc eurasiatique, bloc qu’ils n’ont aucun moyen de saboter ou de ralentir.
Pire, l’Organisation de Coopération de Shanghai devient attractive ! En janvier, 2013, l’écume des événements a fait passer à peu près inaperçue une véritable bombe géopolitique : le premier ministre turc Recep Erdogan, invité à la télévision, déclara que la Turquie était encline à abandonner sa démarche européenne pour lui préférer une entrée dans l’Organisation de Coopération de Shanghai, qu’il a qualifiée de « plus forte et importante que l’Union Européenne » (Erdogan lorgne l’Organisation de Coopération de Shanghai, Europolitique, 28 janvier 2013). Il faut certes rester prudent, ce pour plusieurs raisons. L’OCS poursuivant son intégration et développant une coopération militaire sans cesse plus poussée, se poserait notamment le problème de l’allégeance d’Ankara à l’OTAN. Encore faudrait-il pour cela que la Turquie soit admise, ce qui est loin d’être évident : contrairement à la Russie, la Chine n’est pas très favorable à l’entrée de la Turquie, conséquence sans doute des déclarations du premier ministre turc qualifiant, non sans exagérations, la répression chinoise au Xinjiang turcophone en 2009 de « génocide ». On constate également, avec la crise syrienne actuelle, que les positions russe et chinoise d’un côté, turque de l’autre sont totalement inconciliables. Enfin, un bluff à l’attention de Bruxelles n’est pas non plus à écarter. Néanmoins, selon les observateurs, un vrai palier a été franchi et cette sortie d’Erdogan ne relevait pas de la plaisanterie. La Turquie n’attend plus grand-chose de l’Europe et un récent sondage montre que deux tiers des Turcs disent ne plus s’intéresser à l’adhésion à l’UE. Pour la Turquie, s’asseoir à la même table que la Russie et la Chine pourrait marquer la reconnaissance tant attendue d’un poids politique que l’Union Européenne ne lui reconnaît pas. En tant que membre de l’OCS, la Turquie pourrait également être tentée de jouer le rôle de « grand frère » des États turcophones d’Asie centrale, de leader de la turcité.
Si ce changement de direction est sérieux – et il y a tout lieu de croire qu’il l’est – c’est un événement considérable. Une fois n’est pas coutume, faisons un peu de « géopolitique fiction » : un bloc allant de la Mer Jaune à la Méditerranée, réunissant pour la première fois les cinq grandes civilisations historiques de l’Eurasie. Les mondes indien (Inde et Pakistan), chinois, russe, perse (Iran et Tadjikistan) et turc (Turquie, Ouzbékistan, Kazakhstan et Kirghizistan), si souvent ennemis par le passé, désormais associés dans une organisation contrôlant l’échiquier eurasiatique, réunissant le Heartland et le Rimland. Le rêve inachevé des invincibles Mongols de Gengis Khan et le cauchemar des stratèges américains… Nous n’en sommes pour le moment pas là ; l’OCS est une organisation jeune, encore dans son adolescence et qui connaîtra invariablement des problèmes de croissance. Nul doute que les États-Unis s’immisceront dans toutes les failles possibles afin de diviser ses membres et d’empêcher son développement. Mais si l’OCS parvient à unifier les contraires qui la composent, à lisser leurs différends et à harmoniser leurs stratégies, tout en continuant son intégration, en un mot si cette organisation devient adulte, elle changera vraisemblablement la face du monde et le dominera. À suivre avec infiniment d’attention.
Une zone d’extrême tension
Reste un point à évoquer, fondamental. Le Grand jeu pour le contrôle de l’Asie centrale et de ses ressources énergétiques se déroule dans une zone de conflits nombreux et variés, susceptibles de contrecarrer la stratégie des différents acteurs. Conséquence de l’incroyable richesse de son histoire, l’Asie centrale est un véritable casse-tête de peuple et de religions entremêlés dont la formidable et parfois explosive diversité est à prendre en compte. Mis à part le Turkménistan, le Kirghizstan et le Kazakhstan, relativement homogènes malgré une importante minorité russe pour ce dernier, tous les États de la région sont des mosaïques ethnique ou confessionnelle génératrices de conflits potentiels. A cela s’ajoutent des querelles territoriales anciennes et un renouveau partiel de l’islamisme.
Il est également important de souligner que ces zones de tension se situent dans un mouchoir de poche, un territoire à peine deux fois plus grand que la France !
Depuis qu’il est sous les feux de l’actualité, l’Afghanistan est le cas le mieux connu. Terre de passage de tous les grands conquérants de l’histoire et de toutes les invasions – empire perse, Alexandre le grand, empire sassanide, invasions des peuples turcs, Gengis Khan, Tamerlan -, le pays est un kaléidoscope de populations laissées là par l’Histoire. Les Tadjiks, population iranienne sunnite répandue sur tout le territoire et principale composante de l’Alliance du nord, y côtoient les Ouzbeks, groupe turcique sunnite présent dans le nord du pays, les Hazaras, population mongole persanisée et chiite dans le centre, et surtout les Pachtounes, à cheval sur l’Afghanistan et le Pakistan, qui constituent le plus grand groupe ethnique du pays et la majeure partie des bataillons talibans. En 2008, le chef d’état-major des Armées françaises, le général Georgelin, n’a pas mâché ses mots, parlant d’un « merdier ingérable ». De fait, mise à part la longue période de paix caractérisant le règne de Zaher Shah (1933-1973), l’Afghanistan fut durant presque toute son histoire en état de guerre, ses différentes composantes se battant entre elles, s’alliant ou se trahissant, parfois instrumentalisées par les puissances voisines. Le Pakistan joua constamment la carte pachtoune – les Talibans en dernier lieu – tout en manœuvrant avec circonspection, de peur de créer un appel d’air susceptible de pousser ses propres Pachtounes à revendiquer la création d’un « Pachtounistan » de part et d’autre de la frontière pakistano-afghane, créée artificiellement au XIXème siècle, on l’a vu. La situation des deux pays est intrinsèquement liée, à tel point qu’un acronyme a fait son apparition ces dernières années : Af-Pak pour Afghanistan-Pakistan, tant il est difficile d’envisager la situation de l’un sans prendre en compte celle de l’autre (sur l’Af-Pak, les relations intrinsèques qui existent entre les deux pays, leurs tentatives respectives de créer une « nation », on se réfèrera à l’excellente étude de Georges Lefeuvre intitulée Afghanistan, dans Le mondial des nations – 30 chercheurs enquêtent sur l’identité nationale, Choiseul, 2011, pp. 222-239). Par proximité culturelle ou confessionnelle, l’Iran compte sur les relais d’influence que sont les Tadjiks iranophones ou les Hazaras iranophones et chiites. Ennemi déclaré des Talibans, Téhéran soutint également Ismail Khan, le gouverneur de l’ancienne province iranienne d’Hérat dans son combat contre les fondamentalistes pachtounes. La Russie a peu ou prou les mêmes sympathies que l’Iran ; très méfiante vis-à-vis des Talibans et de leur maître pakistanais, Moscou a très vite soutenu l’Alliance du nord à majorité tadjike du feu commandant Massoud dans les années 90. Ironie de l’histoire quand on pense que les Tadjiks afghans ont constitué parmi les principaux bataillons de moudjahidines résistant à l’invasion soviétique entre 1980 et 1988. La politique afghane de l’Inde suit la même voie, marquée par une proximité certaine avec les Tadjiks, sans doute renforcée par les excellentes relations que New Delhi entretient avec le Tadjikistan qui ont permis, comme nous l’avons vu, l’établissement de la base militaire de Farkhor – c’est d’ailleurs dans l’hôpital de cette base que mourra le commandant Massoud, grièvement blessé par l’attentat de deux terroristes d’Al Qaeda le 9 septembre 2001. On constate qu’en Afghanistan comme ailleurs, l’axe Russie-Inde-Iran issu de la Guerre froide semble perdurer. Cependant, les Indiens entretiennent également d’excellentes relations avec le gouvernement pachtoune modéré d’Hamid Karzaï. Les États-Unis quant à eux n’avaient pas d’idée bien préconçue au moment d’intervenir en Afghanistan, sinon d’« imposer » la démocratie et un régime favorable à leurs intérêts. Ces espoirs chimériques se sont une nouvelle fois fracassés sur la dure réalité du terrain. Plus long engagement militaire américain depuis la Guerre du Vietnam, ayant coûté jusqu’ici la bagatelle de 600 milliards de dollars sans compter les dépenses futures – traitement médicaux, prise en charge des vétérans etc. -, l’intervention en Afghanistan s’est révélée un bourbier pour Washington qui a dû revoir ses ambitions fortement à la baisse. Les attaques des Talibans n’ont jamais été aussi nombreuses, le gouvernement n’a toujours aucune réelle légitimité et peu de pouvoir en dehors de Kaboul, les zones tribales pakistanaises sont en effervescence, les seigneurs de la guerre, à l’abri dans leur fief, commencent à recruter leurs milices privées dans les rangs mêmes de l’armée dite « nationale » en prévision de l’après 2016 – le taux de désertion des soldats afghans est extrêmement élevé – tandis que la corruption et le trafic de drogue ont atteint des niveaux record. Un « failed State » selon la propre terminologie de Washington. Les Britanniques, qui ont le sens de la formule, parlaient de l’Afghanistan comme du « tombeau des empires ». Vingt-cinq ans après avoir attiré son ennemi soviétique dans le bourbier afghan provoquant sa désintégration, les États-Unis se retrouvent maintenant eux-mêmes enlisés. L’Histoire nous joue parfois de ces tours… Autre ironie, preuve s’il en est de leur impuissance, les Américains ont entamé depuis deux ans des discussions avec l’entourage du Mollah Omar, celui-là même, avec son protégé Ben Laden, qu’ils étaient venus chasser il y a douze ans ! Toutefois, dans ce contexte de ce qu’il faut bien appeler une défaite militaire – car, dans ce genre de guerre, ne pas gagner équivaut à perdre – tout n’est peut-être pas perdu pour Washington. Un gain stratégique a minima est encore possible, avec le maintien en Afghanistan de bases et d’une force de réaction d’une dizaine de milliers d’hommes jusqu’en 2016, au terme de négociations difficiles et parfois houleuses entre le gouvernement Karzaï et l’administration Obama. Cela pose néanmoins certaines questions. Les Talibans, qui sont en phase ascendante et offensive, vont-ils accepter le reste d’une présence américaine ? Cela semble peu vraisemblable et l’on se demande comment une petite armée de 10 000 hommes pourrait remporter une guerre que n’a pas été capable de gagner une coalition quinze fois plus nombreuse… Est-ce pour cela que Washington a fait des ouvertures au Mollah Omar ? Peut-on envisager une partition qui ne dit pas son nom, entre des zones pachtounes sous le contrôle des Talibans et un Afghanistan « utile » traversé par le fameux pipeline TAPI et protégé par les forces américaines restantes ? Toutefois, ce pipeline doit passer par les zones tribales pachtounes. Est-ce un autre thème des discussions américano-talibanes ? Quid du gouvernement afghan qui, sans le soutien des forces coalisées, s’écroulerait rapidement ? On le voit, beaucoup de questions et peu de réponses pour l’instant.
Le retrait de l’OTAN et ses conséquences sur l’évolution afghane seront observés de très près, notamment au Pakistan. Selon toute vraisemblance, les Talibans repasseront massivement du côté afghan pour tenter de prendre le pouvoir à Kaboul, ce qui soulagerait Islamabad dans ses zones tribales. Les dirigeants pakistanais ont en effet fort à faire par ailleurs. Le Baloutchistan représente une zone de turbulence et d’instabilité récurrente qui peut se révéler aussi explosive que les zones tribales, bien que beaucoup moins médiatique. Ayant constitué un royaume indépendant par le passé, les Baloutches ont vu d’un très mauvais œil la constitution de l’État pakistanais en 1947 et pas moins de cinq guerres insurrectionnelles ont eu lieu depuis, guerres que l’Inde est accusée d’avoir attisées afin d’affaiblir le frère ennemi. On a vu que la zone était d’une importance stratégique immense avec le nœud de Gwadar autour duquel se tisse l’alliance stratégique et énergétique entre la Chine, le Pakistan et l’Iran. Quant au conflit du Cachemire, il est potentiellement le plus dangereux de la région. On en connaît l’histoire : une population majoritairement musulmane réclamant son rattachement au Pakistan en 1947, un maharadja hindou souhaitant son rattachement à l’Inde, une partition en deux qui laisse chacun sur sa faim. New Delhi veut récupérer la partie septentrionale ; Islamabad revendique la partie méridionale et instrumentalise les mouvements islamistes qui y mènent la guérilla. Une douzaine de groupes rebelles combattent au Cachemire indien pour son indépendance ou son rattachement au Pakistan, dans un conflit qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. À partir du milieu des années 1990, ces mouvements furent rejoints par des djihadistes étrangers, arabes et afghans, formés au combat en Afghanistan lors du djihad contre les Soviétiques. L’on note depuis quelques mois une recrudescence d’activité de ces groupes et de récentes informations, que l’Inde prend très au sérieux, envisagent la perspective d’un futur afflux des djihadistes venant d’Afghanistan après le retrait des troupes de l’OTAN l’année prochaine. Mais ce conflit dépasse le seul cadre territorial ou identitaire. Pour le pouvoir pakistanais, la question du Cachemire permet de mobiliser et d’unir derrière lui une société divisée et de faire passer au second plan l’impéritie économique des différents gouvernements qui se sont succédé. Quant à l’armée, elle justifie par ce conflit son budget colossal. Il faut noter enfin que le Cachemire est également un enjeu hydrographique, le Pakistan, et dans une moindre mesure l’Inde, étant fortement tributaires des rivières qui descendent de ses montagnes. Sous l’ombre du K2, cet abcès de fixation à la confluence de trois religions – islam, bouddhisme et hindouisme – est également à la croisée de trois puissances nucléaires. Au terme de l’agression chinoise de 1962, condamnée à la fois, fait rare, par l’URSS et les États-Unis, Pékin occupa définitivement le territoire indien de l’Aksaï Chin, bande de terre désolée mitoyenne du Cachemire et du Tibet. Le Pakistan a, de plus, cédé à la Chine une partie de son Cachemire septentrional gagné sur l’Inde, sans doute à dessein, afin de compliquer le règlement du conflit, car l’Inde ne peut évidemment pas reconnaître cette cession d’un territoire qu’elle a perdu et qu’elle revendique toujours. Le conflit cachemiri est inextricable et explosif, assurément l’un des points les plus chauds du globe malgré l’altitude glacée à laquelle il se déroule, et surveillé de près par tous les états-majors du monde. Au-delà du refus de rendre à l’Inde une région qu’il considère comme lui revenant de plein droit, il semble de toute façon impossible que le Pakistan envisage des négociations de restitution du Cachemire septentrional. Celui-ci est en effet devenu, avec le développement des relations avec sino-pakistanaises, un territoire stratégiquement essentiel : c’est le seul point de contact terrestre entre la Chine et le Pakistan, reliés par la fameuse Karakoram Highway, la route la plus haute du monde, par où transitent biens commerciaux et équipements militaires. Et demain, peut-être, le pétrole et le gaz coulant de Gwadar jusqu’au Xinjiang chinois.
 Le Xinjiang justement, voisin du Cachemire. On a vu que ce territoire peuplé majoritairement (mais pour combien de temps ?) de turcophones musulmans, les Ouïghours, était en bute à un mouvement indépendantiste et à la répression de Pékin. Situé dans un environnement hostile – le Taklamakan en son centre, deuxième désert de sable du monde, entouré au nord par les Monts célestes, à l’ouest par le Pamir, au sud par les monts Kunlun et le plateau tibétain, à l’est par le désert de Gobi – ce que l’on nomme maintenant le Xinjiang fut la plaque tournante de la Route de la soie pendant deux millénaires, entre la Chine proprement dite et l’Asie centrale et occidentale, et, de ce fait, attira toujours les convoitises des dynasties impériales chinoises, sans succès. Islamisé dès le Xème siècle, le territoire fut finalement incorporé au XVIIIème siècle à l’empire chinois et nommé « Xinjiang », soit « nouvelle frontière » en mandarin, ce qui prouve d’ailleurs indirectement, par son nom même, le caractère expansionniste de la politique chinoise dans la région. Cependant, la tutelle de Pékin resta très légère voire nulle, la Chine entrant très vite en décadence et n’ayant pas les moyens d’asseoir une réelle domination dans ses provinces éloignées, trop occupée qu’elle était à faire face aux empiètements occidentaux et à tenter de mettre au pas les Seigneurs de la guerre. A l’instar du Tibet, le Xinjiang accepta donc la suzeraineté nominale de Pékin qui se contentait d’y envoyer quelques rares administrateurs. Cela n’empêcha d’ailleurs pas la région de se révolter (1933-1934 et 1944-1949) et de constituer une éphémère « République du Turkestan oriental », prouvant l’attachement des Ouïghours à leur indépendance. Pour le Xinjiang comme pour le Tibet, tout changea avec l’accession au pouvoir du Parti communiste en 1949 ; la tutelle se fit beaucoup plus dure, le Parti communiste tenta d’imposer par la force son idéologie religieuse athée tandis que les deux provinces, situées à un emplacement stratégique, étaient envahies par l’armée chinoise. Tout mouvement séparatiste ou supposé tel fut très brutalement réprimé et la « colonisation » des Han, l’ethnie majoritaire en Chine, commença tandis que les bulldozers détruisaient et détruisent encore des pans entiers du patrimoine culturel des villes, comme c’est d’ailleurs le cas dans le reste de la Chine. Tibétains et Ouïghours se retrouvent minoritaires sur leur propre territoire et les poussées d’exaspération de la population sont immédiatement associées par Pékin à des mouvements séparatistes et impitoyablement réprimées. Les sanglantes émeutes tibétaines de 2008 ont été suivies des révoltes à fort caractère ethnique de 2009 au Xinjiang. Depuis, des bombes explosent ponctuellement dans les grandes villes de la province. Pour les Ouïghours, l’espoir de suivre la voie de leurs cousins des Républiques d’Asie centrale nouvellement indépendantes en 1991 a tourné court. La Chine ne lâchera jamais le Xinjiang, riche en hydrocarbures, point stratégique d’entrée des pipelines d’Asie centrale et point de passage avec l’allié pakistanais. Tout comme elle ne lâchera jamais le Tibet, atout stratégique majeur surplombant l’Inde. Militairement, Pékin ne craint rien : que représentent dix millions de Ouïghours et six millions de Tibétains face au milliard et demi de Han ? Toutefois, c’est sur le plan international que les choses peuvent poser problème. On a vu que les dirigeants chinois sont réticents à laisser entrer la Turquie dans l’Organisation de Coopération de Shanghai, l’une des raisons avancées par les observateurs étant la crainte chinoise de voir Ankara jouer un rôle de « grand frère » des peuples turcophones, donc des Ouïghours, et remettre en cause la répression au Xinjiang. Si les dirigeants chinois veulent poursuivre le développement de l’Organisation de Coopération de Shanghai en collaboration avec les républiques d’Asie centrale turcophones et peut-être demain avec la Turquie, il faudra bien qu’ils finissent par régler de manière pacifique et concertée le problème du Xinjiang. Jusque récemment, les condamnations internationales répétées n’étaient pas prises en compte par Pékin. Certains observateurs pensent que l’accession de la Chine au statut de superpuissance l’obligera à entrer de plein pied dans la communauté internationale et à prendre en compte certaines doléances, à faire preuve d’un comportement plus responsable en quelque sorte, plus en adéquation avec les critères internationaux. D’autres, plus nombreux, voient au contraire un net durcissement ces dernières années : une Chine de plus en plus revendicatrice, menaçante, où l’aristocratie du PCC, qui a perdu toute légitimité marxiste, flatte le nationalisme grandissant de la population. Seul l’avenir nous dira quelle évolution suivra la Chine. Une chose est sûre : de cette évolution dépendra le sort du Xinjiang et du Tibet.
Le Xinjiang justement, voisin du Cachemire. On a vu que ce territoire peuplé majoritairement (mais pour combien de temps ?) de turcophones musulmans, les Ouïghours, était en bute à un mouvement indépendantiste et à la répression de Pékin. Situé dans un environnement hostile – le Taklamakan en son centre, deuxième désert de sable du monde, entouré au nord par les Monts célestes, à l’ouest par le Pamir, au sud par les monts Kunlun et le plateau tibétain, à l’est par le désert de Gobi – ce que l’on nomme maintenant le Xinjiang fut la plaque tournante de la Route de la soie pendant deux millénaires, entre la Chine proprement dite et l’Asie centrale et occidentale, et, de ce fait, attira toujours les convoitises des dynasties impériales chinoises, sans succès. Islamisé dès le Xème siècle, le territoire fut finalement incorporé au XVIIIème siècle à l’empire chinois et nommé « Xinjiang », soit « nouvelle frontière » en mandarin, ce qui prouve d’ailleurs indirectement, par son nom même, le caractère expansionniste de la politique chinoise dans la région. Cependant, la tutelle de Pékin resta très légère voire nulle, la Chine entrant très vite en décadence et n’ayant pas les moyens d’asseoir une réelle domination dans ses provinces éloignées, trop occupée qu’elle était à faire face aux empiètements occidentaux et à tenter de mettre au pas les Seigneurs de la guerre. A l’instar du Tibet, le Xinjiang accepta donc la suzeraineté nominale de Pékin qui se contentait d’y envoyer quelques rares administrateurs. Cela n’empêcha d’ailleurs pas la région de se révolter (1933-1934 et 1944-1949) et de constituer une éphémère « République du Turkestan oriental », prouvant l’attachement des Ouïghours à leur indépendance. Pour le Xinjiang comme pour le Tibet, tout changea avec l’accession au pouvoir du Parti communiste en 1949 ; la tutelle se fit beaucoup plus dure, le Parti communiste tenta d’imposer par la force son idéologie religieuse athée tandis que les deux provinces, situées à un emplacement stratégique, étaient envahies par l’armée chinoise. Tout mouvement séparatiste ou supposé tel fut très brutalement réprimé et la « colonisation » des Han, l’ethnie majoritaire en Chine, commença tandis que les bulldozers détruisaient et détruisent encore des pans entiers du patrimoine culturel des villes, comme c’est d’ailleurs le cas dans le reste de la Chine. Tibétains et Ouïghours se retrouvent minoritaires sur leur propre territoire et les poussées d’exaspération de la population sont immédiatement associées par Pékin à des mouvements séparatistes et impitoyablement réprimées. Les sanglantes émeutes tibétaines de 2008 ont été suivies des révoltes à fort caractère ethnique de 2009 au Xinjiang. Depuis, des bombes explosent ponctuellement dans les grandes villes de la province. Pour les Ouïghours, l’espoir de suivre la voie de leurs cousins des Républiques d’Asie centrale nouvellement indépendantes en 1991 a tourné court. La Chine ne lâchera jamais le Xinjiang, riche en hydrocarbures, point stratégique d’entrée des pipelines d’Asie centrale et point de passage avec l’allié pakistanais. Tout comme elle ne lâchera jamais le Tibet, atout stratégique majeur surplombant l’Inde. Militairement, Pékin ne craint rien : que représentent dix millions de Ouïghours et six millions de Tibétains face au milliard et demi de Han ? Toutefois, c’est sur le plan international que les choses peuvent poser problème. On a vu que les dirigeants chinois sont réticents à laisser entrer la Turquie dans l’Organisation de Coopération de Shanghai, l’une des raisons avancées par les observateurs étant la crainte chinoise de voir Ankara jouer un rôle de « grand frère » des peuples turcophones, donc des Ouïghours, et remettre en cause la répression au Xinjiang. Si les dirigeants chinois veulent poursuivre le développement de l’Organisation de Coopération de Shanghai en collaboration avec les républiques d’Asie centrale turcophones et peut-être demain avec la Turquie, il faudra bien qu’ils finissent par régler de manière pacifique et concertée le problème du Xinjiang. Jusque récemment, les condamnations internationales répétées n’étaient pas prises en compte par Pékin. Certains observateurs pensent que l’accession de la Chine au statut de superpuissance l’obligera à entrer de plein pied dans la communauté internationale et à prendre en compte certaines doléances, à faire preuve d’un comportement plus responsable en quelque sorte, plus en adéquation avec les critères internationaux. D’autres, plus nombreux, voient au contraire un net durcissement ces dernières années : une Chine de plus en plus revendicatrice, menaçante, où l’aristocratie du PCC, qui a perdu toute légitimité marxiste, flatte le nationalisme grandissant de la population. Seul l’avenir nous dira quelle évolution suivra la Chine. Une chose est sûre : de cette évolution dépendra le sort du Xinjiang et du Tibet.
Située à l’ouest du Xinjiang, la vallée de Ferghana inquiétait particulièrement les chancelleries au début des années 2000. Partagée entre l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan, cette oasis de verdure au milieu des déserts et des montagnes est l’une des régions les plus peuplées et disputées d’Asie centrale. Carrefour historique, berceau intellectuel et religieux qui a vu passer le zoroastrisme, le bouddhisme, le christianisme nestorien et plus récemment l’islam, le Ferghana est devenu un lieu de discorde après 1991, lorsque les frontières internes de l’URSS devinrent frontières internationales. Découpée en d’innombrables enclaves propices aux conflits frontaliers, la vallée est un foyer de tensions ethniques et de querelles autour de l’eau. Juché sur le Pamir, le Tadjikistan est en effet le château d’eau de l’Asie centrale. L’Amou Daria et le Syr Daria – respectivement l’Oxus et l’Iaxarte des Grecs – s’écoulent du Pamir ou des Monts célestes vers la Mer d’Aral, traversant les pays de la région. La question des retenues d’eau en amont des deux fleuves ne cesse de provoquer des heurts, particulièrement entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, déjà prompts à se quereller par ailleurs, dernier avatar de la très vieille rivalité entre mondes turc et iranien. Depuis la chute de l’URSS, chaque État de la zone adopte une politique personnelle, sans consultation avec ses voisins. Ainsi, aux coupures de courant de Tachkent répondent les retenues d’eau de Douchanbe. Si, selon ce que nous prédisent certains analystes, les « guerres de l’eau » seront une source majeure de conflits dans le monde au XXIème siècle, le Ferghana fera assurément partie des points chauds de la planète. A ces discordes « classiques » s’est greffé, à la fin des années 90, un nouveau problème : l’islamisme. Soixante-dix ans de soviétisme avaient profondément modelé les mentalités des populations et ce que certains nommaient la « renaissance musulmane » de l’Asie centrale après l’indépendance de ces républiques ne fut jamais un phénomène de grande ampleur. Toutefois, le Ferghana, conflictuel, était un terreau fertile. L’Arabie saoudite, toujours prompte à transformer ses pétrodollars en écoles coraniques, y fut pour quelque chose, ayant financé et soutenu le wahhabisme au Pakistan et en Afghanistan. Le mouvement remonta ensuite vers l’Asie centrale où des groupes islamistes virent le jour, profitant de l’exaspération d’une frange de la population face à la situation économique et à l’impéritie des gouvernements. Le plus important est le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (MIO), fondé à la fin des années 90. Réprimé sans compromission par les autorités, il se replia vers l’Afghanistan et le Pakistan où on le retrouve actuellement aux côtés d’Al Qaeda et des Talibans, même s’il existe une certaine divergence idéologique avec ces derniers (le thème est complexe. Sans entrer dans les détails, l’islamisme lui-même est traversé de courants nombreux et divers. Les « fondamentalistes locaux » – Talibans, Frères musulmans égyptiens, Hamas en Palestine – n’ont que faire du Califat mondial prôné par l’internationale djihadiste type Al-Qaeda, et une profonde divergence existe entre ces deux courants du fondamentalisme. Ainsi, des combats meurtriers, qui firent des centaines de morts, ont eu lieu à plusieurs reprises dans les zones tribales pakistanaises entre les Talibans et le Mouvement Islamique d’Ouzbékistan).
Après les attaques contre le World Trade Center et le Pentagone, une hypothèse intéressante mais difficilement vérifiable a vu le jour. Dans un article intitulé « Le 11 septembre, le plan de Ben Laden avait déjà échoué », un journaliste russe émit l’idée que le plan d’Al-Qaeda et des Talibans avait été d’assassiner le commandant Massoud, chef charismatique de la résistance anti-talibane, bien avant le 9 septembre et qu’à cette date, il était déjà trop tard. L’objectif, une fois Massoud éliminé et la résistance privée de son chef, était de s’emparer de la totalité de l’Afghanistan et d’entrer en Ouzbékistan et au Tadjikistan, en s’appuyant sur les mouvements islamistes locaux, principalement le MIO. Le chef de ce mouvement, Djouma Namangani, avait d’ailleurs rejoint Ben Laden peu avant. L’inévitable riposte américaine après les attaques de New York et de Washington aurait touché plusieurs États d’Asie centrale, provoquant l’embrasement général de la région et profitant de fait aux islamistes. Mais les assassins de Massoud ne parvinrent à leurs fins que deux jours avant les attentats du 11 septembre, beaucoup trop tard pour envisager une avancée vers l’Asie centrale (Alexandre Khokhlov, Le 11 septembre, le plan de Ben Laden avait déjà échoué, Izvestia, rapporté par Courrier International, 2 novembre 2001). Après l’intervention américaine appuyée sur l’Alliance du nord, les Talibans, Al-Qaeda et le MIO se réfugièrent, comme on le sait, dans les zones tribales pakistanaises. De récents rapports font état d’une forte recrudescence d’activité des activistes islamistes, particulièrement du MIO, qui se sont infiltrés dans le nord de l’Afghanistan et préparent déjà l’après-2016, à la fois en Afghanistan même et dans les républiques d’Asie centrale. Conscients du danger, l’Ouzbékistan a mis en place une ligne de double barbelé électrifié et de champs de mine le long de sa courte frontière avec l’Afghanistan. Mais les frontières avec le Tadjikistan et le Turkménistan sont longues et poreuses, impossibles à surveiller, et le retour des radicaux islamistes en Asie centrale ne laisse pas d’inquiéter.
Kazakhstan, Kirghizstan et Turkménistan mis à part, l’ensemble de la région est une zone à très haute dangerosité qui compte un certain nombre de conflits potentiellement explosifs, sans même parler de l’Iran ou du Caucase voisins. Au-delà du risque d’embrasement lui-même, ces éléments sont propres à contrecarrer la stratégie des acteurs du Grand jeu. On a vu que l’alliance pakistano-chinoise était contrariée par les conflits se déroulant sur le territoire pakistanais – révolte baloutche menaçant la pérennité de Gwadar, conflits des zones tribales et du Cachemire compliquant le projet de pipeline vers la Chine. Ces conflits ont également des répercussions sur l’Iran qui cherche à desserrer l’étau des sanctions américaines en se rapprochant du Pakistan et de la Chine. Pékin devra également régler en douceur le problème du Xinjiang afin de ne pas s’aliéner les membres turcophones de l’OCS et poursuivre le développement de cette organisation susceptible de redessiner la carte du monde futur. Les États-Unis eux-mêmes, embourbés en Afghanistan et maladroits dans leurs relations avec les satrapes d’Asie centrale, n’ont pu avancer vers le cœur du Heartland. Malgré l’énergie et l’activisme déployés sous l’administration Bush, ils ont également globalement échoué à isoler la Russie. Ukraine mise à part, il semble que l’administration Obama soit moins encline à l’affrontement, ou peut-être est-ce simplement que les États-Unis se sont fait une raison et ont finalement accepté l’inévitable déclin de leur influence. L’Inde joue une participation intéressante, mais le point d’abcès cachemiri et la dispute frontalière qui en découle avec la Chine bloque quelque peu ses efforts vers l’Asie centrale. Toutefois, depuis l’élection de Narendra Modi, un rapprochement semble se dessiner entre l’Inde et ses deux rivaux traditionnels. Seule la Russie semble pour l’instant sortir gagnante, mais après avoir pris beaucoup de retard dans les années 90. Évitant soigneusement de s’immiscer dans les conflits et ayant « réglé » ceux qui la concernaient directement (Tchétchénie, Géorgie), retournant subtilement des pays qui s’en étaient brièvement écartés, jouant avec un talent certain de la diplomatie du gaz, Moscou a réussi à regagner une partie du terrain perdu vers le Rimland. C’est dans ce contexte qu’éclata la crise ukrainienne…
Le conflit ukrainien, partie intégrante du Grand jeu
Il ne s’agit pas ici de prendre partie dans ce conflit qui déchaîne les passions et la désinformation de part et d’autre – avec tout de même une mention spéciale pour les médias occidentaux -, ni d’en narrer les rebondissements. Constatons simplement que la crise ukrainienne est la suite logique de ce que nous avons tenté d’expliquer dans cet article et fait partie intégrante du Grand jeu, tant dans ses causes que dans son déroulement et ses conséquences. Elle a commencé avec la question de l’intégration eurasienne et aura – a déjà, devrait-on dire – d’énormes répercussions indirectes sur l’échiquier eurasiatique, le Grand jeu énergétique et, au-delà, le modèle du monde à venir, dans un sens d’ailleurs favorable à la Russie contrairement à ce que l’on pourrait penser.
La crise actuelle débuta en novembre lorsque Kiev, déjà en situation de quasi cessation de paiement, se retrouva devant un choix : l’intégration à l’Union Européenne ou l’intégration à l’Union Eurasienne, projet de Vladimir Poutine visant à constituer un espace économique sur une partie de l’ancienne URSS. Loin d’être une marionnette russe, le président ukrainien Ianoukovitch alla à Bruxelles et à Moscou pour faire, assez cyniquement d’ailleurs, monter les enchères. Les Européens proposaient quelques centaines de millions d’euros, les Russes quinze milliards. Le choix était évident : Ianoukovitch se tourna vers la Russie, provoquant l’opposition résolue des États-Unis – l’on se rappelle des déclarations prémonitoires d’Hillary Clinton en décembre 2012 : « Les États-Unis s’opposeront à tout processus d’intégration dans l’espace postsoviétique » – et d’une partie de la population ce pays culturellement bipolaire. L’identité réelle des auteurs de la fusillade du Maïdan, qui provoqua le départ de Ianoukovitch, ou du crash de l’avion de la Malaysia Airlines qui entraîna les sanctions européennes (il existe de très sérieux doutes sur l’identité réelle des tireurs du Maïdan et plusieurs éléments semblent indiquer une responsabilité interne aux manifestants. Voir la conversation du 26 février entre le Ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Paet et Catherine Ashton. Voir aussi l’enquête de la télévision publique allemande ARD qui met en cause le groupe Svoboda, d’ailleurs accusé par les familles des victimes. En ce qui concerne le Boeing de la Malaysia Airlines, un certain nombre d’experts aéronautiques ou de journalistes chevronnés, Robert Parry entre autres, pointent du doigt Kiev. À noter que le principal journal malaisien, The New Straits Times, a lui aussi titré sur la responsabilité des forces gouvernementales dans le crash de l’avion), en passant par l’étonnant soutien occidental à un gouvernement en partie composé de néo-nazis ou la guerre dans le Donbass, sont des questions qui ne nous occupent pas ici. Attachons-nous aux conséquences de cette crise sur le Grand jeu eurasiatique et, partant, mondial.
Si l’on devait résumer en une phrase la nouvelle tectonique des relations internationales issue de l’éruption ukrainienne, nous pourrions dire que les États-Unis ont réussi à s’attacher totalement, et de manière assez étonnante, les Européens, tout en s’isolant du reste du monde. Il y a dix ans, l’activisme de l’administration Bush n’avait rien pu faire contre le rapprochement économique, énergétique et politique russo-européen. Dès lors, comment expliquer un tel revirement européen en 2014 ? Les explications données par les observateurs sont diverses : un changement de personnel politique, des dirigeants européens appartenant à la génération « américanisée » des Young leaders (programme d’échange visant à développer les liens transatlantiques et qui a formé des centaines d’élites françaises à l’ « américanité », dont le président Hollande et plusieurs ministres de l’actuel gouvernement) ; l’intégration européenne continue et la soumission de la Commission de Bruxelles aux intérêts américains ; l’impossibilité pour un pays européen d’œuvrer à ses propres intérêts au sein de cette structure européenne (l’exemple de certains pays balkaniques ou d’Europe centrale est, à ce titre, éclairant : les dirigeants autrichien, hongrois, bulgare, finlandais ou grec sont obligés de mettre en œuvre les mesures prises par la Commission de Bruxelles – sanctions économiques contre la Russie, gel de la construction du South Stream – tout en reconnaissant publiquement qu’elles sont contraires à l’intérêt de leur pays.) ; les écoutes de la NSA et le moyen de pression sur les dirigeants européens qui en découlerait… Toujours est-il que Washington a réussi à créer une réelle brèche entre l’Europe occidentale et la Russie. Le projet South Stream, qui devait fournir l’Europe du sud et balkanique en gaz, est maintenant en suspens ; les échanges commerciaux sont en chute libre du fait des sanctions européennes et des mesures de rétorsion russes. Surtout, une méfiance semble s’être durablement installée dans les opinions publiques des deux camps, conditionnant les politiques du futur. Etait-ce là le calcul de Washington qui, en déclin, perdant peu à peu le monde et à défaut de pouvoir isoler la Russie des pôles de puissance et de richesse du XXIème siècle, a sauvé les meubles en réussissant à soumettre l’Europe de l’ouest et à l’arrimer définitivement avant qu’il ne soit trop tard (cette convergence totale et relativement surprenante entre les dirigeants européens et Washington est peut-être à mettre en parallèle avec le projet d’accord de libre-échange transatlantique qui, selon de nombreux économistes, bénéficiera avant tout à l’économie américaine au détriment de l’économie européenne. Par ailleurs, l’on voit de plus en plus souvent l’OTAN sortir complètement de son rôle et se mêler de sujets économiques, comme l’ont montré son soutien au traité de libre-échange transatlantique ou sa critique des organisations écologistes qui s’opposent au gaz de schiste, les accusant de faire le jeu de la Russie ! S’agit-il, au final et toutes choses bien considérées, de créer un grand État occidental transatlantique où les États-Unis auront absorbé les pays européens avec la complicité active des dirigeants de ces derniers ? Cette question, qui aurait paru loufoque il y a seulement quelques années, peut aujourd’hui sérieusement se poser au vu de l’invraisemblable soumission de l’establishment européen à la politique américaine, dans à peu près tous les domaines) ?
Car la Russie, après avoir paru un temps en difficulté, semble finalement sortir, à moyen et long terme, grande gagnante de cette crise. Certes, la coupure avec l’Europe sera vraisemblablement durable et le risque que l’Ukraine entre dans l’OTAN existe – cela dépendra de l’évolution du conflit dans le Donbass, des grandes manœuvres diplomatiques qui ont lieu dans l’ombre et de la situation économique et politique en Ukraine même. Mais la Russie a mis – ou remis – la main sur la Crimée, s’assurant définitivement la base navale de Sébastopol. Surtout, l’activisme occidental semble paradoxalement avoir jeté dans les bras de Moscou le reste du monde… Au-delà de l’écume des événements, l’année 2014 aura connu des mouvements de fond considérables, parfois surprenants, tous, Europe exceptée, au bénéfice de la Russie et au détriment des États-Unis. L’on en avait eu un premier aperçu lors du vote du 27 mars à l’ONU sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Présenté par les médias occidentaux comme une preuve supplémentaire de l’isolement de Moscou sur la scène internationale, ce vote constitua au contraire une petite victoire pour la Russie et dessinait déjà les prémices de l’isolement américain qui ira grandissant tout au long de l’année. Sous des prétextes divers, près de quatre-vingt États – les principaux pays de la planète en dehors du bloc occidental et de ses protégés – s’abstinrent de condamner la Russie : Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Argentine, Pakistan, Iran, Israël (!), Egypte, Irak (!), Vietnam, Liban, Emirats Arabes Unis, Maroc, Kazakhstan, Algérie, Uruguay, Kenya, Tanzanie, Ouzbékistan, Afghanistan (!), Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire… Ces poids-lourds mondiaux ou simplement régionaux ont pour dénominateur commun de ne pas être sous influence occidentale directe, de ne pas faire partie d’une alliance militaire américaine et de mener une politique étrangère indépendante, pas nécessairement pro-russe. La « trahison » d’États-clients comme Israël – qui argua d’une grève de son personnel diplomatique, piètre excuse qui ne trompa personne à Washington -, l’Irak ou l’Afghanistan provoqua d’ailleurs la fureur du Département d’État américain. La carte suivante est éclairante. Remarquons que, mis à part le petit Bhoutan, l’Eurasie dans son ensemble s’abstint de condamner la Russie, ainsi que la majorité de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et la moitié des pays arabes.

En vert : États ayant condamné le rattachement de la Crimée à la Russie. En jaune : États s’étant abstenus par vote. En bleu : États s’étant abstenus sous divers prétextes. En rouge : États ayant voté contre la condamnation.
La dernière semaine de mai fut un cauchemar pour les stratèges américains qui assistaient, impuissants, à ce qu’ils avaient toujours redouté : l’accélération du processus d’intégration de l’Eurasie. Du point de vue géopolitique, c’est à coup sûr l’un des moments les plus importantes de ce début de XXIème siècle. La visite très attendue de Poutine en Chine se solda, on l’a vu, par le contrat gazier du siècle. Surtout, il fut décidé que le dollar ne serait pas utilisé comme moyen de paiement, marquant le début de la fin de la domination universelle du dollar qui permettait jusqu’alors aux États-Unis de se faire entretenir par le reste de la planète. Le mouvement de dé-dollarisation s’accélère partout, en Amérique latine mais aussi en Asie ou au Moyen-Orient. La Chine promit également d’investir massivement en Crimée, reconnaissant ainsi implicitement l’annexion de l’île par la Russie. Et, cerise sur le gâteau, le président chinois proposa une nouvelle structure de sécurité asiatique incluant la Russie et l’Iran mais excluant les États-Unis, le tout en présence des présidents irakien et afghan visiblement très intéressés par l’idée – on imagine aisément qu’à Washington, l’enthousiasme des présidents irakien et afghan, installés par les Américains au terme de guerres à plusieurs centaines de milliards de dollars, fut considéré comme un nouveau coup de poignard dans le dos. Deux jours plus tard eut lieu le Forum économique de Saint-Pétersbourg en présence d’importantes délégations d’investisseurs chinois, indiens, japonais, mais aussi allemands. Le représentant chinois reprit la proposition faite par le président Xi Jinping lors de son voyage en Allemagne : une voie ferrée passant par la Russie et reliant la Chine à l’Allemagne en douze jours, nouvelle Route de la soie appelée à devenir la principale voie commerciale du monde, évitant la voie maritime susceptible d’être interrompue par les Américains, marginalisant ainsi les États-Unis. Ce nouveau jalon de l’intégration économique eurasiatique repose maintenant sur l’évolution des sanctions européennes prises à l’encontre de la Russie – et l’on comprend que Washington ait pesé de tout son poids pour « convaincre » Bruxelles, Berlin, Londres et Paris de prendre ces mesures. Tout dépendra de l’Allemagne, engluée dans ses propres contradictions, à la fois cheval de Troie en Europe des intérêts géopolitiques américains et des intérêts géo-économiques russes. A ce titre, le pas de deux d’Angela Merkel qui se rapproche tour à tour de Washington et de Moscou sera très intéressant à suivre. Enfin, quelques jours plus tard, l’accord sur l’Union Eurasienne fut signé entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Certes, l’Ukraine n’en fait pas partie, mais d’autres pays demandent leur adhésion : le Kirghizstan, l’Arménie, et il est même question de la Turquie.
La prise de distance d’Ankara avec l’Occident est l’un des faits les plus remarquables de cette année 2014. Dans le Grand jeu entre Moscou et Washington, où chacun tente de prendre les pions de l’autre, l’on parle évidemment beaucoup de l’Ukraine que les États-Unis tentent désespérément d’arracher à l’orbite russe depuis vingt ans, mais moins de la Turquie qui prend doucement mais sûrement le chemin inverse, sans à-coups, sans guerre, sans même que la Russie n’insiste vraiment, d’une manière somme toute naturelle. Nous avons vu qu’Erdogan avait secoué la scène internationale début 2013 en déclarant qu’il était dorénavant plus intéressé par l’Organisation de Coopération de Shanghai que par l’Union Européenne. Le 19 juillet 2014, deux nouvelles bombes géopolitiques ont éclaté. En marge d’une rencontre des ministres de l’économie et du commerce des pays du G20 à Sydney, le ministre turc proposa d’établir une zone de libre-échange avec l’Union Eurasienne. A Washington, il y a de quoi s’arracher les cheveux : tout a été fait pour que l’Ukraine n’y entre pas et voilà que leur propre allié au sein de l’OTAN entend s’y intégrer, partiellement au moins. Pire ! Le même jour, Ankara demanda formellement à Moscou de commercer désormais dans leurs monnaies nationales et non plus en dollars, accélérant le mouvement de dé-dollarisation du commerce mondial, donc la difficulté grandissante des États-Unis à s’autofinancer. Si les décisions politiques ou géopolitiques suivent les mouvements économiques, ce revirement turc est somme toute assez logique. L’année dernière, Gazprom annonçait que la Turquie deviendrait bientôt le premier importateur de gaz russe devant l’Allemagne.
Pour Vladimir Poutine, les bonnes nouvelles se sont enchaînées durant l’été. Pour sa première visite officielle hors monde arabe, le président égyptien al-Sisi a choisi la Russie et non les États-Unis ou l’Europe. A Sotchi, cet autre poids lourd du Moyen-Orient qu’est l’Egypte a montré son intérêt pour un accord de libre échange avec l’Union Eurasienne qui, loin d’être mort-née comme d’aucuns le prétendent, semble attirer un nombre croissant de pays, y compris en dehors de l’Eurasie proprement dite. De plus, Le Caire a évidemment proposé d’augmenter ses exportations agricoles vers la Russie pour compenser l’arrêt des importations de produits alimentaires européens, mesure de rétorsion prise par le Kremlin suite aux sanctions décidées par l’Union Européenne. Ces sanctions, prises sous la pression américaine et qui paraissent maintenant de plus en plus suicidaires, ont fait la joie d’un grand nombre de pays dans le monde qui se sont immédiatement bousculés pour remplacer les Européens sur le marché russe : Argentine, Brésil, Egypte, Turquie, Chine, Inde, Equateur, Uruguay…
Enfin, comment ne pas parler de l’intégration des BRICS, même si cela ne concerne que partiellement notre sujet ? Créé de manière quelque peu informelle au début des années 2000, ce club regroupant les cinq principaux pays émergeants de la planète – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – compte trois milliards d’habitants, assure 50% de la croissance économique mondiale et totalise un PIB qui talonne déjà celui des États-Unis et de l’Union Européenne. Selon un rapport pourtant très conservateur de Goldman Sachs, quatre des cinq membres feront partie des six premières économies mondiales en 2050 (la Chine (1ère), l’Inde (3ème), le Brésil (5ème) et la Russie (6ème). Goldman Sachs, Dreaming with BRICS : The path to 2050, in Global economics papers n°99, 2003). Or les BRICS se sont mués, au fil du temps, en association aux liens de plus en plus serrés, économiques mais aussi diplomatiques. Ils partagent la même vision d’un monde multipolaire, rejettent l’unilatéralisme américain, remettent en cause le système financier international issu de la Seconde Guerre Mondiale et dominé par les Occidentaux. Lors du vote sur la Crimée à l’ONU, les quatre partenaires de la Russie ont refusé de la condamner et lui ont au contraire apporté un discret soutien. En juillet, lors du sommet de Fortaleza, les BRICS ont décidé de passer à la vitesse supérieure, créant un système financier parallèle comprenant un fonds de stabilisation de 100 milliards équivalent-dollars et une banque de développement au capital de 50 milliards équivalent-dollars, concurrençant respectivement le FMI et la Banque mondiale, instruments permettant jusqu’ici la domination financière américaine par le biais des prêts en dollars. La mise en place de ce nouveau système financier international s’accompagne d’accords bilatéraux au sein et autour des BRICS – l’Argentine souhaite vivement y entrer – visant à ne plus utiliser le dollar dans leurs échanges : Chine-Russie, Argentine-Chine, Argentine-Russie, Brésil-Chine, Argentine-Brésil… sans compter la proposition turque dont nous avons parlé plus haut. Une autre semaine noire pour Washington qui voit maintenant la domination du dollar sérieusement ébranlée, et partant, sa capacité d’endettement lui permettant de faire financer ses guerres par les autres pays. Est-ce un hasard si l’avion de la Malaysia Airlines fut abattu deux jours après le sommet de Fortaleza, le doigt accusateur immédiatement pointé sur les rebelles russophones donc la Russie, dans une hystérie médiatique collective assez surprenante ?
L’intégration des BRICS, ou peut-être est-ce la prochaine entrée de l’Inde dans l’Organisation de Coopération de Shanghai, a même réussi le tour de force de raccommoder les deux ennemis héréditaires de l’Asie. L’étonnant rapprochement, ces derniers mois, entre la Chine et l’Inde est l’un des grands faits marquants de l’année 2014. Le mouvement avait déjà été initié au tournant de 2010, mais il s’est accéléré avec l’élection au poste de premier ministre de Narendra Modi. Signe des temps, New Delhi avait invité pour la première fois de son histoire le ministre des Affaires étrangères chinois ainsi que le premier ministre pakistanais à assister à la cérémonie d’investiture, et tous deux acceptèrent. Dans la foulée, Pékin annonça une batterie d’investissements en Inde. L’admiration de Modi pour la Chine est de notoriété publique et il y fit de nombreuses visites lorsqu’il était encore ministre en chef de sa province du Gujarat. En retour, les dirigeants chinois n’ont pas ménagé leurs louanges, le comparant même à Deng Xiao Ping. En réservant sa première visite internationale pour le sommet des BRICS le 15 juillet à Fortaleza, Modi a envoyé un message symbolique fort sur ses priorités en politique étrangère : œuvrer à un monde multipolaire, se rapprocher de la Chine et maintenir l’amitié traditionnelle avec la Russie. Le président américain Obama, lui, attendra jusqu’en septembre pour une rencontre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU… Pékin et New Delhi, autrefois si sourcilleux, sont désormais prêts à tous les compromis : la banque des BRICS, qui sera basée à Shanghai, aura un président indien. Autre signe du très net réchauffement des relations sino-indiennes et de la confiance mutuelle qui s’instaure : après le « contrat du siècle » signé en mai entre Moscou et Pékin, le premier ministre indien a proposé de prolonger le gazoduc jusqu’à son pays, reliant ainsi la Sibérie à l’Inde à travers le territoire chinois, chose impensable il y a seulement quelques années.
Ce méga-deal a d’ailleurs provoqué un foisonnement de projets de pipelines en Eurasie. En visite à Moscou, le ministre pakistanais de l’énergie a proposé à la Russie de construire un gazoduc vers le Pakistan. L’entrée du Pakistan et de l’Inde dans l’Organisation de Coopération de Shanghai en septembre pourrait faciliter le transit à travers les républiques d’Asie centrale, tout en encourageant d’ailleurs à régler enfin le conflit indo-pakistanais au Cachemire, permettant ainsi le passage du pipeline Gwadar-Chine que nous avions évoqué plus haut. Par ailleurs, Moscou a effacé 90% de la dette nord-coréenne contre le passage d’un gazoduc fournissant le riche marché sud-coréen, rapprochant ainsi par des liens énergétiques indissolubles les deux frères ennemis. La construction devrait débuter sous peu, Séoul ayant fait la sourde oreille aux pressions américaines pour sanctionner la Russie. Le Japon n’est pas en reste puisque plusieurs dizaines de députés se sont exprimés en faveur de la réalisation du vieux projet de gazoduc entre l’île russe de Sakhaline et Ibaraki. Cependant, Tokyo est tiraillé entre ses besoins énergétiques croissants suite à l’accident de Fukushima et à la diminution de la production nucléaire qui en a résulté, et la nécessité de ne pas trop déplaire aux États-Unis.
La Russie se tourne vers les riches marchés asiatiques et commence enfin à développer pleinement ses immenses ressources énergétiques de Sibérie, jusque-là sous-exploitées. L’aigle à deux têtes de l’emblème russe était traditionnellement tourné à la fois vers l’Europe occidentale et vers l’Asie. Le comportement européen durant la crise ukrainienne a profondément déçu Moscou où les « eurasistes » ont marqué beaucoup de points ces derniers mois (voir le dossier très complet sur l’eurasisme dans le numéro 1 de Conflits, printemps 2014). Face à une Europe vieillissante, endettée et de plus en plus soumise aux exigences de Washington, les pôles de richesses et de dynamisme asiatiques représentent une option autrement plus attrayante. Cela prendra certes un peu de temps mais c’est inévitable. L’on pourrait d’ailleurs remarquer que, contrairement aux États-Unis qui utilisent cette formule stratégique de manière répétitive mais quelque peu vaine, Vladimir Poutine est en passe de réussir sans coup férir son « pivot asiatique ». La géopolitique de l’énergie et l’intégration eurasiatique sont même susceptibles de réaliser l’impossible : régler définitivement des conflits vieux de plusieurs décennies, entre l’Inde et le Pakistan ou entre les deux Corées.
La tectonique des plaques géopolitique et économique quitte peu à peu l’Atlantique pour faire mouvement vers l’Eurasie, vers les BRICS, vers le monde multipolaire de demain, d’aujourd’hui déjà. Au-delà des effets de manche, les États-Unis sont chaque jour plus marginalisés ; ils n’ont plus les moyens de leur politique ni la politique de leurs moyens. Le mouvement de dé-dollarisation du monde s’accélère, ils perdent leur contrôle sur les flux énergétiques qui, seul, pourrait leur permettre de garder une certaine primauté sur le monde, tandis que le Heartland et le Rimland sont en train de leur échapper. Le Grand jeu continuera dans ces zones névralgiques de la planète mais l’Amérique ne peut plus le gagner, tout juste peut-elle en retarder l’échéance. L’aigle russe à deux têtes, lui, regarde ailleurs désormais : vers l’intégration géostratégique de l’Eurasie, matérialisée par une Organisation de Coopération de Shanghai en pleine ascension, unissant maintenant les principales civilisations eurasiennes, et vers la multipolarité du monde, représentée par les BRICS, principales puissances économiques du monde à l’horizon d’une génération.
[divider]
Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici
[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]