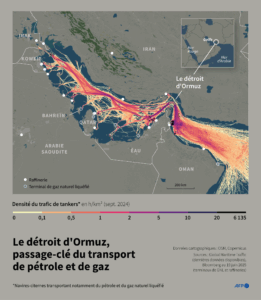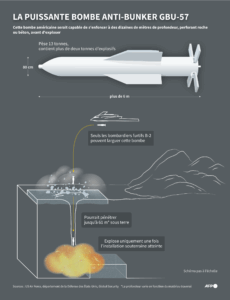Si le soft power consiste en la capacité à obtenir des autres ce qu’ils n’auraient pas voulu spontanément, sa manifestation la plus subtile consiste en la fixation de règles, de normes voire d’usages valant pour le plus grand nombre. En ce domaine, les États-Unis sont passés maîtres.
Joseph Nye insiste sur le fait que ce qui différencie hard et soft power réside en la variété des moyens utilisés afin d’obtenir les résultats que l’on souhaite. Et de citer ces moyens : du hard power avec le commandement (Command), les pressions (Coercion), l’incitation (Inducement), jusqu’au soft power avec l’élaboration des grands rendez-vous internationaux et de leur ordre du jour (Agenda setting), la séduction exercée par la culture (Attraction), la capacité enfin à influencer les décisions des autres (Co-opt).
Le pouvoir de « co-optation » réside principalement dans l’orientation, la fixation de règles internationales plus ou moins contraignantes qui permettent d’orienter le jeu mondial. Il repose notamment sur une certaine forme du droit, la « soft law », expression qui désigne l’ensemble des textes de droit international établissant des normes, certes non contraignantes mais qui s’appliquent sous la pression internationale. Étonnamment, Nye ne s’aventure que peu sur ce domaine, pourtant décisif.
Le « normative Power »
C’est à l’Américain Robert Rosencrance que l’on doit d’avoir théorisé la notion de « pouvoir normatif » (normative Power) dans le cadre d’une étude relative à l’Union européenne. Cette notion a été popularisée en France par Zaki Laïdi dans son ouvrage La norme sans la force (2005). Ce dernier définit le pouvoir normatif comme la capacité à fixer « des standards mondiaux par opposition à l’idée de “puissance empirique” qui s’imposerait par des conquêtes ou une domination physique ». Là où la puissance brute renvoie à la force, la norme renvoie à la règle mais les deux se rejoignent car ils visent à contraindre. On retrouve la distinction entre hard et soft power. En ce sens, le pouvoir normatif s’inscrit pleinement dans le registre de la « puissance douce » ; la norme vise à délimiter, fixer, limiter, préserver. Elle découle plus souvent de négociations et d’accords que d’une imposition brutale. Mais celui qui est capable de l’édicter dispose alors d’un pouvoir immense car une fois la norme adoptée, elle est opposable à tous.
À certains égards, on pourrait dire que les États-Unis ont participé, dès leur sortie de l’isolationnisme, à la construction de normes valant pour le bloc occidental. L’impulsion a été donnée dès 1944 avec la conférence de Bretton Woods qui a fait du dollar la nouvelle devise-pivot du système monétaire international, détrônant l’hégémonie séculaire de la livre sterling. Le rôle central des États-Unis à l’ONU, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international dont ils sont à la fois cofondateurs et principaux bailleurs de fonds participe d’un équilibre de la puissance mondiale largement en leur faveur. De façon plus large, l’aide Marshall, la diffusion du cinéma et de la culture américaine ont servi l’expansion de l’American Way of Life, enracinant le modèle de valeurs américain. C’est alors que Jean-Jacques Servan-Schreiber pouvait écrire dans Le défi américain : « Ni les légions, ni les matières premières, ni les capitaux ne sont plus les marques, ni les instruments de la puissance. Les gisements où il faut puiser ne sont plus ni dans la terre, ni dans le nombre, ni dans les machines – ils résident dans l’esprit. » La consécration des valeurs américaines a eu lieu alors que s’achève la guerre froide et que s’impose le « consensus de Washington ». Cette expression, proposée en 1989 par l’économiste John Williamson, désignait un ensemble de normes – baisse des prélèvements obligatoires, ouverture aux échanges notamment – qui étaient sur le point de s’imposer, non seulement dans le bloc occidental, mais aussi dans les anciens pays communistes ainsi qu’à une large partie du tiers-monde. Il est peu de domaines qui ne soient aujourd’hui inspirés par les États-Unis : de l’économie à la culture, en passant par la politique – le recours aux primaires pour l’élection présidentielle en France en est l’un des greffons les plus récents. Mais le pouvoir normatif américain ne se manifeste pas seulement dans ces domaines.
A lire aussi : Les « airshows » du monde multipolaire font leur « soft power »
L’importance du cadre juridique
Depuis l’entrée en mondialisation, en effet, les États-Unis ont bâti de nouveaux rapports normatifs pour leur plus grand bénéfice. Ils leur permettent d’échapper à un multilatéralisme qui pourrait contraindre leur action.
Ce n’est pas un hasard si Washington a signé une vingtaine d’accords d’investissement bilatéraux depuis le début des années 1990, notamment avec l’Australie, Israël, Singapour, la Corée du Sud, le Maroc et la plupart des pays latino-américains. Ces accords établissent des conditions « justes et équitables » pour les investissements et les investisseurs des deux pays, conditions dont l’appréciation est laissée, en cas de litige, à des instances arbitrales en vertu de ce dispositif appelé ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Il permet à des multinationales de demander des comptes aux États dans lesquels elles investissent. Le gouvernement américain a plusieurs fois insisté sur le fait que le champ de l’ISDS ne s’étendait pas aux politiques de protection des consommateurs, de l’environnement ou de la santé publique. Néanmoins, Daniel Ikenson, membre du Cato Institute, un think tank américain libéral, reconnaît : « L’ISDS est approprié pour être exploité par des juristes créatifs. Il y a une grande latitude d’interprétation du traitement “juste et équitable” pour les investissements étrangers, compte tenu du fait que ces termes sont vagues. » Il n’est pas étonnant que, dans ces conditions, les États-Unis soient le principal pays duquel émanent des procédures à l’encontre de pays étrangers (plus de 140 en 2014 contre moins de 60 pour les Pays-Bas, deuxième de la liste) et, dans le même temps, l’un des pays les moins attaqués : ils faisaient l’objet en 2014 de 15 procédures, contre 53 pour l’Argentine. Pour paraphraser Ikenson, on pourrait dire que les juristes américains sont tout simplement les plus inventifs du monde…
Il est frappant d’ailleurs que ces procédures favorisent les entreprises américaines même indirectement. Ainsi, le groupe Philip Morris a attaqué coup sur coup l’Uruguay en 2010 – qui avait restreint le droit de fumer dans les espaces publics – et l’Australie en 2011 – qui avait imposé un paquet de cigarette neutre – au motif que ces lois lésaient l’image et la propriété intellectuelle du cigarettier américano-helvétique. Ces procédures ont créé une forte appréhension en Europe lorsque, en 2013, ont commencé les négociations bilatérales au sujet du TAFTA ou TTIP, l’accord de libre-échange transatlantique. L’émotion était d’autant plus forte que ce genre de traité a généralement un champ d’action plus large que celui de l’OMC ; ainsi, le projet de traité transatlantique que voulait Barack Obama devait-il englober l’ensemble des industries culturelles, dont le cinéma, ce qui aurait signé son arrêt de mort dans de nombreux pays européens. En 2013, la France, rejointe par treize pays membres de l’UE, avait obtenu au nom de l’exception culturelle, que les services audiovisuels soient exclus des négociations.
Les dures sanctions du doux pouvoir
On comprend combien la capacité à organiser les règles de l’arène économique mondiale est un immense pouvoir aux mains de Washington. Mais si ce sont les États-Unis – et l’Union européenne d’ailleurs – qui l’exercent le plus nettement, c’est qu’ils possèdent les moyens de les faire appliquer. Car, pour qu’elle soit crédible, cette forme de puissance doit être adossée à une menace de sanctions. Les accords bilatéraux d’investissements permettent aux entreprises américaines de réclamer des dédommagements financiers énormes lorsqu’elles s’estiment lésées. En vertu des accords de l’ALENA, Detroit International Bridge Company, l’entreprise propriétaire du pont à péage reliant les villes de Detroit et Windsor, a assigné en justice en 2007 le gouvernement canadien, s’estimant lésée par une nouvelle législation. Dans un autre registre, le Canada est aujourd’hui attaqué par la compagnie pétrolière américaine Lone Pine Resources qui réclame 250 millions de dollars de dédommagements après la décision d’Ottawa de poser un moratoire sur la fragmentation hydraulique.
En dehors de ce cadre bilatéral, l’État fédéral dispose d’un « gros bâton » dont il sait très bien faire usage. Ainsi, Barack Obama a-t-il réussi à faire plier les banques suisses et leur faire renoncer au précieux secret bancaire qui avait fait leur fortune depuis 1934. Le texte auquel est adossé ce séisme dans le paysage financier a été signé en mars 2010 sous le nom de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Il s’agit d’une loi à portée extraterritoriale qui oblige les institutions bancaires à identifier leurs clients américains. D’une portée immense, elle tire son efficacité de la menace d’amendes colossales dont UBS d’ailleurs a été la cible. En 2009, la banque suisse a dû acquitter la somme de 790 millions de dollars afin d’éviter des poursuites pour fraude fiscale. En 2014, le Crédit Suisse a payé 2,6 milliards de dollars d’amendes pour la même raison. Entre-temps, le gouvernement américain a obtenu, par pression, un accord avec Berne pour solder l’historique des comptes américains non déclarés avant que ne s’applique au 1er janvier 2018 la fin du secret bancaire suisse. Dans ce dossier, l’administration américaine a eu recours à un moyen juridique nouveau et terriblement efficace : les Deals of Justice, c’est-à-dire des ententes directes avec les États ou entreprises qui auraient enfreint la loi. Ces procédures ont de quoi choquer les juristes puisqu’elles font prévaloir le rapport de force, dont on n’imagine guère qu’il puisse ne pas être favorable aux États-Unis.
Au-delà du droit, les normes, une arme et une forteresse
Il est des manières plus subtiles encore par lesquelles les normes parviennent à affaiblir des concurrents des grandes entreprises américaines. On pense notamment aux négociations actuelles relatives aux règles prudentielles dans le secteur bancaire. Actuellement, les grands pays de l’Union européenne, France et Allemagne en tête, craignent que l’augmentation des fonds propres exigés par la Commission de Bâle – à laquelle les États-Unis n’étaient pas défavorables – ne soit en défaveur de leurs banques ; en effet, outre-Atlantique, les groupes bancaires participent trois fois moins dans le financement de l’économie. Les accords de Bâle III pourraient ainsi avoir un effet beaucoup plus dépressif pour l’économie européenne, pour le plus grand bénéfice de l’Amérique de Donald Trump. Les exemples de l’influence américaine en matière de normes, de la capacité des États-Unis à définir les règles qui vaudront à l’échelle internationale sont pléthore. Leur puissance de « cooptation » s’est exercée dans des domaines aussi différents que le marché carbone – où ils ont su imposer l’idée de quotas payants au lieu de seuils maximum –, que les normes de gouvernance des entreprises – la distinction entre le conseil d’administration et le conseil de surveillance – adoptées par un quart des entreprises françaises environ.
Mais si les États-Unis sont devenus champion des normes, c’est qu’ils sont à la fois capables de les édicter pour les autres tout en refusant celles des autres si elles viennent à contrecarrer leurs intérêts. C’est là probablement la preuve ultime de leur puissance. Leurs refus en la matière sont extrêmement nombreux. Ils sont la seule très grande puissance, avec la Chine, à refuser le cadre multilatéral : refus de participer à la Cour pénale internationale, refus de reconnaître le droit de la mer initié avec les accords de Montego Bay, refus de ratifier le protocole de Kyoto. Il est symptomatique que le président Trump aille encore plus loin dans cette logique, s’affranchissant de cadres qui lui semblent contraignants : dénonciation des accords de Paris, retrait du traité transpacifique, défiance à l’égard du TAFTA, de l’OTAN, et même de l’ALENA. Il s’agit d’un défi risqué pour Trump car, à privilégier le seul registre de la puissance dure et en oubliant le pouvoir que lui donne ou donnerait le cadre normatif de ces traités, il n’est pas sûr qu’il parvienne à être « first » contre tous.
Au-delà de ces considérations, il apparaît que le pouvoir normatif, s’il se rattache bien au soft power, ne peut se passer d’une sanction que Nye classe dans les fondements du hard power. On comprend peut-être alors pourquoi le père du soft power envisage si peu le pouvoir normatif ; outre que ce dernier s’inscrit mal dans sa typologie, il est probablement l’une des armes les plus puissantes et les moins visibles de l’Amérique.