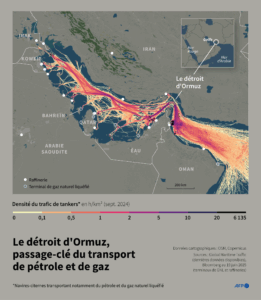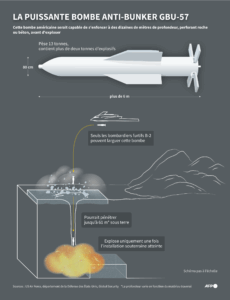Troisième religion la plus pratiquée au monde, l’hindouisme est aussi l’une des plus anciennes. Méconnue des Occidentaux, la religion hindoue diffère largement dans ces principes des deux grandes religions du livre. Comme son nom le laisse entendre, l’hindouisme est issu du sous-continent indien, qui reste son principal foyer de peuplement. Une étude approfondie de l’hindouisme permet de mettre en lumière les liens qui unissent le culte et la culture de l’Inde. À l’heure où le gouvernement actuel trouve dans la religion hindoue un véritable socle pour assoir sa politique, il semble crucial de comprendre et de connaître les fondements de cette religion.
Propos recueillis par Côme de Bisschop.
Spécialiste de l’hindouisme, Philippe Benoît est maître de conférences à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).
L’hindouisme est l’une des plus anciennes religions du monde, sans fondateur ni livre sacré comme la Bible ou le Coran. À partir de quand commence-t-on à parler « d’hindouisme » ? Existe-t-il des textes qui fixent les fondements de la religion ?
Ce sont des étrangers, les colonisateurs britanniques qui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, ont introduit ce terme d’« hindouisme », pour regrouper sous une même rubrique cette diversité religieuse et sociale impressionnante.
L’hindouisme, paradoxalement, est une des religions les plus anciennes au monde, mais porte un nom d’invention récente, au regard de sa très longue histoire.
Par l’existence bien attestée de grands textes religieux, dont les plus anciens apparaissent, selon les historiens et les philologues autour de ~1500, et par des vestiges archéologiques, de plus en plus nombreux surtout à partir de ~500, nous avons une idée vaste et précise de l’activité religieuse dominante dans le monde indien (qui englobe principalement les États aujourd’hui nommés Inde, Pakistan, Bangladesh), activité qui perdure jusqu’à nos jours, avec certes de nombreuses et profondes évolutions.
Mais cet ensemble de pratiques et croyances religieuses n’avait pas pleinement conscience de son unité jusqu’à la période coloniale et il n’avait donc pas de nom générique. Ceux que nous appelons aujourd’hui ‘hindous’, pratiquants de l’hindouisme, se désignaient plutôt par leur appartenance à un courant dévotionnel centré sur une divinité considérée comme suprême et dispensatrice de salut : certains étaient vishnouites, dévots du dieu Vishnou, d’autres shivaïtes, adorateurs du dieu Shiva, d’autres shâkta, regroupés autour du culte de la Grande Déesse ou Shakti… etc. Aujourd’hui encore, de nombreux hindous se définissent de cette façon, le terme ‘hindou’ restant trop vague.
Ce sont des étrangers, les colonisateurs britanniques qui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, ont introduit ce terme d’hindouisme, pour regrouper sous une même rubrique, dans un souci de recensement et d’administration, cette diversité religieuse et sociale impressionnante – un morcèlement difficile à gérer sans aucun doute.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le terme ‘hindou’ n’a pas de connotation religieuse claire, il signifie d’abord ‘habitant de l’Inde’. C’est la colonisation, puis la volonté d’émancipation nationale, avec le mouvement pour l’indépendance indienne, qui imposent progressivement ce terme pour désigner les adeptes, extraordinairement divers, d’un système religieux dont l’unité n’est pas évidente.
Initialement, au XIXe siècle, cette désignation nouvelle, avec un usage religieux, les « hindous », concerne les adeptes des religions considérées comme autochtones, ceux qui ne sont donc ni musulmans ni chrétiens, pour ne citer que les deux grandes religions importées de l’extérieur dans cette zone du monde : la première, l’islam, depuis la période médiévale, la seconde, le christianisme, de manière plus marginale, surtout depuis l’arrivée des premiers Européens au XVIe siècle, avec les Portugais. Initialement, le colonisateur britannique, dans son entreprise classificatrice, ne considère pas le bouddhisme comme une religion distincte de l’hindouisme : le bouddhisme est né sur le sol indien et les adeptes du bouddhisme sont devenus ultra-minoritaires depuis la période médiévale, cantonnés dans les franges montagneuses de l’Himalaya et du Nord-est, du côté de la Birmanie.
Contrairement aux autres grandes religions du monde, il est vrai que l’hindouisme n’a pas de fondateur ou d’inspirateur unique, comparable à Bouddha, Jésus-Christ ou Mahomet. Mais il a pléthore de textes de référence, de textes fondateurs. Tous ces textes n’ont pas le même statut.
Théoriquement, les Veda, énorme corpus de textes très divers, sont la Parole sacrée, l’expression de la Réalité ultime. Ils sont le Savoir absolu, d’origine non-humaine, ce n’est pas l’enseignement d’un prophète ou le message direct de Dieu, mais la Réalité en soi, au-delà des multiples dieux du polythéisme hindou. Mais ces textes difficiles, composés dans une langue archaïque et souvent teintés d’ésotérisme, sont très peu accessibles et finalement très peu connus pour l’immense majorité des hindous.
À lire également
Vârânasî : le cœur battant de l’Inde
Pour la plupart de ceux que nous appelons « hindous » aujourd’hui, leurs textes sacrés sont de de vastes récits épiques, comme le Ramayana et le Mahabharata, qui sont transmis selon de nombreuses versions. Ainsi, pour une grande partie des hindous de langue hindi, laquelle domine dans les deux tiers nord de l’Inde, le Ramayana dans sa version composée au XVIe siècle par le poète mystique Tulsidâs est le texte religieux par excellence. Au Bengale, situé au nord-est du sous-continent, on se réfère beaucoup au Devî-Mâhâtmya, qui conte les exploits de la Déesse contre les démons. En pays tamoul, au sud de l’Inde, on connaît l’histoire de Râma par la version locale, due au poète Kamban, qui a composé son œuvre il y a environ mille ans. Combinant la morale, la vénération religieuse et la philosophie, la Bhagavad-Gîtâ est un des textes les plus emblématiques de l’hindouisme aujourd’hui. Inséré dans le vaste récit épique du Mahabharata, c’est une morale de l’action désintéressée, un exemple de relation dévotionnelle entre l’homme et sa divinité d’élection, une appréhension philosophique du monde, enseignés par Krishna, forme du dieu Vishnou, à son disciple et ami, le guerrier Arjuna.
On ne peut donner ici, à travers la mention de ces quelques titres, qu’une infime idée de la richesse et de la diversité des textes qui guident les adeptes de l’hindouisme. Aux grands textes, comme ceux évoqués ci-dessus, il faut ajouter une littérature religieuse en perpétuel essor, chaque maître religieux, les « gourous », pouvant ajouter ses propres textes au patrimoine existant.
L’hindouisme a de nombreux visages : dépourvu de tout temps d’autorité centrale unique – pas de pape, pas d’université Al Azhar de l’hindouisme -, il varie considérablement d’une région à l’autre, comme il a considérablement évolué au fil des siècles et des millénaires. Il existe aussi, à côté de l’hindouisme perpétué par les brâhmanes – ces prêtres, enseignants, savants de caste héréditaire -, une myriade de pratiques locales, populaires, qui ne sont pas fixées par des textes. Si l’on veut repérer les lignes de force d’une certaine unité de l’hindouisme, c’est surtout vers la culture brahmanique qu’il faut se tourner, vers ces grands textes fondateurs, dont nous avons mentionné quelques titres. L’autorité dans l’hindouisme, elle vient d’abord de ces textes, beaucoup moins d’institutions. Elle passe aussi par la relation qu’entretiennent la majorité des hindous avec un maître spirituel, qui les guide dans leurs pratiques, leurs croyances, leurs interrogations.
J’ai dit plus haut que l’hindouisme avait évolué au cours de son histoire, qu’il variait d’une région à l’autre du monde indien. Mais il ne faut pas voir cela comme contradictoire avec les efforts pour y repérer aussi de l’unité, par-delà cette diversité qui peut donner le tournis. De même, l’idée d’une unité du divin n’est pas absente de l’hindouisme, malgré le foisonnement de ses divinités innombrables.
De nos jours, un nombre grandissant d’hindous récuse ce terme d’origine étrangère et lui préfère celui de ‘sanâtani’, les adeptes du sanâtan dharma (qu’on peut traduire par ‘Loi éternelle’), ce système se pensant comme éternel, sans commencement ni fin.
Troisième religion pratiquée au monde, largement présente en Inde, l’hindouisme a-t-il un message universel ?
Quel peut-être le message universel d’une religion si diverse, si peu unifiée que l’hindouisme ?
Justement, la préoccupation d’universalité s’introduit dans l’hindouisme à partir du moment où il prend conscience de lui-même, en tant qu’univers religieux identifiable au-delà de son grand morcèlement. À partir du XIXe siècle, des réformateurs religieux au sein de ce système cherchent à s’adresser aussi aux non-hindous et entreprennent de guider les hindous sur les voies de l’universalisme. Mentionnons Râm Mohan Roy (1772-1833), qui essaie de transformer sa religion d’origine en un monothéisme non-idolâtre, tentative pour le moins ambitieuse… et vouée à l’échec. Dayânanda Sarasvatî (1824-1883) prêche un retour aux Vedas, pour, sans toutefois remettre frontalement en cause le polythéisme, recentrer le culte sur le feu sacré, s’affranchir d’une trop grande influence des castes et régionalismes dans la pratique religieuse, dans un souci d’inclusion et d’unification, dont l’un des buts est la reconversion d’ex-hindous, tombés dans le giron de l’islam ou du christianisme. Le mystique Srî Râmakrishna (1836-1886) montre le chemin d’une quête de Dieu par-delà les divergences de sectes, de traditions, de religions, et son disciple Vivekânanda (1863-1902) porte ce message universaliste hors du monde indien, en participant au Parlement des religions à Chicago en 1893, et en créant un ordre monastique voué à essaimer dans le monde entier. Au XXe siècle, plusieurs maîtres religieux hindous voyagent en Occident, voire s’y établissent, et fondent des mouvements universalistes. L’exemple le plus célèbre est l’Association internationale pour la conscience de Krishna, populairement connue sous le nom de ‘Hare Krishna’, fondée en 1966 par un dévot krishnaïte originaire du Bengale. Ce mouvement, qui pratique un prosélytisme actif dans le monde entier, mais aussi en Inde même, revendique un million de dévots.
Mais cette entrée en universalisme de l’hindouisme est un phénomène tardif dans son histoire longue de quelque quatre millénaires. Contrairement au christianisme ou à l’islam, l’hindouisme n’est pas originellement une religion de conversion. On dit souvent qu’on naît hindou, même si cela est quelque peu démenti par le prosélytisme des ‘gourous’.
Cette galaxie religieuse qu’on nomme hindouisme, si elle n’a pas pratiqué la conversion à grande échelle, a en revanche pratiqué l’inclusion de croyances, de divinités, de pratiques cultuelles. Ainsi, au fil des millénaires, de nombreuses divinités locales ont été affiliées à telle ou telle grande divinité de l’hindouisme, des communautés humaines se sont hindouisées, non par un rite de conversion, mais parce que leurs pratiques religieuses ont été au moins en partie reliées à la culture hindoue, en particulier par des récits mythiques.
À écouter également
Podcast : L’Inde, un géant méconnu. Anne Viguier
Historiquement l’hindouisme, avec le brahmanisme, c’est-à-dire l’hindouisme en tant que dirigé par les prêtres-enseignants brahmanes, s’est implanté dans de vastes territoires hors du monde indien. Une très grande partie de l’Asie du Sud-est, dès le IIIe siècle (des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge…), ont été des foyers d’expansion de l’hindouisme, qui y est encore quelque peu présent, même s’il a ensuite été supplanté par le bouddhisme ou l’islam.
Poser la question d’un ‘message universel’ de l’hindouisme place celui-ci de plain-pied avec les autres grandes religions du monde, notamment le christianisme et l’islam, qui, par leurs conquêtes et conversions de masse, ont grandement contribué à imposer l’universalisme comme une dimension incontournable de la religion.
Quel peut-être le message universel d’une religion si diverse, si peu unifiée que l’hindouisme ?
Au sein des innombrables textes religieux hindous, certaines des Upanishads, considérées comme le message ultime du Veda, et qui sont des textes spéculatifs, non-dogmatiques, permettent de définir un message à portée universelle : il existe un principe éternel qui sous-tend l’univers et ce même principe sous-tend tous les êtres, dont les humains ; ce principe, au niveau des êtres individuels et au niveau cosmique, est identique ; impérissable, il est unique et Réalité suprême. Connaître cette identité fondamentale est une délivrance, qui libère du monde des illusions, de la souffrance. Un autre message universel de l’hindouisme – d’où le succès international de certains gourous – est une conception du salut comme quête pour s’arracher au monde du désir et de la souffrance dans une fusion avec une divinité suprême dispensatrice de salut. Cela peut passer par la pratique de la méditation et du yoga, toute la gamme des attitudes dévotionnelles, enseignées par d’innombrables courants religieux hindous, où l’on retrouve souvent les grandes distinctions entre shivaïsme, vishnouisme et shaktisme, qu’il ne faut surtout pas voir comme des tendances sectaires toujours hostiles les unes envers les autres, même si cela peut aussi être le cas.
Tout a un commencement et une fin dans notre univers. Ce principe immuable est l’un des fondements de la religion hindoue, c’est pourquoi le Brahman, l’Absolu, est divisé entre la création, la préservation et la destruction. Comment expliquer l’importance de cette approche dans l’hindouisme ? Quelle est la finalité visée par les hindous ?
La vision du temps qui prévaut dans l’hindouisme est celle d’un éternel retour, organisé en grands cycles temporels. De même que les êtres naissent, vivent et meurent puis renaissent… etc. sans fin, de même l’univers en sa totalité, y compris les personnages divins, est soumis à la loi des renaissances. En ce sens, la création est en perpétuel mouvement. Ce qu’on appelle la « Trinité hindoue » est l’incarnation, en trois grandes divinités de chacun des moments constitutifs des cycles temporels cosmiques : le dieu Brahmâ préside à la création ; Vishnou veille à la préservation de la création : c’est pourquoi il est amené à s’incarner en avatâra (descentes dans le monde), sous formes animales ou humaines, pour sauver la création des dangers suscités par les appétits de pouvoir des démons et par le désordre qui s’introduit dans le fonctionnement de la Loi qui régit le monde (le dharma) ; Shiva est en charge de la destruction de l’univers à la fin d’un cycle, quand une sorte de cataclysme gigantesque brûle le monde. À ce titre, tout a un commencement et une fin… mais ce ne sont pas des moments absolus : les commencements sont toujours des re-commencements et les fins laissent toujours des restes qui généreront un nouveau départ, après un temps de latence.
Pour les hindous, il n’y a pas que de l’impermanence (c’est sans doute une des conceptions fondamentales qui les réunit dans leur vertigineuse diversité) : l’Âtman-Brahman, l’Absolu, n’est pas affecté par ces bouleversements qui ponctuent la vie de l’univers comme celle des êtres individuels. C’est justement là un point qui distingue radicalement la pensée bouddhiste de la pensée hindoue : pour la première, il n’y a en effet que de l’impermanent.
Krishna explique à Arjuna dans la Bhagavad-Gîtâ : « Jamais nous n’avons cessé d’être et jamais nous ne cesserons d’être. Comme on passe en son corps de l’enfance à l’âge adulte puis à la vieillesse, de même passe-t-on d’un corps à un autre… Le non-être n’existe pas. L’être ne cesse jamais. »
Dans le cadre de cette conception du monde comme éternel recommencement, la question du salut est très majoritairement pensée en ces termes : comment échapper à ce perpétuel enchaînement de vies, morts et renaissances ? Les voies enseignées pour y parvenir sont multiples et cette multiplicité reflète la diversité de l’hindouisme.
Pour la grande majorité des hindous, la perspective de salut demeure cependant lointaine. On espère une meilleure renaissance pour la suite, ce qui s’obtient par des actions conformes à la Loi (dharma). Mais souvent l’attitude est double : à ce souci de préparer une bonne réincarnation, par des actes méritoires, par l’accomplissement des rites, se combine, à travers l’adhésion à un courant dévotionnel, à l’enseignement d’un maître, une recherche du salut plus ou moins poussée, dont on espère qu’elle mènera à une sortie du flux des renaissances.
L’hindouisme est une religion où les rites, les sacrements, le culte des ancêtres, les offrandes aux divinités, sont extrêmement présents et importants. L’activité rituelle a lieu dans les temples, mais aussi beaucoup à la maison, quotidiennement. Mais d’un autre côté l’hindouisme inclut, depuis des temps très anciens déjà, un regard critique sur la valeur du ritualisme. Car les rites, en ce qu’ils ont pour principal objet de perpétuer l’ordre du monde, maintiennent ceux qui les pratiquent dans le flux des renaissances et, à ce titre, font obstacle au salut, en tant qu’il consiste à s’extraire de ce flux.
Une grande partie de la pensée hindoue vise à résoudre cette contradiction. La Bhagavad-Gîtâ et bien d’autres textes religieux de l’hindouisme enseignent en ce sens comment il faut articuler les actes (l’acte rituel étant l’acte par excellence) et la quête du salut. Ainsi Krishna réconcilie son disciple, le guerrier Arjuna, avec l’action : renoncer à agir est illusoire, car agir, parce que nous sommes mus par le désir, est inséparable de la vie ; mais il faut agir scrupuleusement selon son devoir, tel que la Loi le fixe (et ce n’est pas le même devoir pour un guerrier, un prêtre, un agriculteur ou un serviteur) et en même temps agir en renonçant au bénéfice pour soi de ses actions. Arjuna ne va pas combattre pour sa gloire ou pour exercer le pouvoir, mais pour le salut du monde et l’intégrité de la Loi. De plus, il va s’en remettre avec une totale confiance à la dévotion pour Krishna, forme de Vishnou, mais qui lui apparaît en une théophanie saisissante comme tous les innombrables personnages divins simultanément.
C’est là un idéal hindou qui explique l’attitude religieuse de beaucoup d’hindous aujourd’hui, même s’ils ne sont pas tous familiers de la Bhagavad-Gîtâ.
Pour les hindous, l’homme n’a ni commencement ni fin, il n’est qu’un moment de l’ordre sacré universel. La mort humaine ne représente qu’un passage de l’âme d’un corps à un autre. Ainsi, selon leurs bonnes ou mauvaises actions au cours de leur vie, le karma, les hommes sont soumis au cycle des réincarnations. Sur quoi se fonde la morale hindoue ? Quel est le fonctionnement de la réincarnation ?
Théoriquement, en fonction du mérite ou de la nocivité de ses actes selon son dharma propre, l’être est promis à renaître à un échelon plus ou moins honorable de l’échelle des êtres vivants.
Il est certain que la morale hindoue est conditionnée par la loi du karma, la « loi des actes ». Rappelons que la croyance en la réincarnation, en la loi du karma, n’est pas propre à l’hindouisme. Elle a aussi cours chez les bouddhistes et plus généralement dans une grande partie de l’Asie.
À propos de la morale hindoue, elle est d’abord une conformité des actes avec le Dharma, cette Loi éternelle, qui se veut d’abord fondée sur les Vedas. Un point très important : cette Loi ne s’adresse pas indistinctement à tous les êtres humains. Les préceptes à respecter ne sont pas les mêmes selon qu’on est femme ou homme, selon qu’on appartient à telle ou telle des quatre classes humaines de base, ou telle et telle caste. Le Dharma n’a pas de valeur universelle. Il n’y a pas de Bien et de Mal, identiques pour tous les êtres humains ; il y a l’accomplissement des devoirs et l’exercice des prérogatives dues à l’appartenance à tel ou tel groupe humain, l’un ou l’autre sexe ; il y a aussi le Dharma exceptionnel des temps de grande catastrophe (guerre, famine… etc.) qui légitime des entorses à la Loi pour cause de survie. Théoriquement, en fonction du mérite ou de la nocivité de ses actes selon son dharma propre, l’être est promis à renaître à un échelon plus ou moins honorable de l’échelle des êtres vivants.
Mais on ne trouve nulle part de théorie détaillée de la réincarnation. Le karma, la somme de nos actes, ceux de nos vies antérieures innombrables, est quelque chose de trop complexe et de trop individuel pour qu’il puisse être absolument prévisible. Mais, selon la Loi, les châtiments encourus pour nos infractions sont de deux ordres : les châtiments infligés dès cette vie en cours, par la justice humaine, et ceux qui affecteront, du fait de la loi du karma, une quantité plus ou moins grande de nos vies futures, selon la gravité de l’infraction.
À lire également
Une autre dimension complexifie la morale hindoue. Théoriquement, les règles de comportement ne sont pas les mêmes selon les âges de la vie. Idéalement, la vie humaine se déroule en quatre âges bien distincts, de la période des études, dominée par la chasteté et la frugalité, à la vieillesse qui est vécue comme une retraite hors du monde des rites et des rapports sociaux, puis un renoncement total à toute vie mondaine, en passant par un âge adulte dédié à la prospérité et à la reproduction. Même si, dans le monde d’aujourd’hui, cet idéal des étapes de la vie, qui n’a sans doute jamais été vraiment généralisé, est loin de la réalité, il n’en demeure pas moins une source de repères pour évaluer le déroulement de la vie d’un individu. De même, les traités de Dharma enseignent que la vie humaine a quatre buts : en premier le dharma lui-même, qui inclut ce que nous appelons la morale et la religion, la vie rituelle ; en second, la poursuite de la prospérité matérielle ; ensuite, cultiver les plaisirs, dont le plaisir sexuel, le but final du point de vue de la Loi étant d’engendrer une postérité ; enfin le quatrième but, non-mondain, est celui de rechercher la délivrance (avec cette ambivalence : s’agit-il d’une bonne renaissance ou d’une échappée du flux des renaissances ?).
Concluons cette réponse sur la morale hindoue en remarquant que le bon accomplissement des devoirs que fixe à chacun la Loi, selon son positionnement dans la société, est dit générer une félicité immédiate.
Pour les hindous, le but suprême de la vie est de se libérer du cycle des réincarnations par la délivrance (moksha). Comment arrêter ce mouvement sans fin et atteindre la délivrance ?
On l’aura compris avec ce qui a été dit plus haut, ce quatrième but de la vie humaine, moksha (la délivrance), reste un horizon lointain pour beaucoup d’hindous. Mais les maîtres spirituels, les gourous, sont là pour leur rappeler qu’il ne faut pas négliger ce but. Certains hindous, très minoritaires, choisissent de s’y consacrer très tôt dans leur vie et abandonnent famille et carrière professionnelle, tous les liens sociaux, pour s’y vouer entièrement : ce sont les sannyâsi ou sâdhu, les renonçants, qui vivent isolés ou regroupés en ordres monastiques. Ils sont à la fois admirés, vénérés et craints, car on leur attribue des pouvoirs hors du commun. D’autres hindous adoptent un mode de vie mixte : on peut être marié, avoir des enfants et une profession, tout en pratiquant des formes d’ascétisme et de renoncement selon des règles précises.
Les chemins qui mènent à la délivrance sont nombreux. La délivrance peut n’être accessible qu’à travers la mort : le dévot espère qu’au moment de quitter ce monde, sa divinité d’élection le délivrera, c’est-à-dire qu’au lieu de vivre une énième réincarnation, il échappera au flux de la transmigration en se fondant totalement en sa divinité, ce qui se formule aussi en termes plus concrets de cette façon : rejoindre le « paradis » de Vishnou, par exemple.
La vie religieuse hindoue, pour l’immense majorité, est double : d’un côté l’activité rituelle, très riche et complexe, à laquelle se combine le respect de la Loi du Dharma, vise à perpétuer le monde et à gagner de bonnes renaissances ; de l’autre, la poursuite de moksha, la délivrance, peut occuper plus ou moins de place, et être menée de manières fort diverses.
L’une des principales caractéristiques culturelles de la population indienne est celle des castes. Ce système de division sociale dérive-t-il de la religion hindoue ?
L’origine de l’organisation en castes de la société hindoue reste l’objet de nombreuses spéculations. Et la question du lien entre cette organisation sociale et la religion a été prétexte à de nombreuses polémiques à l’époque contemporaine.
Rappelons que la caste à l’indienne est un groupe social fermé, auquel on appartient par sa naissance, de manière héréditaire et immuable. Cela implique qu’on se marie normalement dans sa caste. Ajoutons à cela que les castes indiennes se définissent aussi par l’exercice d’une profession ou d’un groupe de professions héréditaires, même si, dans la pratique, surtout à notre époque, la profession réelle et la profession traditionnelle de caste ne coïncident pas toujours. Beaucoup de brâhmanes, censés être des prêtres-enseignants par leur appartenance de caste, sont en fait banquiers, ingénieurs, employés de bureau, cuisiniers, liftiers, commerçants… Des gens issus des basses castes, cantonnées aux fonctions de serviteur selon leur appartenance de caste, sont aujourd’hui médecins, enseignants, politiciens, chefs d’entreprise, militaires, bureaucrates… Le système a une apparence rigide, mais une réalité non dépourvue de souplesse. Théoriquement un hindou ne peut pas changer son hérédité de caste, mais sa position économique et sociale, son pouvoir politique, n’est pas entièrement et définitivement déterminé par sa naissance dans telle ou telle caste. Cette réalité s’est sans doute accentuée dans l’Inde indépendante, depuis 1947, mais elle existait dès avant.
Les textes religieux de l’hindouisme ne parlent guère des castes, en tout cas ne présentent pas d’explication précise des castes telles que nous pouvons les observer dans la société hindoue, au moins depuis la période médiévale. Dans les textes fondateurs de l’hindouisme, on légitime l’organisation sociale de la société régie par la Loi éternelle (Dharma) en la fondant sur une stricte hiérarchie de trois classes fondamentales : préséance aux brâhmanes (les enseignants-prêtres), viennent ensuite les guerriers-rois, puis les producteurs de biens matériels (agriculteurs, éleveurs, prêteurs…). À ces trois classes, qui ont un rôle social et religieux supérieur, s’ajoute une quatrième classe : les serviteurs, voués au service et au respect des trois classes supérieures.
Ces quatre classes humaines ne concernent que l’organisation de la « bonne société », selon l’idéal brahmanique, tel qu’il est illustré par des textes comme le Ramayana et le Mahabharata, la Bhagavad-Gîtâ…etc. Le reste de l’humanité n’est pas concerné par cette hiérarchisation et cette répartition des tâches.
À lire également
L’Inde renonce à sa réforme agraire
L’articulation entre ce système de quatre classes idéales, vues comme la base du bon fonctionnement de la société, et la réalité des milliers de castes de la société hindoue n’est pas évidente. Théoriquement chacune de ces castes est affiliée à l’une des quatre classes originelles certes, mais comment expliquer cette démultiplication des castes ? Les différences régionales y ont un rôle, puisque le système social hindou s’étend sur une aire très vaste, aux dimensions d’un continent. Mais l’explication interne au système la plus communément avancée est que les castes se sont multipliées à cause de mélanges, c’est-à-dire de mariages, pourtant théoriquement interdits ou dévalorisés, entre des hommes et femmes appartenant à des classes différentes. L’identification du développement des castes dans ce mélange des classes – une entorse à la Loi – relève du pragmatisme : un idéal n’est jamais entièrement respecté, les êtres nés de ces unions illicites doivent se voir assigner une place dans la société, fût-elle très basse. À cela s’ajoute la question d’une dégradation de l’application de la Loi au fil de chaque cycle de la création : nous sommes à présent à la dernière des quatre ères qui structurent chaque cycle de la création, chacune de ces ères se caractérisant par un respect amoindri de la Loi. Il n’est donc pas étonnant qu’en ce dernier âge, l’imperfection régnant, les classes se soient abondamment mélangées, ce qui a généré un morcellement de la société hindoue en une multitude de castes.
À cette complexité, il faut ajouter que l’hindouisme ayant englobé au fil du temps de nombreux groupes humains (par exemple une partie de ce qu’on appelait du temps des Britanniques les populations tribales, habitants des zones forestières notamment), il existe aussi à la marge du système des castes de nombreuses communautés, qui peuvent être vues comme partiellement hindoues du point de vue religieux, et non pleinement intégrées dans la cartographie des castes. Il existe aussi des communautés ou sectes religieuses à l’intérieur de l’hindouisme ou à ses marges, qui fonctionnent en partie comme des castes. De même qu’il est difficile de définir simplement l’hindouisme en tant que religion, il n’est pas simple de considérer l’organisation sociale hindoue comme un système parfaitement cohérent.
Mais parler des castes conduit à aborder la manière dont ce système est perçu à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de la société hindoue.
Avec de fortes nuances d’une région à l’autre de l’espace hindou, la question des castes génère de fortes tensions sociales et est un des moteurs de la vie politique dans la République indienne, depuis les lendemains de l’indépendance en 1947. On peut parler d’un mouvement anti-brâhmanes, qui existe bien avant l’indépendance, dès la fin du XIXe siècle, dans certaines parties du pays, notamment dans le Sud, au Tamil-Nadu. Avec le mouvement des « Intouchables », dont le Dr Ambedkar (1891-1956), l’un des pères de la constitution indienne adoptée en 1950, est la figure emblématique, la contestation sociale en faveur d’une réhabilitation des plus basses castes, se double d’une critique religieuse. L’hindouisme, stigmatisé comme religion des brâhmanes et des hautes castes, est rejeté au profit de ce qu’on appelle le « néo-bouddhisme ». Pour Ambedkar et ses partisans, le système hiérarchique des castes et l’intouchabilité étant consubstantiels à l’hindouisme, la solution pour les parias du système serait de le quitter, d’où l’adhésion au bouddhisme, considéré comme une religion égalitaire. Mais tous les hindous, même de basses castes, sont loin de rejoindre ce « néo-bouddhisme » inventé comme alternative à l’hindouisme. C’est sans doute que l’hindouisme est suffisamment divers pour que même les laissés pour compte de la hiérarchie des castes y trouvent une place. Il faut rappeler que l’hindouisme dévotionnel, tel qu’il existe depuis la période médiévale, offre des échappatoires aux prérogatives religieuses des brâhmanes. Le réformisme et revivalisme hindou tel qu’il se met en place à partir du XIXe siècle a une dimension sociale importante, qui atténue les injustices du brahmanisme le plus strict.
Dans l’Inde du XXIe siècle, certains partis politiques font leur miel du clientélisme de caste. À gauche prospère un anti-hindouisme, qui identifie entièrement brahmanisme et hindouisme. Cette hostilité, nourrie par l’idéologie d’Ambedkar, voit dans l’hindouisme un système socioreligieux à rejeter, parce que foncièrement inégalitaire. Dans le même temps, cette gauche est fort complaisante à l’égard de l’islam, vu comme une religion égalitariste, ce qui est oublier bien vite d’autres types d’inégalités véhiculés par cette religion.
Certains Indiens, militants du mouvement dalit (des « opprimés ») comme on dit aujourd’hui, et leurs soutiens de gauche, mènent campagne pour identifier leur combat à celui des Afro-américains aux États-Unis, s’inspirant largement du mouvement woke.
Rappelons que l’Inde est un pays qui pratique largement, depuis des décennies, une politique de discrimination positive en faveur des castes les moins favorisées avec des quotas d’emplois réservés, des places dans les institutions d’enseignement, des sièges dédiés dans les assemblées élues de la démocratie indienne. La République indienne a élu par deux fois des présidents d’origine intouchable : Kocheril Raman Narayanan (1997-2002) et Ram Nath Kovind (2017-2022).
On le voit, si l’hindouisme a une dimension sociale forte et inégalitaire, il comporte aussi en son sein des contrepoids aux injustices du système, et les politiques sociales mises en place, parfois dès avant l’indépendance, ont apporté des correctifs sensibles aux effets de la hiérarchie des castes. Et cette évolution est sans doute loin d’être arrivée à son terme.
L’hindouisme est une religion polythéiste. Bouddha est la neuvième incarnation de Vishnou, le dieu hindou de la stabilité du monde. Quelle relation existe-t-il entre le bouddhisme et l’hindouisme ? Quelles sont les principales différences ?
Il y a des variantes de la liste des dix avatars ou incarnations de Vishnou pour sauver le monde. Bouddha n’est pas toujours inclus dans cette liste. Originellement, sa place était occupée par Balarâma, frère aîné de Krishna. Il est probable que cette inclusion de Bouddha dans la liste des dix avatars de Vishnou (liste qui peut être beaucoup plus longue selon les textes consultés) soit une sorte de récupération par le brahmanisme d’une grande figure de la civilisation indienne. Cela reflète cette capacité de l’hindouisme à absorber des personnages issus d’horizons différents, en les déifiant, en les reliant de manière plus ou moins appuyée au panthéon hindou.
Ce serait plus difficile avec le Christ ou Mahomet, prophètes de monothéismes, nés sous d’autres cieux. Mais Bouddha n’est pas un étranger et une grande partie des bouddhistes, dans les divers pays où le bouddhisme s’est répandu, vénèrent aussi des divinités d’origine hindoue. On peut l’observer jusqu’au Japon.
Il existe des divergences profondes entre l’hindouisme et le bouddhisme, sur le plan des idées, en particulier sur la question de l’existence d’un âtman éternel, que la mort physique n’affecte nullement, comme le soutient la philosophie brahmanique. Le bouddhisme ne reconnaît pas l’autorité des Vedas. Mais, on l’a évoqué plus haut, le rapport des hindous avec les Vedas est loin d’être simple. La conception du dharma, selon les bouddhistes, est émancipée du cloisonnement de la société en quatre classes fondamentales. La suprématie des brâhmanes n’a donc pas cours dans la société bouddhiste. La langue sanskrite, langue sacrée de l’hindouisme parce qu’elle est la langue des Vedas, n’a pas une place d’exception pour les bouddhistes.
En même temps, les bouddhistes partagent beaucoup de rites avec les hindous : comme eux, ils brûlent leurs morts. Ils peuvent révérer des divinités issues de l’hindouisme, même si le rapport qu’ils entretiennent avec ces personnages divins n’est pas identique à celui des hindous.
À lire également
Bouddhisme et islam, un affrontement inévitable ?
Certes, à notre époque contemporaine de crispations religieuses, les bouddhistes du monde indien n’apprécient pas que leur religion soit vue comme un avatar de l’hindouisme. Depuis qu’a émergé le néo-bouddhisme des disciples d’Ambedkar, la distinction entre bouddhisme et hindouisme a pris un tour politique. Il n’en reste pas moins que, du point de vue hindou, Bouddha et les bouddhistes ne sont pas vus comme des ennemis, mais au contraire comme des adeptes de quelque chose de très proche de l’hindouisme. Et celui-ci est suffisamment varié et inclusif pour que cela ne pose aucun problème que Bouddha ait sa place dans la liste des avatars de Vishnou.
En Inde, la religion hindoue est largement majoritaire puisqu’elle concerne près de 80% de la population. Quel rapport entretient l’hindouisme avec le pouvoir politique ?
La religion est omniprésente en Inde. Les religions minoritaires, qui sont très nombreuses, ont aussi une grande visibilité, à commencer par l’islam, avec 16 % de la population du pays. Dans la culture hindoue, selon la Loi éternelle (Dharma), la classe des prêtres-enseignants, les brâhmanes, détient le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel est exercé par la classe des guerriers (du moins théoriquement). Mais cette stricte répartition des rôles associe étroitement les uns et les autres : dans l’idéal brahmanique, les rois ne peuvent pas gouverner sans les conseils des brahmanes ; les brahmanes, spécialistes de la Loi et de son interprétation, exercent aussi le pouvoir judiciaire. Les récits épiques du Ramayana et du Mahabharata, souvent considérés comme récits-fondateurs de l’hindouisme, sont des illustrations de la complémentarité des rois et des brâhmanes, ceux-ci gardant la préséance.
En 1950, l’Union indienne s’est dotée d’une constitution dont la laïcité de l’État est un des principes essentiels. Cela signifie qu’il n’y a pas de religion d’État. Mais attention ! il ne s’agit pour autant de la laïcité à la française ! Chez nous, l’État garantit la liberté de culte, les lois et principes des diverses religions ne sont nullement reconnus par l’État et n’ont donc aucune valeur juridique, l’État traite les croyances religieuses comme des opinions qui n’ont pas droit à un traitement particulier. C’est pour cela qu’en France le mariage religieux n’a pas de validité légale et qu’on ne peut concevoir de loi anti-blasphème dans notre République. La laïcité à l’indienne (on utilise le terme anglais de secularism) signifie que l’État est bienveillant envers toutes les religions et qu’il n’en privilégie aucune : d’où les jours fériés particulièrement nombreux en Inde, chaque religion ayant droit aux siens, par ordre d’importance numérique, ce qui fait évidemment la part belle aux hindous et aux musulmans, ensuite aux chrétiens, aux bouddhistes, aux sikhs… Mais, à la différence de la loi française, la loi indienne ne traite pas les croyances religieuses en opinions ordinaires : les religions ont droit à une protection juridique particulière, le Code pénal indien punit les « atteintes au sentiment religieux ». Et surtout, en matière de droit civil, on a un système très complexe où certaines communautés religieuses gardent des prérogatives liées à leur loi religieuse particulière.
Quelques années après l’indépendance, le gouvernement de Nehru a profondément réformé le code civil pour les hindous, la majorité de la population. Par exemple, la polygamie, qui était possible jusque là au sein de la société hindoue, a été proscrite. Mais on n’a pas osé toucher aux codes civils séparés concernant d’autres religions, en particulier l’islam. De nos jours, la polygamie reste donc possible pour un musulman indien, le divorce des musulmans n’est pas régi par les mêmes dispositions que celui des hindous ou des chrétiens… etc.
Cette laïcité à l’indienne est en grande partie un héritage britannique, mais aussi le produit des circonstances qui ont donné naissance à l’indépendance de l’Inde britannique, en 1947. Face au frère ennemi, le Pakistan, un État pour les musulmans, les dirigeants du Congrès, Nehru et ses successeurs, ont toujours manifesté une volonté de ne surtout pas paraître avantager la majorité hindoue du pays, de mettre en avant la laïcité – mais une laïcité surtout conçue en termes d’attentions spéciales accordées aux minorités religieuses, à commencer par la minorité la plus nombreuse et la plus chatouilleuse sur ses prérogatives, environ un septième de la population du pays – la grosse minorité musulmane, qui fait de l’Inde, numériquement, le deuxième pays musulman, après l’Indonésie.
L’hindouisme, cette religion éclatée, sans institutions centralisées, ne saurait entretenir de relation avec le pouvoir politique. Mais celui-ci, comme le montre l’action du BJP, peut manifestement trouver dans l’hindouisme un puissant socle sur lequel fonder une politique.
Comme beaucoup d’hindous, les politiciens indiens ont souvent un gourou, qui les guide religieusement, mais peut aussi occuper la fonction de conseiller spécial officieux. Des partis communistes qui ont été au pouvoir dans certains États de la Fédération indienne n’ont jamais fait obstacle à la pratique hindouiste, ils ont même cherché à se concilier la bienveillance d’institutions hindoues, de leaders religieux hindous. L’importance de la religion est telle dans le pays qu’aucun parti, même marxiste, ne peut se permettre d’affronter directement les religions, encore moins de prôner ouvertement l’athéisme. Toutefois, les partis de gauche, comme le Congrès, ont pratiqué de plus en plus une politique électoraliste visant à se concilier les faveurs de l’importante minorité musulmane, réputée soudée, influençable à travers ses leaders religieux – bref, un réservoir de voix très fiable. Dans l’État du Bengale-Occidental, où les communistes ont occupé le pouvoir très longtemps (1977-2011), ils ont favorisé et exploité l’afflux de migrants venus du Bangladesh voisin, à majorité musulmane.
À partir des années 1990, l’échiquier politique indien a été bouleversé par l’arrivée en force du parti actuellement au pouvoir, le BJP, et son programme, sur lequel on colle l’étiquette de « nationalisme hindou », ce qui renvoie à la notion idéologique nommée en hindi ‘hindutva’. Je remarque que l’intelligentsia nord-américaine, et européenne dans la foulée, se plaît à traduire ce terme par le très polémique « suprémacisme hindou », qui a des relents de Ku-Klux-Klan. La traduction neutre de ce terme serait : « hindouïté », c’est-à-dire ce qui caractérise l’appartenance à l’Inde, avec certes l’ambiguïté du terme ‘hindou’, qui peut désigner globalement les natifs de l’Inde et plus précisément les adeptes de l’hindouisme.
Il est certain que, depuis que le BJP est au pouvoir (depuis 2014, après un mandat en coalition de 1998 à 2004), la religion hindoue et, par-delà la question de l’identité religieuse, la question de l’hindouïté et la question du sens de la nation indienne, occupent un espace central dans la vie politique du pays, surtout au niveau fédéral (la situation est beaucoup plus nuancée dans les divers États de la Fédération).
À lire également
Le nationalisme hindou vu depuis l’Inde. Entretien avec Ram Madhav
Le BJP a monté les marches du pouvoir dans le contexte du déclin du parti du Congrès, le parti historique du mouvement pour l’indépendance. Les errements de ce parti dans son obsession de se concilier le vote musulman ont lassé une grande partie de l’électorat hindou. L’enlisement au Cachemire et les crises dans d’autres parties de l’Inde (Penjab, Assam…) sont imputables à ces errements congressistes. Face au BJP conquérant, le Congrès essaie aujourd’hui d’incarner la démocratie menacée : mais tout le monde n’a pas oublié que le Congrès d’Indira Gandhi a gouverné deux ans le pays sous un état d’urgence redoutable (1975-1977), où de très nombreux opposants de tous bords ont été emprisonnés et torturés. Le Congrès se présente de nos jours comme le protecteur des minorités religieuses : mais tout le monde n’a pas oublié les pogroms anti-sikhs de 1984, au lendemain de l’assassinat d’Indira Gandhi, actes dont les responsables n’ont jamais été poursuivis.
Le BJP est arrivé au pouvoir avec son programme de reconstruction de la nation indienne sur la notion d’hindouïté à un moment de crise identitaire pour cette jeune nation (à peine cinquante ans à l’époque). Un moment qui est aussi celui de l’entrée de l’Inde, jusqu’alors très autarcique économiquement, dans la mondialisation. Un moment de bouleversement géopolitique, où l’Inde ne pouvait plus compter sur les avantages qu’elle tirait de sa position équilibriste entre l’Union soviétique et le camp occidental. Un temps de montée en puissance de l’islamisme politique et terroriste dans le monde. Un voisin chinois de plus en plus riche, de mieux en mieux armé et de plus en plus sûr de lui pour concurrencer l’hégémonie américaine. Une situation de progrès économique accéléré, quand l’Inde est devenue le « bureau du monde », quand l’agriculture et l’industrie indiennes sont entrées en concurrence avec le reste du monde. Au tournant des deux siècles, l’Inde est devenue un pays riche, attirant pour l’économie mondialisée. L’énorme classe moyenne indienne se pense de plus en plus sur un plan d’égalité avec celle des pays développés de longue date. Dans ce contexte en évolution rapide, la gauche est en déclin, de plus en plus obnubilée par la défense des minorités, de moins en moins apte à fédérer des majorités.
Difficile de dresser une liste exhaustive des raisons qui ont conduit le BJP à apparaître à une majorité grandissante de l’électorat indien comme une alternative crédible, solide, cohérente, aux menaces de dislocation, de perte d’identité et d’enlisement dans les conflits séparatistes internes, que le Congrès et ses alliés de gauche n’ont pas pu repousser.
L’hindouisme, cette religion éclatée, sans institutions centralisées, ne saurait entretenir de relation avec le pouvoir politique. Mais celui-ci, comme le montre l’action du BJP, peut manifestement trouver dans l’hindouisme un puissant socle sur lequel fonder une politique.
Premier ministre depuis 2014, Narendra Modi a fait de l’hindouisme l’étendard de toutes ses batailles électorales. Son parti, le BJP, est un parti nationaliste qui encourage la protection et la diffusion de la culture hindoue, souvent au détriment des autres religions présentes en Inde. N’est-ce pas là une contradiction avec le préambule de la Constitution indienne proclamant une république « socialiste et laïque » ? Quelle est la perception de la « nation » en Inde ?
La politique du BJP se déploie-t-elle au détriment des religions minoritaires ou au détriment des avantages électoralistes pour cajoler les minorités religieuses (en pratique surtout la minorité musulmane dont on sait le poids) ? Le communautarisme est-il du côté du BJP, soucieux de rompre avec la politique congressiste qui donnait souvent le sentiment d’ignorer l’identité hindoue de l’Inde, ou est-il du côté de ceux qui traitent les minorités comme des réservoirs de voix ou bien des outils pour fracturer une nation ?
La perception que donnent de Narendra Modi, l’actuel Premier ministre de l’Inde, la plupart des médias occidentaux reflète avant tout deux choses : d’abord une méconnaissance profonde du monde indien et de la politique indienne, certes très complexes. En découle également une attitude qui concerne à coller des étiquettes dans l’air du temps : populisme, nationalisme, fascisme, démocrature, illibéralisme… etc. Ces étiquetages semblent tenir lieu d’analyse, alors qu’ils sont des anathèmes, ce qui ne fait pas avancer la compréhension des lecteurs occidentaux, au sujet d’un monde qui les déroute facilement.
À lire également
Le nationalisme hindou : histoire et fonctionnement
Parmi toutes ces étiquettes, dont on affuble le gouvernement indien actuel, celle qui suscite le débat le plus intéressant est la question du nationalisme. Nationalisme est devenu un gros mot en Europe, depuis les traumatismes des deux guerres mondiales du 20e siècle. L’Europe est constituée d’États-nations, pour la plupart bien plus vieux que l’Inde, en tant que telle. L’Europe est engagée depuis les années 1950 dans un processus d’union de ces nations jadis rivales, voire ennemies, pour construire laborieusement un ensemble capable de peser plus efficacement face au reste du monde. En Inde, comme dans la plupart des jeunes nations nées de la décolonisation, le nationalisme n’est pas une vieille sornette. Et dans le cas de l’Inde, les choses sont particulièrement compliquées pour deux raisons : l’indépendance a été marquée par la partition du pays en deux États. L’un, revendiquant une identité religieuse : le Pakistan. L’autre, apparaissant comme ayant subi cette partition, et obsédé par la volonté de ne surtout pas être perçu comme une nation définie par la religion : l’Inde.
Ces États, nés de l’Inde britannique, très morcelée, sont les héritiers de l’impérialisme britannique. La nation indienne n’avait jamais existé, antérieurement à 1947. L’idée avait germé chez les acteurs du mouvement indépendantiste, depuis la fin du 19e siècle. Mais, à partir du 15 août 1947, tout était à faire pour construire une nation indienne (et c’était à peu près la même situation du côté pakistanais, en dépit de la religion).
Une multitude de langues : l’hindi n’a jamais été accepté par tous comme langue nationale, en dépit de son statut de langue officielle. Une mosaïque de religions, avec certes une religion très majoritaire, mais elle-même fortement fragmentée. Ajoutons à cela l’importance du morcellement de la population en castes, ethnies, communautés, sectes… etc. Un grand nombre d’États princiers qui, sous les Britanniques, fonctionnaient avec beaucoup d’autonomie. Et n’oublions pas l’hostilité du voisin pakistanais, le « frère-ennemi », qui a dès 1948 mis la main sur une partie du Cachemire, sous le prétexte qu’il est de majorité musulmane. Un voisin pakistanais fortement encouragé et soutenu par le camp occidental au moins jusqu’aux années 2000, pour contrer l’Union soviétique et la Chine communiste, à l’origine, et par défiance envers les dirigeants indiens soupçonnés d’être des partenaires peu fiables dans le contexte de la Guerre froide.
L’Inde indépendante est donc une nation à construire qui est simultanément un empire à préserver, le tout étant soumis à des forces centrifuges redoutables : régionalismes, séparatismes, castéisme, conflits religieux, tensions linguistiques…
Quand le BJP arrive au pouvoir, la construction de la nation indienne patine depuis longtemps : échec à se doter d’une langue nationale qui fasse l’unanimité, utilisation politique du communautarisme, échec du secularism à constituer une base au nationalisme… etc. En même temps, l’Inde en tant qu’empire connaît des risques de désintégration que ses voisins chinois et pakistanais, en première ligne, ne se privent pas d’attiser.
Le succès du BJP est d’abord une tentative de réponse à ces défis en redonnant un sens au nationalisme indien et en rapprochant au maximum les notions de nationalisme et d’impérialisme, aussi en pensant l’Inde comme une super-puissance à affirmer. Face à la manière de relever ce défi qui est celle de Narendra Modi et du BJP, l’attitude du Congrès et de ses alliés de gauche (qui n’en ont pas toujours été) est de considérer que l’avenir de l’Inde en tant que nation n’est pas une question fondamentale. Pour certains tenants de ce camp, il est probable que la dislocation de l’État indien est souhaitable, dans une perspective révolutionnaire. Quoi qu’on pense de cette option politique, il est évident qu’elle desservirait la majorité de la population indienne et présenterait des avantages pour les voisins malintentionnés de l’Inde.
Selon le programme de l’hindutva, il existe deux sortes de religions : celles qui sont nées sur le sol indien et les religions imposées par des occupations venues de l’extérieur. Le bouddhisme, le jainisme, le sikhisme, ne posent aucun problème parce qu’ils sont autochtones. Des religions ultra-minoritaires, mais venues d’ailleurs, je pense au zoroastrisme des parsis et au judaïsme, ne soulèvent pas de question : outre le nombre extrêmement faible de leurs adeptes, leur présence sur le sol indien, très ancienne, est le fait de diasporas, de réfugiés implantés très marginalement dans le monde indien.
Ce qui est problématique, c’est l’islam et le christianisme. L’islam, comme dans le reste du monde, est venu en Inde par de vastes conquêtes territoriales et l’installation pérenne de pouvoirs d’origine étrangère, à partir du 13e siècle, sur une partie grandissante du sous-continent, depuis le Nord-ouest jusqu’au Bengale, à l’Est, et une partie du Deccan. Même si la majorité de la population est restée hindoue, y compris dans des portions du pays très longtemps dominées par ces pouvoirs musulmans, la culture hindoue a beaucoup souffert durant tous ces siècles, au moins jusque vers le XVIIIe. Le plus frappant, c’est la destruction des grands temples hindous et d’autres institutions, telle l’université bouddhiste de Nalanda, vers 1200. Sur les ruines des temples ont jailli des mosquées, comme la tristement célèbre mosquée de Babri, construite au XVIe siècle à l’emplacement d’un temple que l’on pense situé sur le lieu de naissance de Râma, l’avatar humain du dieu Vishnou, héros de l’épopée du Ramayana.
Le roman national diffusé dans l’Inde indépendante, du temps du Congrès, cherchait à donner une vision très consensuelle de cette histoire, des relations entre hindous et musulmans, que les seuls Britanniques auraient perturbées dans leur intérêt. Destructions, massacres, étaient occultés au profit des raffinements de la civilisation indo-persane. Sous le BJP, ce beau roman est remis en cause. Cela fait des victimes collatérales, comme le chef-d’œuvre architectural du Taj-Mahal, qui semble embarrassant : comment accepter que le symbole de l’Inde soit un monument du passé musulman du pays ?
Difficile de se comprendre, de se tolérer, entre tenants d’un polythéisme exubérant et monothéistes rigoureux ; quand les uns refusent de consommer la viande bovine et quand les autres aiment sacrifier des bovins pour leur fête de l’Aïd. Difficile de construire une nation indienne intégrant pleinement les musulmans si une part significative de ceux-ci refusent l’adhésion à l’idéal nationaliste indien au motif qu’il ne serait pas compatible avec l’allégeance aux fondamentaux de l’islam, à plus forte raison si une partie des musulmans indiens soutiennent l’équipe pakistanaise plutôt que l’équipe indienne, lors des tournois de cricket qui passionnent les foules des deux pays ! On reproche souvent aux nationalistes hindous de considérer les musulmans comme des étrangers dans leur propre pays. Mais rappelons qu’il est de bon ton, dans les familles musulmanes, de revendiquer des ancêtres venus d’Arabie, de Perse ou d’Asie centrale, pour se distinguer de la masse des convertis à l’islam qui sont beaucoup issus des plus basses castes hindoues.
Le christianisme n’est pas traité sur le même plan que l’islam. Les chrétiens sont à peine plus de 2 % de la population. Lui aussi arrivé de l’extérieur, avec la colonisation européenne (même si de petites communautés chrétiennes existaient antérieurement), le christianisme n’a pas détruit des temples ou institutions religieuses. On doit à des missionnaires chrétiens les premiers livres imprimés dans des langues vernaculaires indiennes, et pas seulement des traductions de la Bible, mais, par exemple, la première version imprimée du Ramayana bengali, à l’orée du XIXe siècle.
Toutefois deux éléments de la présence chrétienne en Inde hérissent les nationalistes hindous : d’abord le prosélytisme, qui vise surtout des populations pauvres et marginalisées, les très basses castes, les ethnies minoritaires – justement une des cibles du revivalisme hindou actuel. Puis le fait que la présence chrétienne est perçue comme liée à la main de l’étranger : financements, travail d’ONG, le côté internationaliste de l’Église catholique… Officiellement les relations entre New Delhi et le Vatican sont bonnes, mais la méfiance est réciproque.
Le BJP a beau jeu de se faire un arbitre de laïcité en proposant de revenir sur l’existence de codes civils séparés, fondés sur la loi et les coutumes religieuses de la minorité musulmane. Aujourd’hui, c’est la gauche indienne qui défend l’existence de ces codes distincts, en invoquant les droits des minorités. Quelques rapprochements avec ce que nous vivons en Europe viendront sûrement à l’esprit de certains !
Il est vrai que la constitution adoptée en 1950 par la République indienne instaure le socialisme et la laïcité parmi les principes fondamentaux. Mais chacun sait que ces termes peuvent être interprétés de plusieurs façons. Quand on parle de socialisme, s’agit-il d’économie planifiée et très contrôlée par l’État, comme sous Nehru, ou de mise en place de politiques sociales qui cherchent à atténuer les inégalités sociales ? La laïcité à l’indienne, nous l’avons dit plus haut, est très éloignée de la laïcité à la française. Pour le BJP, qui ne remet pas en cause directement ce principe, au niveau de son discours, la laïcité a été dévoyée par les gouvernements congressistes, dans le sens d’un favoritisme au bénéfice des musulmans notamment. Le BJP a beau jeu de se faire un arbitre de laïcité en proposant de revenir sur l’existence de codes civils séparés, fondés sur la loi et les coutumes religieuses de la minorité musulmane. Aujourd’hui, c’est la gauche indienne qui défend l’existence de ces codes distincts, en invoquant les droits des minorités. Quelques rapprochements avec ce que nous vivons en Europe viendront sûrement à l’esprit de certains !
J’ai dit tout à l’heure que l’Inde était une nation en construction, encore en quête de son identité. J’ajouterais que la laïcité indienne est en reconstruction, après les errements des gouvernements antérieurs. Je crois que nul ne peut dire ce que donnera précisément cette reconstruction, qui n’en est qu’à ses débuts.
Le combat du nationalisme hindou est-il culturel ou cultuel ? En d’autres termes, l’hindouisme est-il davantage un système culturel qu’une religion pour les Indiens ?
Cette question nous invite à réfléchir sur la nature de l’hindouisme, dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui regroupe des éléments si divers : védisme, tantrisme, dévotion (bhakti), brahmanisme, formes populaires, la loi du dharma… etc. Nous l’avons dit au début, c’est l’intervention du colonisateur qui a intégré tout cela sous le nom d’hindouisme, pour en faire, pragmatiquement, une identité religieuse, comparable à l’identité chrétienne ou à l’identité musulmane. Ensuite la politique s’en est mêlée, dans le cadre du mouvement indépendantiste, et la majorité des Indiens a pris l’habitude de se ranger sous la bannière de l’hindouisme, face aux revendications des musulmans, telle la revendication d’un État séparé, le Pakistan.
Théoriquement, l’application de l’hindutva comme principe directeur de la nation indienne n’impose pas une conversion religieuse à l’hindouisme de la part des minorités religieuses allogènes (chrétienne et musulmane), mais exige une adhésion à la culture hindoue, considérée comme la culture originelle du pays.
L’inventeur de la notion d’hindutva (hindouïté), V. D. Savarkar (1883-1966), n’était pas du tout religieux et a été un critique virulent de certains aspects de l’hindouisme et des castes. Le nationalisme qu’il prônait devait être fondé sur la culture hindoue, englobant les religions autochtones comme le bouddhisme et le jaïnisme. Pour lui, être hindou consiste d’abord en une piété filiale à l’égard de la Mère-Inde, terre sacrée des ancêtres. Les hindous ont été dépossédés de leur terre et du pouvoir depuis des siècles, d’abord par des musulmans d’origine étrangère, puis par les Britanniques. Affaiblis par des siècles de domination et par leurs divisions, les hindous doivent s’unir, retrouver une fierté et bâtir une nation qui protège les hindous. Théoriquement, l’application de l’hindutva comme principe directeur de la nation indienne n’impose pas une conversion religieuse à l’hindouisme de la part des minorités religieuses allogènes (chrétienne et musulmane), mais exige une adhésion à la culture hindoue, considérée comme la culture originelle du pays. Concrètement, cela signifie que l’islam et le christianisme peuvent continuer comme cultes, mais que tout prosélytisme de leur part est banni, et que la pratique religieuse de ces minorités ne doit pas interférer avec la sphère culturelle publique. Comme l’immense majorité des musulmans et des chrétiens indiens sont des convertis, considérés comme d’ex-hindous, les efforts pour leur reconversion sont considérés comme légitimes et souhaitables, sans toutefois être absolument impératifs.
À lire également
Inde : large victoire du BJP aux élections locales
Dans la pratique du pouvoir, le nationalisme hindou aux commandes depuis une dizaine d’années respecte-t-il cet agenda ? Il me semble que le nationalisme hindou du BJP joue plus sur la fibre religieuse des 80 % de la population du pays que ne l’impliquerait la stricte application du programme de Savarkar. Visiter un temple, un ashram, un lieu de pèlerinage hindou, se montrer avec de saints hommes de l’hindouisme, est pour un leader politique indien porteur d’un retour sur investissement très rapide, auprès de la plupart des hindous. L’aspect culturel du nationalisme hindou est un projet de plus longue haleine. Mais le programme culturel inspiré par Savarkar est indéniablement mis en place depuis 2014 : efforts pour recentrer le patrimoine du pays sur l’héritage hindou, au détriment de ce qui est dû à la présence musulmane ; révision des manuels d’enseignement de l’histoire pour réhabiliter la part hindoue dans celle-ci ; campagnes contre la consommation de viande bovine, contre les mariages de filles hindoues avec des musulmans (ce que la rhétorique nationaliste désigne sous le nom de love-djihad) ; contrôle accru des financements étrangers et des liens extérieurs des ONG… etc.
Rappelons que l’Inde est un État fédéral, les gouvernements provinciaux ayant des pouvoirs étendus, en matière d’éducation, de culture, même de police. Le programme nationaliste du BJP ne se concrétise donc pas de la même manière partout dans le pays. Des gouvernements locaux d’opposition au BJP restent bien ancrés dans le Sud et au Nord-est, foyers de résistance au nationalisme et bastions de régionalismes anciens. L’Inde est une nation en chantier qui n’avance pas à la même vitesse partout. Les forces d’opposition au nationalisme hindou ne sont pas cantonnées à l’Inde, comme en témoigne le livre de Rajiv Malhotra et Vijaya Wiswanathan, Snakes in the Ganga, Breaking India 2.0 (2022). À travers l’influence de l’internationale wokiste, l’hindouisme est devenu une cible pour le gauchisme, particulièrement aux États-Unis, après Israël et le sionisme. Cette « hindouphobie » est certainement à prendre en compte, dans la perspective d’une déconstruction du concept d’«islamophobie».
Pour les Indiens adeptes de l’hindouisme, celui-ci est vécu au quotidien par des rites, des visites dans les temples, les ashrams, par la participation à des cultes et à des assemblées religieuses. La question d’une distinction entre le cultuel et le culturel ne se pose nullement. Le nationalisme hindou du BJP et de Narendra Modi prétend être la seule forme possible de nationalisme indien, après l’échec de Nehru et de ses descendants à faire de l’Inde une nation et à préserver durablement la cohérence de l’héritage impérial britannique. Pour cela, il importe, idéologiquement, de ne pas cantonner l’hindouisme à la stricte sphère religieuse.
Ce n’est pas une tâche si difficile quand la majorité des hindous identifient pleinement culte et culture. Des textes comme le Ramayana et le Mahabharata légitiment cette identification, car on peut les lire simultanément comme des œuvres littéraires, des récits édifiants, des textes religieux, moraux, des témoignages sur un passé vénéré et toujours actuel.
Vu selon une perspective mondiale, le combat du nationalisme hindou est particulièrement intéressant, car il pose des questions qui, peu ou prou, s’élèvent dans le monde entier : quel sens pour la nation, l’identité nationale, dans le contexte d’une mondialisation qui apporte des progrès, mais génère aussi ses dégâts ? Faut-il renoncer à la nation, ou au contraire la retrouver ? Quelles seraient les alternatives ? Qu’est-ce que l’identité nationale ? Quel sens peut avoir le nationalisme dans une vieille nation comme la France et dans une jeune nation en construction comme l’Inde ? Quel rapport entre l’identité nationale et la dimension impériale ?
Les réponses proposées par le nationalisme hindou à ces questions ne devraient laisser indifférent le reste du monde.